O dépression ! O résurrection ! (16/12/2005)
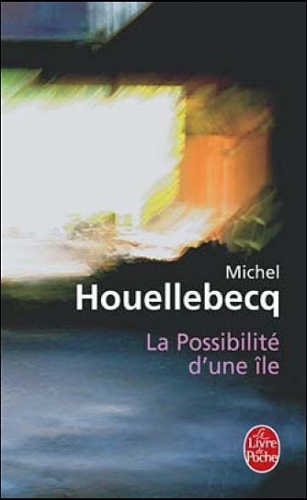 D'abord un bel objet : maquette superbe, papier légèrement jaunie, pages agréables à tourner, titre en violet - et cette extraordinaire photo, prise par l'auteur lui-même, qui représente une sorte de rectangle lumineux aux reflets vert et orange qui s'ouvre dans l'obscurité, comme si nous étions dans une grotte et qu'une sortie s'offrait à nous. Tout pour nous faire sentir que nous avons dans les mains à la fois un grand roman et un "bon bouquin". Le livre le plus attendu de l'année est indéniablement un volume magnifique.
D'abord un bel objet : maquette superbe, papier légèrement jaunie, pages agréables à tourner, titre en violet - et cette extraordinaire photo, prise par l'auteur lui-même, qui représente une sorte de rectangle lumineux aux reflets vert et orange qui s'ouvre dans l'obscurité, comme si nous étions dans une grotte et qu'une sortie s'offrait à nous. Tout pour nous faire sentir que nous avons dans les mains à la fois un grand roman et un "bon bouquin". Le livre le plus attendu de l'année est indéniablement un volume magnifique.
Ensuite, la mise en scène du texte - un texte qui fait à la lettre son entrée, comme un personnage de théâtre. "Soyez les bienvenus dans la vie éternelle, mes amis." est sa première phrase. Puis, un remerciement à la journaliste Harriet Wolff qui est à l'origine de ce livre. Pour autant, nous sommes déjà en littérature. Est-elle une vraie journaliste ou un personnage ? Peu importe, la narration commence son travail de sape. Tous nos repères en l'air : "Il n'y a ni jour, ni nuit ; la situation ne peut avoir de fin."
La seconde page tient en une ligne, d'ailleurs reprise en quatrième de couverture : "qui, parmi vous, mérite la vie éternelle ?" Diable ! Est-ce un prophète qui écrit ? Les suivantes s'allongent un peu plus, multipliant les espaces blancs, mêlant la poésie à la prose. Des chiffres aussi s'alignent. Des formules se répètent déjà : "craignez ma parole". Juste avant, une chatte a fait son apparition, « saccadée, pixellisée, mais étrangement réelle ». Apparemment, c’est ce qui est réel qui pose problème.
« Etait-elle une vivante, une morte ou une intermédiaire ? Plutôt une intermédiaire, je crois ; mais c’est une chose dont il était exclu de parler. »
Nous-mêmes lecteurs sommes englobés dans ce processus d’indiscernement. Sommes-nous vivants ? sommes-nous morts ? Peu importe, nous avons commencé à lire ce livre et nous le lâcherons pas. Un rythme s’est imposé. Un nouvel espace-temps est apparu. Ca pourrait paraître ridicule, c'est extrêmement troublant. Impression de flotter. Entre un rêve et une mise en abîme. L’auteur fait de l'expérimental lisible, ou comme il dirait, de l'underground moyen.
"245535, 43, 3. Quand je dis "je", je mens. Posons le "je" de la perception - neutre et limpide. Mettons-le en rapport avec le "je" de l'intermédiation - en tant que tel, mon corps m'appartient ; ou plus exactement, j'appartiens à mon corps. Qu'observons-nous ? Une absence de contact. Craignez ma parole."
Mais qui parle, nom de Dieu ? un homme ? un ange ? un cyborg ? En tous cas, quelqu'un qui a un corps mais un corps qui ne sent plus rien, qui ne contacte plus rien, qui par conséquent ne souffre plus, mais qui ne sait pas encore que l’absence de souffrance est encore une souffrance. C'est LE sujet du dernier roman de Michel Houellebecq : l’abolition de la souffrance humaine n’est pas garante du bonheur. Schopenhauer avait raison. L’ennui de ne pas subir l’existence nous tourmente autant, sinon plus, que les tourments de l’existence eux-même. Avec le clonage, nous sommes entrés dans le royaume de la douleur indolore. Il faudra déserter.
Notre siècle.
Avant d’en arriver là, il faut revenir à notre siècle – comprendre ce qui s’est passé chez nous autres pour qu’on en vienne à souhaiter le clonage. Que Houellebecq choisisse un comique pour parler de la société est hautement significatif. L’époque est en effet à la dérision. Au ricanement. Au relativisme. Pour autant, nous n’avons que les mots de dignité et de tolérance à la bouche. Nous voulons à la fois la morale et la rigolade, les droits de l’homme et l’almanach Vermot. Et Daniel1 sera ce bouffon qui dispense un humour cynique, misanthrope, sexiste, raciste mais que les intellectuels de Télérama prennent pour de l’humanisme à l’envers. Sociologue hors pair, Houellebecq reprend sa méthode qui consiste à mélanger nos goûts et dégoûts. Son grand art est de stigmatiser des comportements qui ne sont que les résultats de nos « valeurs. » Après avoir montré depuis Extension que le libéralisme économique allait de pair avec la liberté sexuelle, voilà qu’il montre que la modernité crée une nouvelle barbarie. Ainsi de notre respect pathologique des différences qui finit par porter atteinte à notre République chérie. Les femmes que l’on peut brimer sous couvert d’humour méditerranéen :
"Il est vrai que l'arrivée des comiques beurs avait revalidé les dérapages machistes, et que je dérapais concrètement avec grâce".
En ce nouveau monde, on peut laisser crever les vieux pendant la canicule. Âge cristal où seuls les acquis sexuels l’emportent sur les besoins sociaux :
« Et sur l’amour physique, je ne me faisais guère d’illusion. Jeunesse, beauté, force : les critères de l’amour physique sont exactement les mêmes que ceux du nazisme. »
Nous sommes plus païens, plus eugéniques, plus hygiénistes que jamais. Hitler nous fait horreur, mais comme lui nous sommes végétariens et nous avons horreur de la culpabilité.
Le comique est de toutes façons, et depuis toujours, le collabo du pouvoir qui évite au monde « de faire des révolutions douloureuses ». A quoi bon vouloir changer le monde « puisque la racine de tout mal est biologique et indépendante d’aucune transformation sociale imaginable ? » A l’inverse d’un Molière dont le comique visait la réforme de l’individu, Daniel1 flatte les travers du public et alimente son nihilisme. On ne se corrige plus par le rire, on se complaît dans sa misère – en même temps qu’on commence à s’apercevoir que ce n’est peut-être pas la peine de la continuer. La fameuse phrase de Cioran, « les enfants que je n’ai pas eus, s’ils savaient le bonheur qu’ils me doivent » n’est plus une phrase d’humeur qui nous console de la rudesse de l’existence, mais bien un programme moral doublé d’un nouveau planning familial. Le refus de procréer n’est plus le fait de quelques esprits supérieurs ou de féministes hystériques mais celui d’un nombre d’hommes et de femmes de plus en plus important.
« Pour la première fois des gens jeunes, éduqués, d’un bon niveau socio-économique, déclaraient publiquement ne pas vouloir d’enfants, ne pas éprouver le désir de supporter les tracas et les charges associés à l’élevage d’une progéniture.»
Ce qui compte désormais est moins l’être que le bien-être. Or, en supprimant la douleur de vivre et en assurant l’immortalité, le clonage apparaît comme la solution finale idéale de l’humanité. Comme le dira un slogan, le clonage, c’est « l’éternité, tranquillement. » Au fond, la voilà la seule vraie révolution. Non changer le système, mais changer les gènes.
Daniel1, qui se fit « des œufs à la tomate le jour du suicide de son fils », en est bien conscient et est l’un des premiers à intégrer la secte des Elohimites. L’immortalité, c’est la rupture avec l’espèce.
« J’avais refusé la chaîne, brisé le cercle illimité de la reproduction des souffrances, et tel était peut-être le seul geste noble, le seul acte de rébellion authentique dont je puisse me prévaloir à l’issue d’une vie médiocre malgré son caractère artistique apparent. »
C’est le temps de la grande trahison. De la seconde et définitive mort de Dieu.
« Des espions, des traîtres, dans l’histoire humaine, il y en avait déjà eu (pas tant que ça d’ailleurs, juste quelques-uns, à intervalles espacés, c’était plutôt remarquable dans l’ensemble de constater à quel point les hommes s’étaient comportés en braves bêtes, avec la bonne volonté du bœuf grimpant joyeusement dans le camion qui l’emmène à l’abattoir) ; mais j’étais sans doute le premier à vivre à une époque où les conditions technologiques pouvaient donner à ma trahison tout son impact. »
Être immortel dispense en plus de procréer. Si nous nous survivons nous-mêmes à nous-mêmes, inutile de se reproduire. Plus de gamin à aller chercher au tennis. Plus d’ado parasite qui reste chez vous jusqu’à trente ans. Plus de soucis, de conflit et de culpabilité Les enfants que je n’ai pas eus, s’ils savaient le bonheur que je leur dois.
Kant vs Schopenhauer.
La question qui se pose à ce moment de la lecture, et que l’on a déjà posée maintes fois à propos des autres livres de son auteur, est celle-ci : Daniel1 est-il Michel Houellebecq ? Et si oui, La Possibilité d’une île n’est-elle dans ce cas qu’un long sketch dégueulasse qui fait la promotion du clonage et de la secte raélienne ? Toute l’actualité récente de Houellebecq semble aller dans ce sens. A bien des égards, Daniel et Michel sont jumeaux. Mais un jumeau n’est pas pour autant un porte parole. Et ce n’est pas parce que l’on se met en scène que l’on se donne raison. En fait, il faut se rappeler ce que disait Milan Kundera sur les ruses du roman, à savoir que le grand roman est celui qui intègre les défauts de l’homme qui l’écrit et qui les fait réapparaître dans leur pure abjection. Je suis dans la vie un méchant avaricieux mais n’en ai cure, j’écris L’Avare, et crée le personnage le plus odieux possible, le plus ridicule dont tout le monde va se moquer. Diable ! Etais-je vraiment si affreux ? Mon avarice réelle risque d’en prend un coup [1]. Pas de doute, écrire rend meilleur.
La grande vertu de Houellebecq romancier est de critiquer ce à quoi Houellebecq l’homme peut adhérer. Au fond, ce schopenhaurien est un kantien qui dans les tréfonds de son désespoir n’oublie jamais l’impératif catégorique. Qu’il se compare à Michael Haneke, l’inquiéteur du cinéma contemporain n’a rien d’étonnant. Chez le cinéaste comme chez l’écrivain, l’abject est toujours vu sous son angle le plus insoutenable – c’est-à-dire le plus moral, celui qui fait que le mal nous écœure. Tout le contraire d’un Larry Clark, l’auteur de Kids, véritable « commerçant du mal » qui prend parti pour les enfants contre leurs parents, fussent-ils irresponsables, drogués, et porteurs du sida, qui les incite à la fornication généralisée, qui bande de les voir se transmettre le virus. En opposition totale à cette « racaille nietzschéenne qui proliférait depuis trop longtemps dans le champ culturel », Houellebecq peut traîner ses guêtres dans un club échangiste ou dans une secte, il n’oublie jamais le point de vue moral [2]. Ainsi peut-il se décrire pleurant aux cérémonies élohimites sans nous faire pleurer avec lui – ce qui nous émeut n’est pas du tout la cérémonie elle-même mais la vulnérabilité désespérée de cet homme en manque d’amour qui trouve un palliatif à sa misère. Probité de l’écrivain qui contraste magnifiquement avec son personnage médiatique qu’on dit si manipulateur. Renard dans l’édition, chien battu dans l’ écriture – qui hurle à la plume. Il reste à jamais cet homme qui recherche le regard des femmes autant que leur chatte. Ce garçon qui veut qu’on l’embrasse.
Les clones du désir.
Qu’on se rappelle la fin des Particules. Les fameux corpuscules de Krause censés augmenter nos jouissances, pour l’instant « pauvrement disséminés à la surface du clitoris et du gland », mais que la science nous promettait de multiplier sur toute la surface du corps, « offrant ainsi, dans l’économie des plaisirs, des sensations érotiques nouvelles et presqu’inouïes. ». Le développement du clonage nous promettait un monde rêvé, mille fois plus érotique et plus moral que le nôtre. C’était d’ailleurs un clone qui signait le livre – faisant de ces Particules déjà un premier commentaire de notre humanité larvée. Avec la Possibilité d’une île, nous y sommes. Sauf qu’il a fallu renoncer à l’érotisme, vu qu’on ne pouvait avoir une chair vibrante non souffrante. Tant pis, le but était avant tout d’éradiquer la douleur, on s’est dit que se passer de la volupté était un sacrifice minime. Que valent de vagues orgasmes à côté de la béatitude éternelle ? Car ça y est ! enfin ! non content d’avoir tué la douleur, nous avons vaincu la mort ! Nous pouvons nous reproduire de clone en clone, et à partir de dix-huit ans s’il vous plaît (évitant ainsi tous les déboires de l’enfance et de l’adolescence), conserver notre personnalité et notre mémoire, user notre corps pendant cinquante ou soixante ans, et, dès les premiers signes de décrépitude, en reprendre un autre. Dès lors, inutile de se reproduire, donc, de faire l’amour, donc de se toucher. Désincarnés et immortels, nous pouvons contempler l’humanité en se félicitant de ne plus en être. « Regarde les petits êtres qui bougent dans le lointain ; regarde. Ce sont des hommes. » Des sauvages oui, sales, pouilleux, à peine plus intelligents que des singes, mais moins émouvants que des chiens. Comme la vie humaine est dégoûtante vue de près ! Des zombies ne pensant qu’à survivre, comme dans un film de Georges Roméro.
« Des êtres avancent au premier plan, longeant la crête des falaises comme le faisaient leurs ancêtres plusieurs siècles auparavant ; ils sont moins nombreux et plus sales. Ils s’acharnent, tentent de se regrouper, forment des meutes ou des hordes. Leur face antérieure est une surface de chair rouge, nue, à vif, attaqué par les vers. Ils tressaillent de douleur au moindre souffle du vent, qui charrie des graines et du sable. Parfois ils se jettent l’un sur l’autre, s’affrontent, se blessent par leurs coups ou leurs paroles. Progressivement ils se détachent du groupe, leur démarche se ralentit, ils tombent sur le dos. Elastique et blanc, leur dos résiste au contact du roc ; ils ressemblent alors à des tortues retournées. Des insectes et des oiseaux se posent sur la surface de la chair nue, offerte au ciel, la picotent et la dévorent ; les créatures souffrent encore un peu, puis s’immobilisent. »
Henri de Régnier avait raison : « vivre avilit ». C’est que la douleur physique est consubstantielle à l’existence des êtres humains, constitutive de leur organisation. La preuve que la nature est mal faite est qu’elle leur fait mal. Alors que nous les néo-humains avons dépassé celle-ci. A peine avons-nous l’idée de ce désir qui taraudait les humains.
« La peau fragile, glabre, mal irriguée des humains ressentait affreusement le vide des caresses. Une meilleure circulation des vaisseaux sanguins cutanés, une légère diminution de la sensibilité des fibres nerveuses de type L ont permis, dès les premières générations néohumaines, de diminuer les souffrances liées à l’absence de contact. Il reste que j’envisagerais difficilement de vivre une journée entière sans passer ma main dans le pelage de Fox, sans ressentir la chaleur de son petit corps aimant. »
Nous y voilà. Les besoins de l’espèce sont dissous, mais les désirs de l’individu, même désexualisé, sont encore là.
« Pas plus que les humains nous ne sommes délivrés du statut d’individu, et de la sourde déréliction qui l’accompagne. »
Du coup, ça déprime. L’impossibilité de s’unir est précisément ce qui va pousser certains d’entre nous à fuir ce monde. L’utopie d’une vie sans souffrance, sans péché, sans part maudite est un leurre. Si l’on peut avoir le beurre et l’argent du beurre, on ne peut avoir le cul de la crémière. Or, le cul de la crémière, c’est précisément ce que désirait Daniel1, et que Daniel25 commence à désirer lui aussi. Lire Spinoza (le philosophe des néo-humains !) comme le recommande la Sœur suprême, ne suffit pas. Pauvres néo-humains qui n’ont gardé comme sensation humaine que le mal de vivre. Ce qui ressuscite en eux, c’est la dépression !
« Ce phénomène [la pensée délivrée] ne s’était produit que dans des proportions insignifiantes, et c’est au contraire la tristesse, la mélancolie, l’apathie languide et finalement mortelle qui avaient submergé nos générations désincarnées. »
Et Daniel25 d’en venir à envier son ancêtre, ses souffrances et ses convulsions. Sentir quelque chose. Redécouvrir les larmes (salées !). Le contact avec la vie. Et c’est cette fin sublime (et qui sans doute rachète les longueurs de la seconde partie) où le clone décide de partir, de parcourir le monde, voire de rencontrer des humains - et qui n’est pas sans rappeler les errances des anges de Wenders dans les Ailes du Désir de Wenders. Hélas, il ne pourra guère communiquer avec ces derniers dont la seule marque de civilisation reste les supplices atroces qu’ils se sont inventés en guise de repères sociaux. Décidément, la vie ne veut que la souffrance. Alors, il continue sa marche sur la côte espagnole, règle son pas sur le mouvement des vagues et tente d’incarner sa désincarnation. Elles sont extraordinaires, ces dernières pages, où semble commencer une sorte d’existence qui oscille entre la vie, la non-vie et la mort, l’humanité et la post-humanité. En lui, l’être et le non-être se mélangent. « J’étais, je n’étais plus. La vie était réelle. »
De l’inconvénient d’écrire un livre parfait.
Alors sans doute, la Possibilité d’une île est-il un livre trop long, parfois redondant et dans lequel on a du mal à se projeter comme dans les précédents. Contrairement aux Raphaël Tisserand, Bruno Djerzinski, et Michel Renaud, Daniel1 n’est pas notre frère. C’est un cynique professionnel qui depuis qu’il est devenu une star ne souffre plus tellement de l’existence et de ce fait ne provoque pas l’empathie. En même temps, l’on comprend que Houellebecq dise qu’il tient là son meilleur roman. Tous ses thèmes y sont largement développés. Le sujet lui-même a une ampleur qui le hausse au niveau du « grand roman contemporain ». A-t-il jamais mieux écrit ? Nous admirons particulièrement cette fluidité qui de la première à la dernière ligne emporte la lecture. Car le plaisir du texte est bien là, abondant et précis, informatif et poétique, incantatoire et naturaliste. Mais la jubilation ne suit pas l’admiration. La mayonnaise ne prend presque jamais – sauf dans l’épilogue. Il est à cet égard significatif que les scènes de cul, dans lesquelles Houellebecq était surdoué, soient presque toutes ratées [3]. Malgré ce qu’il dit de la bénédiction des chattes, Daniel1 n’aime plus tant que ça faire l’amour. Le succès l’a remplacé. Et en se sens, oui, c’est bien de Daniel Houellebecq dont nous parlons. Tant pis, nous attendrons son prochain roman qui sera peut-être, comme Plateforme, « raté » à ses yeux, mais bien plus réussi pour nous. Tel qu’il est, La Possibilité d’une île nous fait penser à la sagesse un peu hautaine de certains chefs-d’œuvre de la maturité, comme le Jeu de perles et de verre de Hermann Hesse. Voilà donc ce beau livre, un peu froid, que l’on admire beaucoup, que l’on étudiera longtemps, auquel on se réfèrera souvent, mais qu’on n’est pas certain de relire.
---------------------------------------------------------------------
1- Le dessinateur Crumb avouait que c’est en exprimant son antisémitisme dans son œuvre qu’il avait compris la sienne et s’en était progressivement détaché.
2 - Ce faisant, Houellebecq est bien conscient de l’exotisme que représente aujourd’hui tout discours moral. Comme il le dit lui-même, « L’avantage de tenir un discours moral, c’est que ce type de propos a été soumis à une censure si forte, et depuis tant d’années, qu’il provoque un effet d’incongruité et attire aussitôt l’attention de l’interlocuteur ; l’inconvénient, c’est que celui-ci ne parvient jamais à vous prendre tout à fait au sérieux. » (La possibilité d’une île, Fayard, p 215)
3 - Exceptée sans doute celle de la « déflagration », p 333.
(Cet article est paru dans le Journal de la culture n°17)

Ramata Koite, dans le film tiré du livre par l'auteur (2008)
23:55 Écrit par Pierre CORMARY | Lien permanent | Commentaires (44) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Commentaires
Henri de Régnier ... ou à la manière de houellebecq, henri de régnier ...
Écrit par : Crumbesquement vôtre | 17/12/2005
Au fait, Montalte, "ciborg" s'écrit cyborg.
Et tant que j'y suis : le clonage n'est pas le sujet du roman... Je voudrais ici non pas commenter l'essentiel de ta critique, mais revenir sur cette question cruciale, source, dans ton texte, de grandes confusions. Tu mélanges tout...
Le clonage n'est pas le "royaume de la douleur indolore" : l'opération d'ablation des centres de la douleur aurait aussi bien pu être menée sur des humains non clonés, seulement génétiquement modifiés. Le clonage n'est qu'une technique reproductive qui ne présuppose aucune des valeurs que tu lui attribues. Houellebecq n'a d'ailleurs jamais fait cette erreur : les clones de La Possibilité d'une île ne sont ce qu'ils sont que parce qu'ils ont été conçus dans un but précis, dans un contexte technologique, socio-économique précis, propres au roman. Le clonage N'EST PAS l'éternité, à peine un ersatz d'immortalité, au moins jusqu'à ce que nous puissions peut-être un jour "copier" nos esprits, ce qui n'arrivera sans doute jamais (Rael est un clown, et décrit comme tel), car la copie ne sera jamais l'original (encore une fois, j'invite ceux que le sujet intéresse à La Cité des permutants de l'australien Greg Egan). Le clone n'est qu'un nouvel être humain doté des mêmes gènes mais en aucune manière de la même histoire, de la même pensée, de la même âme (d'autant que chez Houellebecq, l'étape de formation de la pensée indivuelle est phagocytée par la synthèse accélérée). Même le corps, pour peu qu'il soit soumis à des conditions différentes, se développera différemment. Houellebecq, grand lecteur de SF et sans doute des vulgarisations scientifique, ne s'y est pas trompé puisque à aucun moment, même après plusieurs siècles, les Daniel-n n'ont pu bénéficier de cette "greffe de l'esprit" que Raél et sa généticienne de pacotille prétendent pouvoir réaliser.
L'ADN, contrairement à une idée reçue, n'est pas une carte perforée qui encoderait notre existence, mais une interface qui fonctionnerait non seulement en réseau, c'est-à-dire que nos caractéristiques et processus vitaux impliqueraient l'interaction de plusieurs gènes (et un même gène peut appartenir à plusieurs réseaux), mais il fonctionnerait de surcroît en interaction directe avec l'environnement. Certains scientifiques commencent à soupçonner l'ADN dit "non codant" (http://en.wikipedia.org/wiki/Junk_DNA) de jouer (en plus d'autres hypothèses : réservoir de gènes, protection antimutations, dessein supérieur...) ce rôle d'interface génétique, sorte d'équivalent endogène de la rétrotranscription d'ARN en ADN de rétrovirus comme le VIH (même si des expériences menées sur des souris auraient montré que privées de millions de ces "gènes-poubelle", les cobayes non seulement auraient survécu, mais en plus auraient donné naissance à des souris parfaitement saines...) ; voir la découverte de la fonction des transposons et des micro-ARN, qui inhibent la traduction des ARN messagers et l'expression des gènes. Rappelons aussi que d'autres considèrent que ce "Junk-DNA" pourrait finalement effectivement n'être qu'un historique des choix non retenus par l'évolution, résidus génétiques au même titre que nos corps recèlent des résidus d'organes disparus.
Tout ça, Montalte, pour dire que les événements de La Possibilité d'une île ne sont pas la conséquence du clonage (qui, donc, n'assure évidemment pas l'immortalité), mais d'une déroute métaphysique.
Les clones de Daniel sont des individus amputés d'histoire individuante (ils naissent avec un corps et un cerveau d'un homme de 18 ans : ils ne sont plus vraiment humains, ils sont néo-humains) auxquels on a assigné le rôle unique de copie - magnifique allégorie de ce même engloutissement de l'être dans la Machine-Monde décrit par Dantec dans cet autre grand roman de science-fiction, Cosmos Incorporated.
Le vrai danger du clonage ne réside donc pas dans cette illusoire promesse d'immortalité (déjà traitée cent fois par la SF), mais dans l'utilisation des clones à des fins industrielles, prémices à l'abdication de toute hiérarchie des valeurs : l'homme considéré comme produit industriel. Le meilleur roman sur le clonage, à ce jour, reste donc Reproduction interdite de Jean-Michel Truong.
Quant à la question du plaisir et de la sexualité dans le roman, j'en fais une toute autre lecture, mais je la garde pour mon futur article...
Écrit par : Transhumain | 17/12/2005
Prix Nobel de Biologie 2006 : Le Transhumain.
Mais qu'est-ce que je raconte ? Je suis en pleine science-fiction ou bien ou bien j'ai atterri dans la cinquième dimension ?
Écrit par : Nobel prize | 17/12/2005
Je sais! Transhumain est le clown de Topaze.
Écrit par : Muche | 17/12/2005
Ici une photo exclusive du Transhu:
http://www.peres-fondateurs.com/~baronsamedi/?p=33
On comprend pourquoi il est pour le clownage!!!
Non, c'est de la jalousie, méchanceté gratuite, son petit exposé savant est passionnant.
Écrit par : Jules Le(ru)quier | 17/12/2005
Des révélations énormes ici :
http://poubellesdelablogosphere.blogspot.com/
Écrit par : Robinson | 18/12/2005
Bizarre, Transhumain, ta critique de ma critique. On dirait que tu essayes de comprendre le roman de Houellebecq à l'aune d'autres romans et du coup tu tombes dans une intertextualité qui te fait manquer le texte de Houellebecq dont d'ailleurs tu ne dis mot (toi qui me reprochais récemment de parler de "Caché" comme si je ne l'avais pas vu, c'est un comble !) Que le clonage soit pour les auteurs que tu cites autre chose qu'une volonté d'immortalité et d'abolition de la douleur n'empêche pas qu'il soit tel pour Houellebecq - les extraits que je cite étant plus qu'éloquents. Daniel1 disant entre autres :
« J’avais refusé la chaîne, brisé le cercle illimité de la reproduction des souffrances, et tel était peut-être le seul geste noble, le seul acte de rébellion authentique dont je puisse me prévaloir à l’issue d’une vie médiocre malgré son caractère artistique apparent. »
Parce que si Houellebecq est un grand lecteur de SF, il en est encore un plus grand de Schopenhauer et que l'on retrouve comme jamais dans ce dernier roman. Rompre avec la souffrance, casser le cordon du vouloir-vivre sans pour autant mourir, trahir l'espèce, c'est bien la volonté de Daniel1 et qui est bien autre chose que le résultat de "l'utilisation des clones à des fins industrielles, prémices à l'abdication de toute hiérarchie des valeurs : l'homme considéré comme produit industriel". Rien de tel dans la Possibilité d'une île qui serait d'ailleurs un bien pauvre livre s'il se limitait à une dimension technologique et sociale. Comme toujours, c'est l'existentiel qui est en cause.
En revanche, oui, "déroute métaphysique" qui se caractérise par une perte d'indidualité mais du fait précisément que le clonage se présente pour Daniel comme une technique d'immortalité. Ce qui est émouvant, c'est que malgré son état de clone, de post-humain, Daniel25 rêve de son humanité perdue et que s'il s'évade de sa communauté, c'est pour tenter de la retrouver, au moins de la frôler en risquant de disparaître définitiviment, sans reduplication - c'est-à-dire de mourir. Bref, l'homme reste homme même dans sa post-humanité, partagé qu'il est entre le dégoût de sa condition originelle (le vivant) et l'ennui total et absolu de sa nouvelle condition (le clonage). Voilà le sens de ce beau livre un rien hautain.
C'est pourquoi je ne suis pas du tout d'accord quand tu sous-entend que ce sont les hommes qui sont les victimes du système, que l'on leur a assigné, presque contre leur volonté, leur statut de copie, bref, qu'ils sont les marionnettes d'une aliénation supérieure etc. Je crois au contraire que des Particules à cette Possibilité, le pessimisme de Houellebecq consiste à dire que l'humanité moderne ou post-moderne fonce de son plein gré vers le clonage, vers la secte, vers le tourisme sexuel et que l'on ne pourra rien contre cette volonté, fausse, scandaleuse et obscène, de "bonheur". "Ils seront heureux et ne seront rien de leur déchéanche" comme écrivait Witkiewicz. Tout son art d'écrivain étant de se mettre à la place du cloné, du touriste sexuel, du sectaire - et de montrer en quoi il est heureux de l'être. C'est cette intériorisation du salaud ou du dépressif ou du paumé qui nous rend compte du réel et qui fait que Houellebecq est un écrivain scandaleux. C'est cette fascination, cette proximité avec ce qu'il réprouve qui le rend si pénétrant. Trop facile en effet de parler d'un mal en disant simplement "c'est mal", non, ce qu'il faut faire, c'est dire "c'est mal" tout en montrant que ceux qui participent à ce mal sont ravis, heureux et "épanouis". C'est donc se tromper du tout au tout que de dire qu'il décrit "l'homme considéré comme produit industriel" alors qu'il s'agit au contraire de "l'industrialisation de l'homme considérée comme la volonté de l'homme". L'homme comme produit est un désir de l'homme moderne.
Bref, c'est sous l'angle moral classique qu'il faut lire Houellebecq - la SF n'étant pour lui qu'une manière de clarifier le propos (ce que d'ailleurs d'aucuns lui reprochaient.), ce qui n'est pas mal vu que la plupart du temps, elle embrouille tout. Oui, je sais, j'y suis allergique.
(Tiens, on te pastiche. Quel honneur !)
Écrit par : montalte | 18/12/2005
Le pastiche est assez nul pour que personne n'ait encore jugé bon d'y poster le moindre commentaire. Et pour info, je suis beaucoup plus beau que le monstre de la bosue en question.
Comme d'habitude Cormary, tu n'as strictement rien compris de ce que j'ai écrit ci-dessus, puisque tu fais contresens sur contresens. Quand j'écris que Houellebecq décrit "l'homme considéré comme produit industriel", ce n'est pas un jugement, mais une constatation : dois-je donc, pour être compris de toi, user comme Assou(p)line de gras, de surlignages et d'italiques à foison ? Aurais-je donc dû préciser que pour moi, Houellebecq CRITIQUE l'industrialisation de l'homme ? La suite de ma petite intervention était pourtant limpide, puisque j'écrivais des néohumains qu'ils sont une "magnifique allégorie de ce même engloutissement de l'être dans la Machine-Monde décrit par Dantec dans cet autre grand roman de science-fiction, Cosmos Incorporated." Je n'ai jamais écrit, nulle part, que l'homme était victime d'un système autre que celui créé par lui, d'une "aliénation supérieure", ces âneries que tu n'as jamais pu lire chez moi. Non, je ne parlais que du clonage, et du jugement moral porté par Houellebecq sur la disparition de la douleur. La référence à Truong, quant à elle, n'avait d'autre but que de guider le lecteur intéressé vers un livre traitant des vrais problèmes que le clonage posera bientôt. Et toi, tu arrives avec tes gros sabots, et tu avales indistinctement avant de tout régurgiter sens dessus dessous. Je me demande sincèrement, Montalte, si tu le fais exprès, ou si tu es tout simplement stupide...
Je t'ai pourtant dit clairement, encore une fois, pourquoi je préférais ne pas parler vraiment du roman : je prépare ma propre critique de ce roman exceptionnel : c'était annoncé d'emblée, bordel ! Tu veux des smileys en plus, c'est ça ? Mais dis-le ! Bon, je me suis un peu lâché sur l'ADN, c'était limite hors sujet, mais qu'importe, ça en aura au moins fait rire certains. L'ennui, c'est que ta critique reprend à son compte ce que le roman fait dire à ses personnages, et qui n'est assurément pas l'opinion de Houellebecq, qui sait pertinemment que clonage et immortalité font deux. Les mauvais journalistes sont d'ailleurs tombés dans le panneau, comme toi et la gelée qui te tient lieu de cerveau. Il ne s'agit pas de juger le Houellebecq à l'aune des autres romans de SF (et pourquoi pas, d'ailleurs ?), mais la moindre des choses quand tu abordes des questions scientifiques, est de rester rigoureux. Or, de rigueur, ton texte en manque cruellement.
Rien à ajouter sur la souffrance et Schopenhauer : ce que tu écris est pour une fois assez juste (et évident), je pointais seulement, combien de fois faudra-t-il te le répéter, le fait que dans ton texte, tu l'associes inextricablement au clonage alors que le clonage de Daniel et la disparition de la douleur sont deux événements chronologiquement corrélés mais indépendants. Il y a bien une réflexion sur le clonage dans le livre, mais en creux, et tu n'y a rien compris. J'y reviendrai dans mon article.
Voilà ce que j'ai écrit, foutu poussah poussif !
Écrit par : Transhumain | 18/12/2005
Double faute transsibé-RIEN :
- ce n'est pas un pastiche, c'est un foutage de gueule (je suis très déçu de cette erreur de ta part, je croyais fermement à l'infaillibilité transhum-anale sémantiquement)
- la qualité d'un texte ne se mesure pas à son nombre de commentaires (c'est ton ami le trisomique basquaise qui doit être déçu là, pour le coup, de te voir adopter une aune si mesquine), sinon cela voudrait dire que tes interminables articles jargonnant, aussi primesautiers et lisibles que des codes juridiques, que j'ai pu apercevoir de loin sur ton blog si génialissime (au fait ta nouvelle charte graphique est dégueulasse, on se croirait dans une ville d'ex union soviétique un lendemain de cuite, par - 30° - mais ce doit être le genre d'ambiance que tu aimes remarque, et puis l'ancienne présentation était il est vrai déjà trop déprimante - combien de suicides à ta lecture?) qui n'ont reçu aucun commentaires (mais j'imagine que ta boîte à lettres a du être subermergée) sont des bouses, et là tu ne dois pas être d'accord, le Transhu? Et puis tu as vu le nombre de messages chez Julien Dray? Tu joues les éminences détachées de l'avis du commun - que tu méprises , comme ton comparse mais lui au moins a la cohérence de laisser ses commentaire fermés, populace blogosphérique dénoncée mais auprès de laquelel cependant tu ne cesses de quêter fébrilement une reconnaissance. Aurais-tu tremblé en guettant les commentaires? Genre j'actualise la page en boucle...Décidemment tu es décevant.
Mais ne t'inquiète pas tu finiras par trouver un éditeur, et tu pourras manger au ratelier de ce que tu villipendais la veille...
Et puis ce blog, ne t'est pas consacré exclusivement, transmythomane. Quoique on pourra y trouver bientôt des extraits de ton journal transintime , mais après fini, la trop longue fréquentation de l'idée de ta personne est anxiogène.
Ah oui, je voulais te dire : l'onanisme, même et surtout intellectuel, ça se pratique tout seul par définition.
Écrit par : Robinson | 18/12/2005
Oh, Transhumain, ne t'énerve pas s'il te plaît. Tu sais très bien que c'est celui qui perd son calme qui perd du terrain. Et que celui, de terrain, que tu proposais, au nom de la rigueur, n'avait et n'a toujours rien à voir avec celui de Houellebecq. Tu ne décolles vraiment pas de ta putain de machine-monde et de l'industrialisation de l'humain (je ne te reprochais pas de ne pas en parler, je te reprochais de trop en parler, manquant l'essentiel, mais tu lis trop vite et tu m'accuses de tes propres confusions)
Lorsque je lis Les Misérables, je comprends la misère telle que me la décrit Hugo et qui n'est peut-être pas celle de l'historien, du sociologue ou même d'un autre auteur. Et bien toi, on dirait que que tu lis autre chose. Ta rigueur "scientifique" bloque ta rigueur littéraire. Tu vois de l'aliénation là où il n'y a que du désir, de la critique là où il n'y a que de la pitié et quand tu répètes qu'il n'y aucun rapport entre le clonage et l'abolition de la douleur, DU POINT DE VUE DE CE LIVRE, j'attends encore que tu me le prouves. Quant à savoir ce que Houellebecq pense lui-même, c'est tout le problème. J'ai tenté dans mon article d'apporter une réponse à l'aide des ruses du roman chères à Kundera - que le romancier peut à la fois avoir les mêmes inclinations et les mêmes pensées de ses personnages même s'ils les critique d'autre part. Avoir les tares de son époque sans s'en féliciter comme je disais. C'est ce conflit qui donne tant d'intensité aux livres de Houellebecq. Tant pis si tu passes à côté au nom de ta transhumanité. Cela dit, je lirai ton article avec intérêt.
Pour l'heure, remettons-nous en admettant qu'il y a tout ça en même temps. C'est la grande vertu de Houellebecq de faire que ses lecteurs s'investissent à fond dans ses livres et sont prêt à s'étriper entre eux. Tu vois, tout va bien dans le pire des mondes.
(J'l'ai énervé encore là, vous croyez ?)
Écrit par : montalte | 18/12/2005
Un article intéressant sur le transhumanisme :
http://www.admiroutes.asso.fr/philoscience/transhumanisme.htm
Écrit par : Sébastien | 18/12/2005
Robinson, ne t'ai-je pas déjà conseillé de rester sur ton île ? Non ? Eh bien c'est fait.
Écrit par : Transhumain | 18/12/2005
Cher Vendredi, je m'apprêtai précisément à te convier à me rejoindre séance tenante sur mon île pour un vernissage, dont les cahouètes et le mousseux auront un goût peut-être un peu aigre-doux pour tes fines papilles de noctivore dandy post-humain :
"Tout ce que le marigot germano-pratin a essayé de vous cacher, tapi dans les relents de son fumet putride, enfin la vérité sur la mission Transusumaine!!!
Une nouvelle édition du dictionnaire des héros est d'ores et déjà programmé pour y adjoindre notre Elohim préféré!"
http://poubellesdelablogosphere.blogspot.com/
Insulairement, je te caresse les circuits mon petit D2-R2, et je te dis donc à tout de suite...
Écrit par : Robinson | 18/12/2005
Eh oh ! pas de coups en-dessous de la ceinture, je compte les points !
Les circuits imprimés de Transhumain ne doivent pas être pris à rebrousse-poil c'est réservé à sa douce moitié ....
SVP Ne le débranchez pas avant qu'il ait eu le temps de nous délivrer son message, pour le moment on ne sait pas le décoder.
Écrit par : H.A.L | 18/12/2005
Tenez les nabots, à propos de clonage et de J.-M. Truong, venez donc faire un tour chez moi : http://findepartie.hautetfort.com/archive/2005/12/19/transhumanae-vitae.html.
H.A.L., avant que Dave te débranche, tu connaîtras donc la teneur de mon "message". J'ai peur qu'il t'effraie un tantinet...
Écrit par : Transhumain | 19/12/2005
Je n'ai jamais lu telles pitreries que ce site pour ringards du cyberspace, ce truc moribond qui se prétend être une sorte de pastiche des excellents billets du Transhumain. Il n'est pas donné à tout le monde de se hisser à la hauteur des Consanguins ! Mais certains parviennent à se bercer d'illusions avec une force déconcertante. Enfin bref... laissons les cons s'illusionner eux-mêmes.
Montalte, la critique de transhumain n'est pas dénuée d'intérêt. Il est vrai que le dernier Houellebecq devrait être lu à la lumière d'une savante lecture liée aux nouvelles technologies et au monde de l'anticipation. Il est vrai que le clonage n'est pas le sujet du roman. Dans la droite ligne de ses précédents, Michel Houellebecq écrit sur l'homme. L'homme dans la société. L'homme et son animalité, son programme génétique. L'homme et le bonheur. Le clonage vient, dirais-je, clore un chapitre. Après un constat foudroyant sur les strates sociales qui empêchent le bonheur de tous (quel inepte imbécile à pu écrire que EDDDLL était daté ? ah ! oui ! E. Nauleau !), puis les suivants qui exploitent cette piste, jusqu'à cette analyse brillante d'un monde divisé en deux, l'un où l'on ne peut vendre que son corps, dénué de toute autre ressource, un autre où l'on ne peut qu'acheter des corps, incapables d'entrer en contact avec autrui. Il fallait bien en passer par l'anticipation. Alors que deviendra ce monde décadent ? Le clonage comme le terrorisme est au centre de toutes nos préoccupations. Et oui ! Qu'est-ce qui nous occupe hormis cela ?
Je ne pense pas que les hommes foncent de leur plein gré vers le clonage. Je crois plus aux analyses de Kant ou de Hegel en la matière. Je ne suis pas bien sûr que les hommes aient le choix. Ils pensent agir en toute liberté mais sont emportés par une raison universelle qui travaille comme une taupe, en souterrain, et les conduit, malgré eux, vers un devenir nécessaire et irreversible. A la différence près, les deux compères de la philosophie moderne prétendaient que les desseins de la Nature ou l'Esprit universel nous conduisaient vers la libération et le Bien ; je partagerais plus les vues d'un Houellebecq qui nous dit, selon le Transhu, que nous allons vers une "déroute métaphysique". La formule est brillante.
Il y a donc une aliénation supérieure : "Tout ce que la technique pourra faire elle le fera en dépit de l'éthique et de la morale ; tout ce que la science pourra faire, elle le fera en dépit de l'éthique et de la morale" !
Les hommes sont désormais aliénés à la technologie, aliénés aux sciences, aliénés aux relations économiques. Les hommes sont désormais seuls, et le bonheur de fait, leur est de plus en plus innaccessible. On peut d'ailleurs le voir dans les écrits de Daniel24 et sq. Seuls derrière leur écran, communiquant avec leur alter ego sans rentrer charnellement en contact. Le constat est d'un pessimisme glacé. Et c'est en ce sens que ta critique prend toute sa force. Lorsque tu parles du Cyborg, tu dis des choses justes : "quelqu'un qui a un corps mais un corps qui ne sent plus rien, qui ne contacte plus rien, qui par conséquent ne souffre plus, mais qui ne sait pas encore que l’absence de souffrance est encore une souffrance". Et tout cela mène à l'interrogation : l'homme dépassera-t-il l'humain ?
Cela, tel que tu le démontres, est la conséquence d'un siècle qui s'accélère, ou les valeurs deviennent exclusivement marchandes, où les relations sexuelles et sentimentales s'inscrivent dans les mêmes procédés de transactions économiques. Bref... tout cela pour dire que ton analyse est loin d'être inepte, même si, j'imagine, le Transhu ne disait pas cela non plus. Nous sommes chez un auteur délibérement schopenhauerien. Post-Shopenhaurien, je dirais, derrière Nancy Houston. Son regard est celui d'un homme non pas désabusé mais désespéré au sens grec du terme. Le dialectique Kant/Schopenhauer est ma foi assez bien vue, même si Houellebecq ne comprend pas Kant dans toute sa finesse ; il ne saisit pas non Nietzsche qu'il réduit à n'être qu'un philosophe de moindre importance que son maître Arthur. Bien sûr, je ne cherche pas à vous départager entre toi et Transhu. Mais j'ai un peu l'impression que tu fais plus une lecture philosphique et littéraire, et Transhu une lecture plus technique, et savante. Les deux sont complémentaires, et digne d'intérêt. Elles sont également légitimes, sans quoi, Houellebecq, serait comme Nothomb, un auteur à lecture unique, plat et rapidement comestible. Or, c'est un auteur complexe, nuancé, profond. Une seule lecture de l'une de ses oeuvres ne sera jamais suffisante pour parfaitement embrasser son texte.
Il y a toutefois une chose sur laquelle, je n'arriverai pas à te suivre. Sur le fait que ce livre soit 1) parfait 2) trop parfait. Il se trouve dans cette possibilité des moments d'infinis, tels qu'il les décrit dans son interview aux Inrocks. Des moments de bravoure et des moments d'ennui profond. Hormis le fait qu'il ait à présent abandonné les personnages que l'on pourrait qualifier de "perdants" dans la société de compétition, il continue pour autant de décrire les dérives d'un homme qui, malgré le succès et l'argent, n'est pas heureux, est seul, isolé, presque perdu. Et c'est la force de ce roman... renverser la proposition jusqu'ici admise par quelques leceurs hâtifs : il y a les gagnants et les perdants dans la société ultra-libérale. La réponse de Houellebecq vient les retourner en bon judoka qu'il est : aucun gagant ! Juste une totalité de perdants qui s'épuiseront avec des hochets à s'illusionner d'un bonheur qui leur sera à tout jamais innaccessible.
Un très beau livre... et ta critique lui rend bien !
Écrit par : Marc A. | 19/12/2005
Marc, je suis d'accord avec toi, à un détail près : ma lecture n'est pas "savante" du tout et se veut tout aussi métaphysique que celle de Montalte. Cela vous le verrez dans ma propre critique. Mais, Marc, tu sais bien que Sloterdijk, dans La Domestication de l'être, a parfaitement démontré que c'est désormais l'anthropotechnique qui fonde la métaphysique, que la répartition métaphysique de l'étant (spirituel, propre et humain d'un côté, concret, mécanique, inhumain de l'autre) est un postulat profondément enraciné mais non moins erroné. Cessons de nous reposer sur des concepts et systèmes philosophiques qui ont précédé les biotechnologies. Comme tu l'as compris, je ne critiquais pas l'ensemble du papier de Montalte, qui en effet n'est pas complètement inepte, mais seulement certaine confusion liée au clonage.
Écrit par : Transhumain | 19/12/2005
Toi Alpetzouille commence par te procurer une méthode Assimil français pour les primo-arrivants, qui te permettra, avec un peu de persévérance, de construire au moins une phrase correcte dans tes soporofiques fiches de lecture pour Centres de Documentation et d'Information. Tu ne cesses de dénoncer la chute du niveau solaire, et tu as raison, tu en es la preuve : un petit prof qui écrit avec ses métatarses. Et je mets au défi tes amis d'apôtres autproclamés du Verbe Igné de soutenir une nanoseconde le mensonge éhonté de ne serait-ce qu'à dose homéopathique, je ne dis même pas de littérature, mais modestement d'une langue française pratiquée dans le respect de ses règles de base. Mais ils éluderont la question comme toutes celles qui les dérangent : ainsi le Transhu n'a toujours pas répondu aux dernières questions de Montalte et sest-il juste fendu de deux plaisanteries pas drôles ; "le Transhumour est une aporie", n'était-ce pas le titre de l'un de ses billets sous le vernis de cuistrerie desquels, une fois dissipeé l'écran de fumée des mots systématiquement rares - ne cela oui tu es un nouveau riche comme te le disait très justement l'hôte involontaire de ces lieux, ce que tu ne compris pas, et le gros bataillon des assertions arbitraires, de multiples failles se font jour...
Écrit par : Robinson | 19/12/2005
Robinson, sale troll putride et trichineux, apprends donc à lire, avant de prétendre écrire : je ne me prononcerai plus sur la critique de Montalte, pas plus que sur le roman de Houellebecq, avant d'avoir rédigé ma propre critique, que d'ailleurs personne ne t'obligera à lire. Tu as compris, immonde parasite, ou tu préfères que je t'enfonçe ça dans l'éponge excrémentielle de ton crâne ? Je me contrefous de l'opinion des cyberpoux dans ton genre, tu entends ? Toi et tes pustules n'intervenez ici que pour y répandre l'insupportable odeur de vos déjections, tu n'existes que pour souiller les lieux du pus qui suinte de ton ignoble émonctoire, chacun de tes commentaires est une prolapus, une diarrhée, une infection, chacun de tes mots est un glaviot sanguinolent, ta pensée est irrémédiablement stercorale, pauvre petit ver ! Mais quoi que tu fasses, ton abominable cucurbitain ne nous atteindra jamais, renvoyé par nous avec les autres déchets de la blogosphère dans la fange de ta poubelle infâme. Continue donc de lâcher tes minables coprolithe :, tout au plus nous réjouissons-nous, de loin en loin, de pouvoir maintenir ta face verruqueuse dans ta propre bile !
Écrit par : Transhumain | 19/12/2005
Ne perds pas ainsi ton liquide de refroidissement mon petit travelo! Premièrement c'est indécent, tout le monde te regarde faire sous la carlingue, et tu vas blesser tes circuits qui, ne l'oublions pas, doivent servir d'accélérateur de particules à la Transhumanité en marche...Si mes propos ne t'atteignent pas pourquoi te fatiguer à me servir ton poussif chapelet d'insultes médicales, sans imagination ni petite musique aucunes, recopié-collés recta(l) du Vidal? Cantonnes-toi à la "résistance critique" et ne viens te risquer sur le terrain de la création, misérable toy énucléé, tu n'es bon qu'à opérer des synthèses ampoulées des pensées d'autrui, que tu vampirises, en oubliant systématiquement les guillemets. Tu n'as pas totalement tort d'un côté, ma démarche est de salubrité publique : elle vise à faire exploser les gros bubons d'orgueil des petites frappes dans ton genre qui se sont pris pour quelqu'un ( "Mon transhumanisme, je l’avais écrit en inaugurant ce blog critique, ne se conçoit qu’au point nodal des enseignements essentiels du Christ et de Zarathoustra", mon émonctoire en dégorge encore son ignoble cucurbitain de rire!!!) pour s'être mirés avec complaisance dans le miroir que leur tendaient quelques flagorneurs qui composent le microcosme batracio-proto-bovin-AltetFortien...C'est toi qui sent fort de la prétention, garçon! Va te laver le greffon, tu pues des aisselles, espèce d'OGM!!! Je te le répète, une fois retombée la poudre de transperlimpimpin suintant de ton style écoeurant et une fois claquées les ampoules pyrotechniques de ta phrase pompeuse (il est doit être content le Verbe avec des chevaliers de ta trempe!), on ne découvre qu'un seul dénominateur commun à ta fatrasie : ton égo hypertrophié. Tu détournes le talent d'autrui pour t'en gonfler les syanpses, baudruche infectée, parole d'hélium!!!
Allez petit faiseur, Robert Macaire de la blogosphère, je te laisse à tes éjaculats de verrat content de lui, et je ne te demande qu'une chose : pense à une version vernaculaire de ton Blooooooooooooog!!!! Ou alors, fournit la notice, paysan parvenu.
Écrit par : Robinson | 19/12/2005
L'abus de Léon Bloy nuit gravement à la qualité des textes. A lire avec modération.
*Celeborn
Écrit par : *Celeborn | 19/12/2005
Transhu, me suis-je à ce point mal expliqué (cela plaira à certains, sans doute !), pour t'avoir laissé penser que je ne voyais pas dans ta lecture une grille métaphysique. C'est clair, pourtant. Vos deux lectures sont complémentaires en ce sens que Montalte joue plutôt la carte subjective (lecture personnelle et attentive) et toi, une carte plus objective (je prends par exemple cette référence très juste à Sloterdijk). Je voulais dire "savante" au sens de la définition littérale : qui a des connaissances étendues dans divers domaines ou divers disciplines particulières. Rien de péjoratif, donc. Et il est clair que tu es bien plus au courant des aspects biotechniques et anthropotechniques qui sous-tendent le discours de Houellebecq que je ne le suis ou que ne l'est Pierre, même si cette "lacune" n'empêche en rien de comprendre les propos de Houellebecq, et d'en saisir l'immense portée. Quand au problème de la métaphysique, je te suis à cent pour cent : elle se déporte vers l'anthropotechnique. Si Kant mis fin à la métaphysique au XVIIIème siècle, la science est entrain de lui donner une seconde jeunesse, et lui donnera peut-être une réponse définitive. Qui sait ? En tous cas, ce sont les prédictions mêmes de Houellebecq.
Ce qui est sûr, c'est que j'attends ta critique avec impatience. Entre toi, Cormary et Le Stalker, on peut dire que la toile regorge à présent de nouvelles approches des oeuvres et des auteurs, loin des analyses pour le moins moribondes, que nous lisons maintenant un peu trop souvent dans la presse.
Quand à l'autre fou : tes robinsonnades, loin de me vexer, m'amusent et me distraient. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Merci pour ce précieux conseil, je vais aller m'acheter immédiatement une méthode Assimil. Je pense même t'en procurer une : tes phrases à rallonge qui ne mènent nulle part, montrent tout autant, que ton niveau en français laisse à désirer. En tous cas, un bon point pour toi : tu es allé sur mon blog et tu as lu quelques billets. Dommage que tu n'aies pu en comprendre que l'écume. A quand la possibilité pour toi de pouvoir me contredire sur des points techniques pointus, comme en sont capables le Transhumain ou le Stalker (que tu vomis, plus par ressentiment et indigence, que par juste raison !)
Allez ! Robinson ! Il en faut des gens comme toi ! Comme le concombre masqué, tu sévis déguisé. De peur sûrement d'être reconnu. Ca n'est pas nouveau ! Les lâches, il y en a eu plein l'histoire, il y en a plein les cimetières, plein les hospices, plein la société. Bonne continuation quand même !
Écrit par : Marc A. | 19/12/2005
Bien sûr que tu nous amuses, cucurbitain cucurbitacé, mon ego hypertrophié et moi, avec tes gesticulations de vache folle et ton aigreur de concombre vérolé, c'est même la seule raison pour laquelle nous daignons répondre à tes éructations. La poubelle qui te sert de blog, vois-tu, participe pleinement, bien plus que celle du Consanguin qui, lui, témoigne au moins d'une certaine vision du monde, au Trou Noir de la Toile. Tu n'es rien mon ténia hâbleur, rien de plus qu'un parasite sournois à l'haleine fétide, un bon gos beauf des familles équipé d'un logiciel de correction automatique, tu n'existes que pour sucer notre sang jusqu'à ce que tu éclates enfin. Vois comme nous rions de ta langue chargée de tréponèmes ! Vois comme nous nous esclaffons à chacune de tes saillies pathétiques ! Ah ! oui, robinsonne, tu es la risée du village. Tu es sans doute laid, repoussant, j'imagine que les femmes vomissent lorsque tu parviens à te faire remarquer à force de grognements.
Essuyons nos pieds sur lui, Marc, ça porte bonheur.
Écrit par : Transhumain | 19/12/2005
Ô Michel ! reviens, ils sont tous devenus fous !
Écrit par : Pan sur le Houellebecq ! | 19/12/2005
L'éboueur aux petits pieds m'a rajouté à sa liste de "superstars" de la blogosphère. Je me retrouve donc à tes côtés cher Transhu. En effet, rions un peu de cette bouse filandreuse.
Écrit par : Marc A. | 19/12/2005
Cher Marc Hallal-Pozzo, je devine chez toi le bon gars, l'absence totale de malice qui te rend beaucoup moins antipathique que ton idôle le Transusu, mais qui t'empêche aussi de voir cher Pozzo di Borgo, qu'il n'a que mépris pour ta personne, derrière les salamalecs de circonstances : il n'a pas nié ouvertement que tu écrivais comme un enfant de huit ans à qui on aurait inoculé le programme de philo de classe terminale. Lui qui prétend rien moins que défendre la survie du Verbe sur la toile - quelle crise de rire tout de même! - il n'est pas beaucoup plus qu'un menteur et un hypocrite, un jour tu en feras toi-même le constat amer, crois-moi...
Transusu, tu as beau débattre comme un noyé tes pinces de manipulation dans le vide,
http://poubellesdelablogosphere.blogspot.com/2005/12/journal-transintime8eme-actualisation.html
rien n'y fait, tu es peut-être doué pour déconstruire toute forme de poésie par ton approche intellectualiste à outrance, foncièrement ennemie de l'art, égocentrée - ne l'évacuons pas trop vite sous prétexte de boutade-, tu n'es doté décidément d'aucune verve, ça ne décolle pas, tu coules, tu ris tout seul. Je t'ai écrasé -reconnais-le au moins, si tu avais un peu le sens de l'honneur tu ferais le sais-plus-quoi, oblitéré comme une punaise sous le talon de mes invecitves, et tu t'es démultiplié, petit cafard cosmique, blatte hologrammatique, tu en a profité pour exponentialisé ton odeur de grille-pain rouillé, et tu continues à gémir en langage binaire, dans ton sabir de toubib, confondant toujours et encore la compulsation et la reproduction des dictionnaires avec l'authentique flux verbal...Tu fais pitié Transenstein (ceci n'est pas une faute de frappe, pas de -I entre le premier -E et le premier -N, c'est au contraire une réussite de frappe, fort juste, précise, un crochet double-uppercut dans tes chicots radioactifs, dans ton ratelier plaqué merde!).
La manière, par ailleurs, dont tu es systématiquement obligé de rajouter des commentaires aux commentaires de tes propres commentaires démontrent que tu as peut-être quelques petits problèmes d'expression (voir tes lamentables et obscures - et surtout inintéressantes -circonvolutions du jour sur le sujet de l'avortement sur ton blog gris-Waterloo, "Temps additionnel").
Avant de prétendre être l'une des seules sources d'informations de la toile, - ce que tu prétens sans rire, rappelons le tout de même, ce n'est pas une mince prétention -précise déjà tes idées dans ton petit cockpit en nickel, et fais nous grâce des méandres de ta "pensée" en temps réel...Oui effectivement, recours peut-être à l'usage du gras, de l'italique et du souligné, ne serait-ce que pour t'aider à savoir ce que tu penses une fois la page html salie par tes éjaculation précoces, tes petits gloires matinales, tout seul devant ton 17 pouces, vainqueur du monde, dilaté du prépuce !!! Tu reproches à Montalte de manquer de rigueur mais commence d'abord pas t'essuyer l'émonctoire avec tes textes obèses, ça portera bonheur à tes défécations, les seules de tes productions qui auront vécu d'une vie réelle...
Mais tu m'as donné un plaisir néanmoins, dans ton impuissance, dans les frocements jubilatoires de l'anus artificiel qui te sert de museau : celui de retrouver des expressions des années 80 comme un "bon gros beauf des familles", ça m'a fait le même effet que d'entendre, sans être prévenu un bon vieux "Still lovin' you" des familles...Toi le post-moderne, étancher ma nostalgie, paradoxe non? Mais si j'ai bien compris tu n'es encore bien dégrossi de de ta province d'extraction...Parles-tu avec un accent, ce serait drôle pour un robot...A nous deux Paris, je suis le Transussu!
J'ai pu aussi approfondir ma connaissance du transhumanisme, en saisissant au bonds quelque étonnante considération : le transhumanisme, pour attirer l'attention des dames, souci qu'on est surpris au passage de trouver sous la plume d'un castrat métagénétique de ton espèce, postule la beauté physique. Etonnant...Serais-tu donc un appollon toi-même Zarathoustra de pixels? Je ne sais pas pourquoi mais j'en doute et quand je vois tes goûts morbides en général et ton avidité à vouloir briller de mille feux revanchards, je me dis que tu ne dois pas tenir la vie en grande estime, et baigner dans un foutu ressentiment!!! Tu es trop dans l'imaginaire mon Shemale porto-ricain, que connais-tu de mon physique? C'est comme tes jugements à l'emporte-pièces sur l'état de littératureuuuuuh en Franceuuuuh, qui reposent sur la lecture de deux christine Angot, un demi Delerm et trois Didier Daeninckx. Le présent gnômique est l'usage des gnômes. Tu portes au pinacle des auteurs -certainement de grande qualité : ce sont en tout cas ceux que tu connais...Alors passe nous tes centuries hard-discount!!!! C'est comme ton "message" (sic) technonaniste : de l'imagination!!!! Cantonnes toi à démouler des "par terre notaire" ou des "et pectoraux", tu feras preuve sinon de sagesse au moins d'un peu de sens du ridicule...
Resicons-le une dernière fois pour rire un peu avant de prendre congès :
"Mon transhumanisme, je l’avais écrit en inaugurant ce blog critique, ne se conçoit qu’au point nodal des enseignements essentiels du Christ et de Zarathoustra". Signé le Transu, le 19/12/2005,
et ce n'est pas un canular consanguin, il 'a vraiment dit le foutre!
Tu veux y revenir pour une nouvelle effraction de ta machoire? Je te préviens la prochaine fois c'est sans anesthésie et sans vaseline!
Come again!
Écrit par : Robinson | 19/12/2005
Cher Robinson des dépotoirs, à quoi cela te sert-il de venir inoculer là ta haine de misérable croupion pestilentiel ? Ton discours jargonneux à souhait qui ne prouve qu'une seule chose, que tu as bien appris par coeur ton gros Robert, ne fait là que te desservir. Crois-moi mon beau couillon de la vie, ton cas d'espèce ne m'intéresse guère, mais tu me fait au fond pitié. T'en prendre ainsi au transhumain qui te dépasse te talonne et t'aplati me fait rire ; tu as raison ! tu es le seul ici à savoir ce que vaut le verbe, la philosophie, la littérature etc. Les crétins pensent toujours savoir plus que tout le monde. Alors ton blog avance bien ? Tu t'amuses bien ? J'ai bien ris lorsque tu m'as aussitôt rajouté à ton machin purulent. Je n'attendais que cela : être aux côtés des stalker et transhu... Pour moi, c'est un honneur...
Continue comme ça, comme je te le disais, tu me fais rire. Ton côté pathétique cache un pôvre gars, un peu désoeuvré... J'imagine que le Maître de cérémonie en découvrant son blog, t'éliminera comme un cafard qui salit tout chez lui... nous n'aurons plus la joie de lire ta prose d'enfant de cinquième, abandonné par sa maman, qui sait à peine écrire, et qui recopie son dictionnaire pour donner l'impression d'être savant.
Ah ! oui ! J'attends toujours que tu déclines ton identité, mon bon Robinson, bien brave ! Mais ça, on peut toujours rêver ! Les merdes comme toi, ça n'a pas de "couilles" !
Ciao punk
Écrit par : Marc A. | 19/12/2005
Non, non pas lâcheté mon petit Al-Peau-d'Zob, mais intelligence stratégique. N'oublie pas que les trous noirs de la déhiiiiiiiseeeeenceuuuuuh sont voraces, c'est bien pour ça qu'ils font peur! Voraces comme la rondelle en allaige du transusu:
http://www.fuckingmachines.com/php/menu.php
Quant au Maître de cérémonie libre en effet à lui de me squizzer (es-tu sûr qu'on trouve ce mot dans le Grand - et pas le Gros Robert, inculte -(c'est beau l'éducation natioanle, tu es titulaire) , tu en auras un quand tu passeras en cinquième, parce qu'on ne pas en dire autant de toi que tu le connais par coeur le Grand - Bébert?), cependant il n'y a que toi, incorrigible Marco lunaire, pour ne pas t'être rendu compte que le MC partage mon avis ur le bonhomme, si ce n'est ma virulence (très supérieure à celle de Transmusicales dans son efficacité, quoique tu incantes, en l'occurence c'est lui le greffier deu Big Bob, enfin lui c'est plutôt le Vidal ...et bientôt l'AAPEL, http://www.aapel.org/bdp/dico2.html, le pauvre homme)...
Dors bien sur tes certitudes et sur le molleton de tes illusions henri salvadoriennes, cybersidvicious de la salle des profs!
Écrit par : Robinson | 20/12/2005
Tiens Alpozzo, toujours prêt à venir mettre son petit commentaire content de soi chez les autres mais surtout pas à la maison : on ne voudrait pas salir ses jolies pages de pensée vide (et on ferme vite pour éviter tout débordement de justesse).
Au moins tu as bien compris où n'étaient pas tes semblables : on ne te voit fort heureusement jamais dans mon cercle d'O.
Écrit par : Newbie Ocean | 20/12/2005
- De « l’homo faber » (cf. Leroi-Gourhan) à « l’animal politique » (cf. Aristote) ;
- de « l'homo naturaliter religiosus » (soit une synthèse possible de « l'homme de paroles » et de « l’animal politique » : cf. Plotin) à l'homo universalis (« l’homme catholique », puis l’homme des Lumières françaises – l'Aufklärung, venu de Luther via les profondeurs de la race, finissant comme prévu dans le régionalisme...) ;
- de « l'homme positif » (cf. Comte) à « l'homo œconomicus » (cf. Marx)
- de « l’homme inconscient » (cf. Freud) à l'homme, disons, ésotérique, au décadent fatigué de l’avant-14, et autre symboliste noyé dans l'absinthe ;
- de « l'homme-masse » (rouge-brun) à « l'homme unidimensionel » (ce consommateur démocrate-culturel : cf. Marcuse) ;
- de l'homme neuronal (cf. Changeux) à l'homme symbiotique (cf. de Rosnay) ;
- de tout ce merdier à l'homme clonique.
Et après ?
Pou ma part, tout comme Le Transhumain sur les pas du REMARQUABLE et LUMINEUX Jean-Michel Truong, je crains même que cet homme clonique, si excellemment dépeint par Houellebecq à en croire Montalte), que ce « dernier surhomme » (pardon Friedrich…) entiché de raélisme (eugénisme, organes de rechange… bref : d’eschatologie) justement parce qu’obsédé de réalisme (« l’homme-produit », c’est d’abord « l’homme-main-d’œuvre »…) n’ait pas même le temps d’advenir… Ou que son règne sera éphémère ; infime pièce qu’il est d’une stratégie plus vaste – cosmique ou satanique, je l’ignore…
Je crois qu’on passera directement de l’homme quoi qu’il soit à l’Intelligence Artificielle ; car la vie n’est pas « être organique », mais « principe d’organisation » (nuance cruciale !). La chair ? Un improbable véhicule... De surcroît, la désincarnation dans TOUS les domaines – de l’économie dématérialisée au post-art abstrait, de l’Etat global aux « grands principes » (idolâtrie que l’amour abstrait de l’Humanité qu’on nous vend de concert avec l’archaïsme sacrificiel des « plans sociaux ») – me paraît d'ores et déjà la simiesque lubie triomphale du moment. Un peu comme si la mimésis (à l’origine de toutes nos déterminations anthropologiques : cf. Girard), en apparence dégradée en utopie du clonisme était en vérité investie par la Machine qui, dans son apprentissage de l’Ennemi, de l’homme (au sens où l’homme est devenu l’Ennemi du « Créateur ») et sa découverte de l’émotion (avec un génie redoutable de la libido, sardoniquement flatteur pour nous !) l’avait même retournée contre nous telle un leurre : l'homme, un sac de données, et le clonisme, l'ultime avatar de la société de l’information.
De la bête monothéiste au prédateur monomane ? Pas même… Prométhée chair à canon, mieux : carburant de la Machine (comme dans Matrix ?). Voilà ce qui nous pend au nez, et que le clonage imminent accélèrera tout au plus, jusque que, très vite, la Machine se passe de nous, inutiles bêtes à carapaces qui finissons à poil.
Voilà. Pardon pour la confusion de ce texte écrit à la va-vite avant d’aller dormir : lisez plutôt Truong, Totalement Inhumaine, Les Empêcheurs de penser en rond, 2001. Bonsoir, ceux d’ici-bas !
Écrit par : Guit'z | 20/12/2005
"intelligence stratégique" : ah ! ah ! ah ! De l'intelligence stratégique ! Un liliputien de la pensée comme toi !
Pôvre décérébré de bazar : "gros" robert était un jeu de mot. Mais des imbéciles de ton genre ne peuvent pas comprendre. Au moins tu connais Sid Vicious, tu n'es pas complètement abruti... enfin ! à voir !
Newbie, le jour où tu me vois dans ton cercle d'O pour mous du citron, ce ne sont pas les poules qui auront des dents mais les escargots. Tu ne présentes aucun intérêt à mes yeux, au même titre que l'autre Rinbinson égaré dans son île aux enfants.
Bon ! Y a Guit'z qui rehausse le débat... c'est déjà pas si mal !
Salut les clodettes !
Écrit par : Marc A. | 20/12/2005
Dans la transhumanité avancée, les escargots dentues c'est pour demain.
Mais n'insiste pas, je ne veux pas de toi.
Écrit par : Newbie Ocean | 20/12/2005
Merci Guit'z, pour votre message plus relevé. On va encore m'accuser d'égocentrisme, mais avez-vous lu mon article sur Totalement inhumaine ? C'est ici : http://findepartie.hautetfort.com/archive/2005/04/20/totalement_inhumaine.html
J'avais aussi interrogé l'auteur, sur cette liste. Vous pouvez trouver mes questions et surtout les réponses de Truong ici : http://www.jean-michel-truong.net/totalement_inhumaine/page/Forummg3.html
et ici : http://www.jean-michel-truong.net/totalement_inhumaine/page/Forummg4.html
Robinson, ma limace visqueuse, tu sais quoi ? Je n'ai même pas lu ta dernière diatribe jusqu'au bout, et m'en tiendrai là. Qu'est-ce que tu croyais, avorton ? Que Marc et moi allions nous mettre à nous lamenter, à implorer le ciel de nous faire aussi intelligent que toi ? Que nous allions en faire des cauchemars ? Appeler la police ? Faire un ulcère ? Distribuer des tracts ? Nous pendre avec le cordon de notre clavier ? Remplir des pages et des pages de contre-pastiches ? Poser une bombe ? Renier notre origine provinciale ? Tomber raides morts à la suite d'une crise de tachycardie ? Signaler ton adresse IP à la CNIL ? Aux RG ? Ecrire à Chirac ? A Sarkozy ?
Hé ! Ho ! C'est bien toi qui parlais d'ego hypertrophié ? AH AH AH AH AH AH ! Mon pauvre ami, sitôt sorti de ces commentaires je t'oublie comme j'oublie mon étron du matin. Mais c'est bien, continue donc, bouffon, les bilieux dans ton genre passent vite l'arme à gauche, rongés par leur propre poison. Ah ! à propos, je ne t'ai traité de beauf que pour ta très fine, que dis-je, ta génialissime trouvaille... Mais si, souviens-toi, le "travelo" digne des plus grands insultes de Bloy et de Schopenhauer !
Quant à Marc, que je salue au passage, s'il serait plus avisé de mieux corriger ses textes un peu trop émaillés de fautes (comment le nier ?), il reste un intervenant infiniment supérieur à la bouse qui te sert de cervelle, la Robine. Quand lui cherche à nous communiquer quelque chose et n'a de cesse d'enrichir son esprit, tu n'as pour ta part d'autre but, et d'autre capacité, que de déverser ton lisier puant sur la Toile. Mais qui es-tu, à propos ?... Jusqu'à preuve du contraire, tu n'es qu'une cyber-racaille, parasite aussi nuisible que les cohortes de skyblogueurs qui nous polluent la vision. Ah ! Il ne suffit pas, mon con, de brandir le poing et de crier victoire pour gagner une bataille. La seule chose que tu as gagné, c'est la palme du ridicule.
Mais... mais ! Oh mon Dieu, non ! Comment pouvais-je savoir ?! Robinson, je sais ! TU ES JESUS REVENU PARMI NOUS POUR NOUS DIRE LA SEULE, LA GRANDE, LA VRAIE VERITE !
ALLELUIA !
ALLELUIA !
ALLELUIA !
Vite ! Une croix !
Écrit par : Transhumain | 20/12/2005
Allah ! Allah ! Allah Akhbar !
Écrit par : Ala-din et la lampe merveilleuse | 20/12/2005
Transhumain, n'en fais pas trop quand même, il y a un peu de jaunisse dans ton rire (et qu'avez-vous tous avec vos "HA HA HA HA, vous n'avez pas l'impression que c'est la dernière chose à faire pour l'emporter sur quelqu'un ? Un jour, il faudra que je donne des cours de vannes, les vraies, celles qu'on n'oublie pas, qui nous défigurent la vanité. Esther était la meilleure à ce jeu. Robinson n'est pas mal non plus. Le Stalker y était complètement nul, et moi, je suis plus fort que toi là-dessus. Tiens, tu vois, tu as déjà un petit pincement derrière la nuque..... Bref, bref, bref. Je n'étais pas venu faire le déplaisant mais l'éloquence, le verbe, le frétillement de tuer pour un bon mot, tu vois.... Sinon, je constate en revanche que tu ne te prives pas de faire ta petite publicité sur mon blog - ce qui d'une certaine manière est fort flatteur (pour toi et pour moi) et ne choque pas du tout ma déontologie bloggeuse. En tant que voisins de colonnes, nous nous devons bien ce genre de service n'est-ce pas - même si, je le reconnais, c'est un peu dégoûtant de collaborer avec une tronche de cake comme la mienne. Toi et moi, c'est un peu D2 R2 et Jaba dans le même vaisseau, Joseph en étant le Han Solo et Marc l'Obi wan. Bon, je vois que cela ne t'amuse pas, tant pis. Le cirque continue...
Là, je vais aller voir "La saveur de la pastèque".
Écrit par : montalte | 20/12/2005
Hum, pour la vanne qui tue, tu reviendras Montalte - cela dit je compte sur toi pour m'adouber lorsque Joseph nous réunira... J'en profiterai pour te donner quelques tuyaux sur le clonage...
Et puis j'aime bien R2D2. Mais Robinson, il est quoi ? Morpion de Chewbacca ?...
Écrit par : Transhumain | 20/12/2005
Penserez-vous la même chose que moi de la Saveur de la pastèque, M. Cormary ? Ou bien sommes-nous décidément et irrémédiablement condamnés à ne nous entendre sur rien ?
Ne me faites pas trop languir : je suis au bord de l'anxiété.
Écrit par : George Kaplan | 21/12/2005
Eh bien, un film relativement décevant. De Tsai Ming-liang, je ne connaissais que The Hole que j'avais bcp aimé. Là, en dehors de la scène d'ouverture, la pastèque masturbée ! et de la dernière, la déglutition fellatoire pourrait-on dire, le reste m'a semblé un exercice de style un peu vain, presqu'ennuyeux. J'aime pourtant bien le sujet typiquement "asiatique" où l'on invente une nouvelle "perversion" (un peu comme ce qui se passait dans "The Pillow book" de Peter Greenaway) ici donc à partir de la pastèque qui sert à peu près à tout. Quelques beaux plans "vaginaux" des halls et des couloirs mais pas mal de longueur dans un récit où l'on se se demande où il veut en venir. Dommage car la "bande"-son est extraordinaire et si j'ose dire n'a jamais mieux porté son nom. Mais Les scènes chantées, tellement féeriques dans The Hole, fonctionnent une fois sur deux. Cela dit, par rapport à nos Breillat et nos Chéreau, et pour qui s'intéresse à la représentation sexuelle au cinéma, cette pastèque l'emporte largement sur nos navets. Npn, c'était pas mal quand on y repense...
Écrit par : montalte | 21/12/2005
Robinson ? Mon cher Transhu, il est mort !
Écrit par : Marc A. | 21/12/2005
Ah ! Montalte, je n'ai pas encore vu La Saveur de la pastèque, mais il faut que tu voies ses autres films, tous très beaux, très sensuels, et tous avec son Léaud personnel, Lee Kang-sheng !
Je t'en rappelle les titres : "Les rebelles du dieu Néon", errance autiste et urbaine ; "Vive l'amour", magnifique et sensuelle dérive de trois personnages, dont Lee Kang-sheng qui squatte des apparts à vendre (idée reprise par le coréen Kim Ki-duk dans "Locataires") ; "La Rivière", superbe évocation des rapports filiaux (formellement très abouti, mais on pourra lui reprocher certains tics postmodernes très en vogue en Asie il y a quelques années : je pense par exemple à l'étrange infirmité du héros, ici victime d'un douloureux torticolis) ; tu as déjà vu "The Hole", que j'avais modérément apprécié à sa sortie mais auquel je pense souvent ; dans "Et là-bas, quelle heure est-il", Tsai Ming-liang confronte son Léaud au vrai Léaud... Intéressant, mais un peu vain ; enfin, "Goodbye, Dragon Inn", chassé croisé quasi muet d'homosexuels dans une salle de cinéma de quartier : aussi comique que très triste. Ici, le réalisateur semble s'amuser de ses propores gimmicks : ainsi ce n'est plus Lee Kang-sheng qui claudique, mais l'ouvreuse du cinéma. Sur l'écran, les acteurs du film de sabre reviennent sur leur passé, et les couloirs du cinéma recèlent quelques fantômes. Je crois que c'est l'un des plus beaux films sur le cinéma. Lire l'excellent commentaire (le premier dans la liste, un certain "rbresson") d'un internaute sur allocine : http://www.allocine.fr/film/critiquepublic_gen_cfilm=53805&ccritique=18417442.html.
Écrit par : Transhumain | 21/12/2005
Le problème avec vous, Transhumain, c'est que vous tombez si rapidement, au moindre débat, à la foire d'insultes - cf vos derniers messages - qu'il faut une bien grande volonté pour vous prendre au sérieux. Non que la grossièreté n'est rien à faire dans le débat, mais, comme l'expliquait Schopenhauer, l'argumentum ad personam se doit d'être utilisée comme "ultime stratagème", lorsque, sur le front des idées, l'on est en passe de perdre la face. Et encore, voyez-vous, pour une attaque personelle, il vaut mieux une petite phrase bien affutée et qui gratte là ou ça fait mal, plutôt qu'une demi page d'insulte que l'on pourrait adresser à tout le monde, i.e., qui ne touche au final, personne.
Et pour le coup, j'aurais pu commencer ce billet par "le problème avec vous, Marc A." ou "le problème avec vous, Robinson".
Écrit par : Papy | 21/12/2005
Sinon, au passage, très bien, ton billet sur Houellebecq, mon cher *Montalte.
Écrit par : Papy | 21/12/2005
Mes félicitations, le cacochyme, votre verbe élégant et racé nous a tous touchés en plein coeur. Je rappelle tout de même que tout est parti d'une bouse de troll abandonnée bruyamment par certain clochard numérique...
Écrit par : Transhumain | 21/12/2005
"
La fameuse phrase de Cioran, « les enfants que je n’ai pas eus, s’ils savaient le bonheur qu’ils me doivent » n’est plus une phrase d’humeur qui nous console de la rudesse de l’existence, mais bien un programme moral doublé d’un nouveau planning familial.
"
Ne serait-ce plutôt " les interprétations qu'il n'a pas lues sur ses phrases ! Si l'auteur savait le bonheur qu'il me doit "
Écrit par : La Mort | 24/12/2005