Le social, combien de divisions ? (A propos des Terres mortes de Gabriel Boksztejn) (07/09/2025)
Sur La Revue des deux mondes, le 28 août 2025
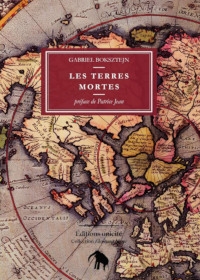
On en attend des livres comme ça. Qui font rendre gorge à l’époque, qui scalpent ses valeurs, sa morale, ce qu’elle imagine être son bien. Si la loi punit les méchants, la littérature corrige les gentils. Par nature, un romancier ne saurait être progressiste. Dans la lignée de Patrice Jean (qui préface l’ouvrage), Marin de Viry, Fabrice Chatelain et avant eux, un certain Michel Houellebecq, voici Gabriel Boksztejn, nouveau bourreau du bien, satiriste impitoyable hautement comique et styliste comme on croyait qu’il n’en existait plus.
Si « tous les grands romans, d’une manière ou d’une autre, ont toujours été des infidélités par rapport au contrat social d’une époque donnée », comme l’affirmait Philippe Muray dans Exorcismes spirituels IV et que « trahir le contrat social qui nous est imposée par les charlatans de l’heure est l’essence même de l’expérience romanesque actuelle », alors Les Terres mortes en est un et des plus méchants et réjouissants de ces dernières années.
Un monde sans pitié
Rien ne va plus dans la petite bourgade de Saint-Lô. Il y a Pierre-André, le directeur triomphant du supermarché Martin et qui se procure des « jouissances occultes » à écraser de sa superbe ses subalternes dont font désormais partie son frère Bernard et sa belle-sœur Émilie que Pierre-André a embauché par pitié, couple de losers qu’il aime humilier lors du gigot dominical – et qui lui fait oublier Marc-Antoine, son directeur adjoint qui n’attend qu’un prétexte pour le faire tomber et prendre sa place. Il y a Jamil, musulman gay, rejeté par sa famille pour cette raison. Et Hichem, « l’arabe de droite » qui ose ne pas se reconnaître dans le combat décolonial auquel on veut l’assigner et que l’on finira par pousser au suicide – car rien de pire, aux yeux de l’antiraciste que le racisé qui ne joue pas le rôle qu’on attend de lui. Enfin, il y a Louis, le normalien marxiste, promis à une brillante carrière de gauchiste impitoyable et qui, au nom du mouvement politique qu’il vient de créer, La Nouvelle Action Directe, a toute latitude pour assouvir tous les crimes sociaux et symboliques dont il rêve en secret pourvu qu’ils servent la cause et même s’il a du mal à s’avouer l’excitation que lui procure la belle Naïma qu’il aime d’un « racisme inavouable, hypocritement inversé en fantasme de la belle Orientale » – et qu’il a piqué à son frère Adrien. Ce dernier, notre personnage préféré, c’est l’écrivain raté, spectateur impuissant de tout ce mal banal qui l’entoure mais de cette « banalité qui impressionne » et qui est le fait moins de salauds objectifs que celui, autrement plus pernicieux, de salauds moraux, arrivistes de la vertu, fascistes du bien, ce qui sous la plume de Boksztejn, devient pléonastique.
« Je vous connais, se disait [Adrien]. Je sais, dans les couilles de votre Bien adoré, les songes génocidaires ! Vous bandez de morale, nous dévorant pour bander et bandant de nous digérer dans le ventre de vos principes. Une tête coupée par-ci ou un camp d'extermination par-là, enfin, le beau progrès vous regarde. Choisis ta cause, camarade ! ».
Pauvre gauche, aussi, engluée dans son réductionnisme social, hors de tout sacré, de toute métaphysique, de toute poésie, la grande affaire d’Adrien – et qui a même perverti Naïma, nouvelle passionaria des opprimés et qui s’est mise à croire aux promesses militantes :
« La vulgarité de pareils émois déconcerta Adrien. Seule grâce là-dedans : ces illuminés sont les premiers fusillés dès que leur cause triomphe, à l'heure où on exécute les partisans honnêtes, les intransigeants trop probes, les insurgés de salon qui répugnent à ce que la médiocrité reprenne ses droits. Ces victimes du futur rejoignent ainsi l'unique confrérie, celles des assassinés. Naïma était peut-être une demoiselle de cette race-là, celle des pendus à venir. »
Comme dans Les Dieux ont soif d’Anatole France, les révolutionnaires se dévorent entre eux, les progressistes se bouffent. À la lettre, et selon le mot de Muray, Boksztejn « prend le Moderne la main dans le sac, en train de se crêper son propre chignon ». Intersectionnalité qui finit par exploser à la gueule de chacun. Blancs de gauche contre beurs de droite. Bourgeoises musulmanes contre musulmanes lesbiennes. Lutte des classes contre les sexes et des sexes contre les races. Bellicismes justiciers à n’en plus finir – chacun se retrouvant discriminant ou discriminé potentiel. « Jusqu’où diviser, et par combien de barrières, pour se protéger de toute altérité ? À partir de combien d’exclusions se retrouve-t-on entre nous, et ce “nous“ constitue-t-il une identité ? » finit par se demander Louis, lui-même en passe d’être broyé par le système à cause d’un mot malheureux dans une émission de Cyril Hanouna. Le social, combien de divisions ? Très remarquable intuition de Boksztejn sur le fait que l'on ne perçoit jamais les bouleversements quand ils nous arrivent. En bon athée de l’événement, et comme tous les volontaristes qui considère que seule sa volonté suffit à plier la réalité, et qu’au fond, « la réalité, c’est [lui] », Louis ne comprendra pas sa chute.
C’est que la réalité, dont tout le monde se gargarise à droite comme à gauche, ne fait plus partie de nos catégories mentales. Le social nous a tous atomisés, zombifiés, décivilisés. « La civilisation était redescendue à l’état de société » et l’humanité à sa plus basse échelle. On a perdu en sens tragique ce que l’on n’a même pas gagné en humanisme. Aucune vertu qui ne soit en effet dans Les Terres mortes un vice déguisé. Struggle for life au sein de l’extrême gauche qui réinvente le patronat (moral) à sa manière. Misandrie et même misogynie au sein même du néoféminisme. Tout n'est que plus que dévastation du bien par le bien. Monde sans pitié à force de tout vouloir rendre juste et équitable. À la fin, ne reste plus que « le bruit du temps » sublimée par la musique de Boksztejn.
Illusions perdues
Car Les Terres mortes ne sont pas simplement un pamphlet contre l’époque mais aussi et surtout le surgissement d’une écriture inouïe, « nouvelle », si tant est que la nouveauté soit possible en littérature.
Inspirée, de l’aveu de l’auteur lui-même, par la tragédie humaniste, ce genre théâtral de la Renaissance fondée sur un monologue intérieur, souvent douloureux et véhément, ce que l’on appellera plus tard le « flux de conscience », où la présence prime sur l’action et la parole sur le récit, ce premier roman s’impose d’abord comme une expérience de lecture qui pourra en défriser plus d’un. Pas simple en effet d’être pris à partie par un texte vocatif qui joue sans cesse sur les lamentations tragicomiques de ses personnages, prenant le lecteur / spectateur à partie, l’obligeant à être le témoin passif, donc coupable, de ce qui se passe. D’autant que l’auteur, avec un sadisme tout fassbindérien qui l’honore, ne nous épargne rien. Des ébats homosexuels entre arabes aux ennuis intestinaux de Pierre-André qui se découvre un cancer de l’estomac en passant par l’envie pressante qui prend une comédienne en plein milieu d’une tirade de Phèdre (surtout « ne pas accélérer, ne pas avoir les vers qui sentent l'urine »), le corps est là, vibrant dans « sa vie fumante, biologique, qui sent la merde » – autant de choses qui terrifient Adrien et sans doute l’empêchent de se mettre à l’ouvrage, noyé qu’il est dans sa culture, sa grammaire, son infinitif et son passé simple « à la tête froide ». Adrien qui voit son ancien ami Thomas triompher chez Gallimard pour un mauvais livre mais un livre qui compte, qui plaît aux masses, décomplexifiant sciemment la réalité – condition sine qua non pour l’éditeur de ne pas être en déficit. Alors que lui, « rien, pas même un début de mauvais livre », incapable de dire quoi que ce soit de cette société idéologisée jusqu’à l’os et pourtant plein d’une poétique qui lui permettrait, s’il osait, d’exprimer les réalités cachées du monde, sinon les catabases de l’être – et en premier lieu, les siennes. Chant des ferrailleurs. Notes du sous-sol. Rêves de femmes verlainiennes. Quel meilleur personnage pour un écrivain que celui d’un écrivain qui n’arrive pas à écrire ? Et quelle meilleure façon de sortir de ses propres points de suspension, slashs, interjections et autres mouches d’Euménides en y enfermant son propre héros comme dans un épisode de Black Mirror ?
« Maintenant/…/de nouveau/…/des absences/…/et les pensées qui se rompent/…/de nouveau, de nouveau, de nouveau, de nouveau, et ce hurlement qui vous/…/parcourt les veines/…/à bout de souffle/… /Aaaaaah !!!!Aaaaaaaaa !!!!! Soleil, soleil, étrangle-moi, soleil/…/flingue sur la tempe/…/ et se faire sauter la cervelle 10 000 fois jusqu’à ce que/…/à bout de souffle/…/la douleur s’estompe/…/que les voix douloureuses/…/n’irriguent plus celui qu’il est/…/Vite, se flinguer 10 000 fois/…/ Encore ! Et encore ! Et encore ! »
La typographie qui sort de ses gonds, les fantaisie langagières poussées jusqu’au paroxysme, le lyrisme jusqu’à l’obscène. D’aucuns pourront reprocher à l’auteur de s’emballer ici ou là, sacrifiant son récit à la pure intensité formelle. Mais tant pis ! C’est le prix à payer pour apprécier à sa juste valeur cette satire épique, menée tambour battant par une écriture infatigable, surinspirée, d’une ambition folle et qui ne se relâche jamais au risque d’épuiser le lecteur. À côté de celle-ci, toute autre écriture parait bailler, s’ennuyer, rajouter au néant. Alors que celle de Boksztejn réveille la prose française. Et si Les Terres mortes est le dernier livre de la collection Éléphant blanc (et sans doute celui à la plus belle couverture), tenue de main de maître par notre cher Etienne Ruhaud depuis des années, celui-ci pourra se vanter d’avoir conclu celle-ci avec un futur classique.
A commander sur le site Unicité, ici

13:02 Écrit par Pierre CORMARY | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gabriel boksztejn, premier roman, philippe muray, patrice jean |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer