Platon / Dixsaut V - L'un et le multiple (27/09/2025)

Monique Dixsaut par Louis Monier
21 – Un et multiple
Livré à lui-même, l'Être ne vaut rien. À lui comme à n'importe quelle chose sensible, il lui faut du mouvement et du repos, du même et de l'autre, de l'unité et de la multiplicité. Parménide avait enfermé l'Être en lui-même. Les Sophistes l'avaient réduit au langage. La tâche impossible de Socrate est de trouver ce qui va permettre de penser l'Être sans le trahir ni le néantiser. Pour cela, le réenraciner dans la parole et le réel. Trouver une parole du réel – si tant est (tenté ?) que cela soit possible. Un dit du soi – sinon un digne de soi. Faire du Logos un mode, un genre, une énergie... un commencement. Platon Johannique ?
Et c'est le chapitre V L'un et le multiple de Platon, le désir de comprendre, de Monique Dixsaut qui commence. Balèze.

MI1 (Brian de Palma, 1996)
22 – Être et temps (Parménide 1)
« Il n'y a de science véritable que celle qui procède dialectiquement ». Nous voilà prévenus.
La méthode qui permet de discerner à coup sûr la vérité consiste à poser l'existence de chaque chose en tant que telle – ce qu'elle est en « un » – mais aussi son inexistence. La raison en est que s'il n'y a que de l'être, ou que de l'un, on ne le discerne pas. Il faut autre chose pour voir ce qui est. Soit du multiple : par exemple, d'autres couleurs pour discerner une couleur. Soit, et c'est là que ça se complique, du non-être pour discerner l'être. Exemple facile mais fameux : c'est grâce à la nuit qu'on discerne le jour et réciproquement.
L'être-un, tel que l'avait posé Parménide, « d'un seul tenant », ne suffit pas. En effet,
1 – Si l'un n'est qu'un, alors il n'est rien. Ou si l'on préfère, il est quelque chose, lui-même, mais on ne le saura jamais, on ne le verra jamais.
2 – Si l'un est au sens plein, au sens « pour tous », alors il est tout. Et on ne le discerne pas plus, lui comme les autres.
Non, il faut à la fois qu'il soit mais qu'il y ait autre chose « qui ne soit pas » et qui serve à voir ce qu'il est.
Le problème est logique :
1 – Il faut du non-être pour saisir l'être.
2 – Mais pour qu’il y ait du non-être, il faut bien qu’il y ait un être du non-être. Car dès que l’on dit que quelque chose est, y compris une négation, le néant ou Alfredo Garcia, il faut bien que chose ou cette non-chose ou cette anti-chose ait son être. Qu'est-ce donc que cet « être » du « non-être » – concevable en logique mais inconcevable en concept ?
Non, il faut sortir de cette aporie. Et pour cela, faire un pas en avant, en arrière ou de côté. En fait, il faut bouger. Se mettre en mouvement. Mettre l'être en mouvement. C'est-à-dire en temps. Contacter le temps. Le temps peut nous aider. Le temps concerne l'être comme tout un chacun. Avec le temps, quelque chose se passe entre l'être et lui-même et entre lui et les autres. Dès que je suis dans le temps, et j'y suis tout le temps, je suis en mouvement, en relation – en liaison. Le temps sera la liaison de l'être – et accessoirement celle du non-être. Car ce qui était il y a un instant ne l'est plus – tout en l'étant encore. La rivière héraclitéenne dans laquelle on ne se baigne jamais deux fois etc.
Le temps, liaison de l'être.
Le temps, lésion de l'être.
Le temps, fêlure ou devenir des choses, comme on veut.
Le temps comme ce qui rend raison de l'être et pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut être que dans le temps. Un être hors temps ne s'entend pas. [Dieu ? C'est autre chose.] L'être ne peut être que dans le temps – et par extension, l'être ne peut-être que temps. L'être (discernable, saisissable, vivable) est temps. L'être-temps. Ça vous fait penser au nazi charmant de la forêt noire ? Moi aussi.
Il y a quand même une confusion. On est parti de l'un et subrepticement on est passé à l'être. Quelle différence entre les deux ? Qu'est-ce que l'un ? Qu'est-ce que l'être ? Mince. On est obligé de tout recommencer. C'est ça, la philosophie.
À première vue, l'un serait plus abstrait, ou plus normatif, ou plus généraliste que l'être. Certes, ce dernier possède aussi son aspect abstrait mais a quelque chose d'autrement plus génétique, (ré)générateur, fécond, verbal (au sens johannique) que l’un. D’ailleurs, au commencement était le Verbe, non l'un. L'un est une déduction de l'être. Une dénomination. Un nombre. Un truc pour compter – un quantitatif. Alors que l'être, on le sent comme ça, c'est du qualitatif, de l'esprit, du sang peut-être, du sperme, de l'ovule.
Par ailleurs, on vient de le dire et on le redit, comme avec tout le reste, l'être précède l'un. Il faut qu'il y ait un être de l'un pour pouvoir penser l'un. Dès que l'on pense quelque chose, on pense son être. Chaque mot, chaque lettre a son être.
L'un n'est donc pas l'être. L'un a besoin de l'être qui a besoin du temps. L'être met les choses dans le temps et de fait les dénature, les déperfectionne, les dépurifie – en langage chrétien, les fait chuter dans l'existence réelle. Un un qui serait purement un, en rapport avec rien, serait inaccessible, indéfinissable, innommable au sens propre. L'être est ce qui permet la relation, la participation. « Affirmer l'être de l'un signifie autre chose qu'affirmer simplement l'un, c'est affirmer la participation de l'un à l'être. Quand on pose l'un-qui-est, c'est une totalité qu'on pose, ayant comme parties l'un et l'être », précise Dixsaut. Dit autrement, on passe de l'un immuable et inconcevable à l'un-qui-est, en mouvement et concevable.
L'être est ce qui permet donc la participation de toutes choses avec lui-même, autrement dit de l'un avec le multiple, participation qui se fait dans le temps – qui n'est autre que lui sous un autre mode.
Alors évidemment, tout cela paraît compliqué, redondant et bavard, et ça l'est certainement. Être / temps / participation, on a l'impression de répéter cent fois la même chose – alors que l'on est en train de construire la pensée. Et se rendre compte que celle-ci est profondément tautologique. Cela se répète parce que cela est vrai. Cela s'emboite parce que cela se comprend. Cela revient parce que cela se remémore. Surtout, cela devient de plus en plus réel. Plus on pense, plus on est dans le réel. Cet être-un se révèle un couple diablement opératoire, efficace, érogène ! De l'un à l'être, on est passé du nombre au verbe et on a compris que le verbe précédait l'un (je n’ose dire le sujet).
Mais qui dit couple dit deux. Et peut-être bientôt trois. Et pas seulement au sens « familial » ou « filial » du terme mais au sens ontologique. Rappelez-vous les groupes. Une chose = un être. Une autre chose = un autre être. Mais les deux choses ensemble = un être de ces deux choses. Pareil avec le couple être-un. Il y a l'être, l'un, l'être-un et donc en toute logique l'être de l'être-un. Un, deux, trois. C'est une théorie des ensembles, ni plus ni moins
Monique est plus claire que moi sur ce point :
« L'un-qui-est se morcelle donc, ou se multiplie à l'infini. Car si l'un et l'être sont un couple, il y a deux, et s'ils sont différents l'un de l'autre, IL FAUT POSER LEUR DIFFÉRENCE COMME UN TROISIÈME TERME. À partir de là, on a tous les nombres, ordinaux et cardinaux. L'un-qui-est engendre ainsi à la fois le continu spatio-temporel et les nombres, donc la discontinuité ».
Et la discontinuité, la succession, c'est la réalité du temps. Les nombres sont abstraits mais ce sont grâce à eux que l'on calcule le temps. Mieux, ce sont grâce à eux que l'on va saisir le réel dans son unicité et sa multiplicité. Et là, on a vraiment avancé – car on est passé des Formes abstraites, réalités insaisissables aux réalités saisissables. À la lettre (à la l'être !), on est passé des réalités idéelles aux réalités réelles. La vérité est au tautologique, on vous dit ! La tautologie est la mission impossible de la philosophie.

MI2 (John Woo, 2000)
23 – Le Tiers-exclu (Parménide 2)
Reprenons.
L'un a besoin de l'être qui a besoin du temps. Chacun trouve sa réalité dans l'autre. L'un l'autre l'être ou l'un l'être l'autre. Il y a passage, mouvement, présence – acte de présence ou présence en acte. Quelque chose qui passe et qui fait que quelque chose se passe. Quelque chose qui « fait » monde – ou qui rend ce monde habitable. « Un-qui-est ». Réalité qui apparaît du moins en partie. On ne saura jamais exactement ce qu'est celle-ci en soi mais on pourra en avoir un semblant d'idée largement suffisant pour y vivre. On pourra même en parler. Comme le dit Monique, « dans ce monde-là, on peut raconter des histoires, et même l'Histoire, mais on ne peut rien connaître - ou plutôt connaître s'identifie à retracer un devenir qu'on pose comme étant la seule réalité de la réalité et de chaque réalité ». Cela peut paraître inutilement compliqué mais ça pose toute l'histoire de la philosophie idéaliste de Platon à Hegel en passant par Kant – à savoir que le réel en soi (la chose en soi) existe mais n'est perceptible que dans ses apparences – ses phénomènes – et l'usage qu'on en fait. On ne connaît des choses que leurs apparences et ce à quoi elles vont nous servir. Tout sera donc empirique ici-bas – et l'on pourra parfaitement se passer de dialectique. Adieu donc à la vérité. À l'être en tant qu'être. Au « en tant que ». Les sophistes ont le dernier mot et c'est très bien comme ça.
À moins que...
À moins que l'on ne se soucie vraiment du vrai. Du vrai vrai. Du vrai bien. Du vrai beau. Dans ce cas-là, il va falloir dialectiser – c'est-à-dire distinguer. Sortir de la poussière du multiple, de l'amas des choses, de leur évanescence – de leur irréalité. Non, la chose n'est pas simplement empirique, sophistique, fantomatique. La chose a sa différence, sa singularité, son propre. La chose n'est pas un rêve comme la vie n'est pas un songe (et même s'il est séduisant de le penser). Il faut sortir de son rêve – de sa caverne. Il faut ouvrir les yeux. Il faut tenter de comprendre, au moins apophatiquement, la chose. Tenter son unité. Son être. Ce qu'elle est mais surtout ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle est par ce qu'elle n'est pas. Dès lors, retomber dans ce qui peut paraître très irritant, insignifiant, enculage de mouche (et qui moi me passionne et c'est en ce sens que je me sens platonicien), à savoir ce fameux être du non-être, cet être du « ne...pas ».
Dire que quelque chose n'est pas revient en effet à poser un être de ce « n'est pas ». Il faut un être du non-être, un être du néant, un être du rien pour saisir l'être – et accessoirement sortir du jeu sans fin de la sophistique où le snark est un boujeum, où rien n'est jamais stable ni définissable, où tout n'est que simulacre et simulacre de simulacre.
Au fond, la philosophie a été inventée pour contrer les sophistes. Si on était resté dans le pur empirisme – dans la pure matière « pré-socratique » – on n'aurait pas eu besoin de philosophie. Seulement voilà, à force de de dire qu’aucune chose n’est en tant que telle et que tout bouge tout le temps, les sophistes nous ont frappé d'irréalité. Or, nous avons besoin de réalité. Les choses ne sont pas qu'écran, pellicule, cinéma. Il faut poser la possibilité d'une détermination, d'une condition de possibilité d'existence, d'une hypothèse réelle. Il faut poser l'hypothèse de la réalité !
Et pour cela, penser ce non-être que l'on peut appeler aussi le « tiers-exclu ». Ouf !
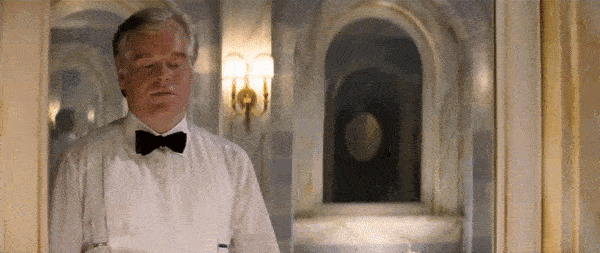
MI3 (J.J. Abrams, 2006)
24 – Et maintenant Le Sophiste.
« Pour capturer le sophiste et le différencier du philosophe, il faut prouver l'existence de l'image, du faux et du non-être, existence qui va transformer celle de l'être lui-même. »
L'être pur ne suffit pas. Tout comme d'ailleurs n'importe quel concept, entité, valeur. La vérité pure ne suffit pas. La liberté pure ne suffit pas. Même la réalité pure ne suffit pas. Il faut à chaque chose sa contradiction, sinon sa négation, pour que celle-ci existe – ou du moins apparaisse. Il faut de la nuit pour comprendre le jour. Ceux qui n'aiment pas la philosophie, ou qui s'en désintéressent, sont ceux qui ne comprennent pas que le réel a besoin d'une médiation pour être compris comme tel. Cette médiation, compréhension, intuition, s'appelle dialectique. Il faut dialectiser le réel pour le comprendre. Et dialectiser signifie mettre du faux, passer par le faux. À la lettre, le faux est une étape du vrai. Le non-être est une étape de l'être. Le parricide est une étape de la philosophie.
Platon, parricide de Parménide.
Parménide (le Père) avait dit : l'être est, le non-être n'est pas.
Platon (le Fils) va dire : pour que l'être soit, il faut le distinguer de ce qu'il n'est pas. Il faut donc admettre le non-être, le reprendre, le reposer – autrement dit, lui donner un être.
Du Père au Fils, on passe de la logique à la dialectique, de la clarté éblouissante (fiat lux) au clair-obscur (logos), du vrai aveugle à celui qui a recouvré la vue. La dialectique est le miracle de Platon.
Par ailleurs, le Père se trompait. Son principe de non-contradiction se contredisait. Poser le non-être comme n'étant pas était une antinomie. Dès qu'on dit quelque chose, on pose, suppose, appose, l'être de cette chose (même si celle-ci n'existe pas en tant que telle, par exemple la licorne.)
Pareil avec l'un. L'un ne peut être seul au monde. Ou s'il est seul, c'est qu'il n'y a pas de monde – donc personne pour le penser. Dieu devait se sentir bien seul avant le monde. Dieu a sans doute créé le monde pour ne plus être seul. Mais en créant le monde, Dieu s'est dédoublé, démultiplié même, et même triplé (trois personnes toussa).
Dire l'un, c'est distinguer celui-ci d'autre chose. Autrement dit, dire l'un, c'est dire deux. Allons plus loin : dire l'un, c'est dire que l'un a un être. Cet être donne à l'un sa réalité (conceptuelle, réelle, comme on voudra) mais ce faisant prouve qu'il est autre que l'un. Donc, l'un a besoin de cet autre qu'est l'être pour être. L'un se croyait seul avec lui-même, il se retrouve avec deux autres concepts : l'être et l'autre. L'un implique le deux qui implique le trois. L'un se complique la vie. La totalité devient altérité.
« Chacun dépasse la vérité en cent mots », disait Kafka. En effet et il n'en serait en être autrement. Dire quelque chose, c'est à la fois lui donner de l'existence et la galvauder. C'est le drame de Moïse et Aaron. Moïse ne dit rien car dire serait gâcher Dieu mais s'il ne dit rien, Dieu ne sera jamais connu du peuple. Donc, il faut un bonimenteur pour dire Dieu au peuple. Il faut Aaron. Il faut Cyril Hanouna.
Dire, c'est nommer. Et nommer, c'est multiplier. Ce produit de la nature que je mange, je vais l'appeler fruit. Ce fruit, je vais l'appeler pomme, cette pomme, je vais l'appeler rainette ou gala ou Belle fille des Salins, etc. Difficile dès lors de ne pas confondre le mot et la chose, la réalité et la parole, l'être et la lettre. Et c'est là que le sophiste surgit avec sa toute-puissance du langage. Puisque le réel est langagier, il n'y a que du langage. La preuve, dès que vous dites quelque chose, vous êtes dans le langage. En fait, on passe subrepticement du « tout est langage » (ce qui est vrai) au « tout n’est que langage » (ce qui est faux – mais parfaitement logique. Le sophiste est tout aussi logique que Parménide mais à l'inverse. Pour ce dernier, il n'y avait que de l'être sans langage (mais alors dans ce cas, comme dire qu’il n’y a que de l’être ?). Pour les sophistes, il n'y a que du non-être, c’est-à-dire du langage. Le philosophe est entre les deux. Le philosophe fait dans le mélange. Le philosophe est métaxu.

MI4 "Le protocole fantôme" (Brad Bird, 2011)
25 – Consonances et dissonances.
« L'être possède une puissance d'entrer en relation ».
L'être est essentiellement relation, mise en présence, en existence mais aussi en pensée. L'être fait connaître. L'être rend intelligible. L'être rend possible la science.
« Or s'il est quelqu'un qu'il faut combattre avec toutes les forces du raisonnement, c'est celui qui abolit la science, la pensée ou l'intelligence, quelle que soit la manière dont il s'y prenne » (Sophiste 249c).
Celui qui abolit la science, c'est le sophiste – récemment L’ANTIVAX. Celui qui ne prend jamais les deux bouts. Qui considère l'un sans le multiple ou le multiple sans l'un. Qui isole les réalités. Le sophiste est un isolateur, un compartimenteur, un communautariste. Qui ne voit jamais les mélanges, les universaux – ou pire, qui ne voit que les uns sans les autres. Et du coup, tue le discours. « La manière la plus radicale d'anéantir le discours est d'isoler chaque réalité ». Or, « c'est par la combinaison mutuelle des Formes que le discours est né. » À contrario, celui qui ne voit que combinaisons et mélanges fait du discours un nawak interchangeable. Dans le premier cas, il n'y a plus de discours et qu'une vérité insondable (Parménide). Dans le second, il n'y a que des discours et plus aucune vérité (Protagoras, Gorgias). En ce sens, on pourra dire que le premier, Parménide, le Père, est un sophiste totalitaire alors que les seconds sont des sophistes relativistes. Entre les deux, le philosophe tente à la fois les combinaisons et les invariants. De fait, le philosophe est celui qui distingue les choses les unes des autres. Il y a des choses qui consentent à être ensemble et d'autres non. La philosophie sera ainsi un art des distinctions et des consentements, des participations et des discriminations, des consonances et des dissonances. La philosophie sera à la fois grammaire et musique des choses. Tout ne va pas avec tout mais beaucoup de choses vont avec beaucoup de choses : la justice est une vertu, le deux est pair mais le beau n'est pas laid, le trois n'est pas pair. La communication est toujours sélective – élective. Affinités électives. Amitié. Tous les êtres humains peuvent être amis mais pas amis avec tout le monde. À chacun ses amis – et ses ennemis. Chaque étant a un être – et mieux, chaque étant a l'être mais tous les étants ne concordent pas. Tous les genres ne concordent pas. Ou plus exactement, certains, si, d'autres non.
Quels sont donc les genres qui concordent avec tout ?
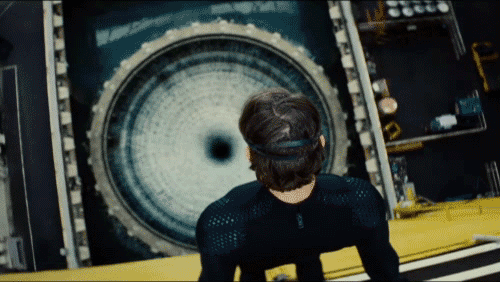
MI5 - Rogue nation (Christopher McQuarrie, 2015)
26 – Le réel et son double.
Il y a les genres qui ne communiquent pas entre eux (froid, chaud, sec, humide) et constituent en fait les qualités des choses – et il y a les genres qui communiquent entre eux et qu'on appellera « les genres-voyelles » à l'instar des voyelles qui font communiquer les consonnes et par lesquelles les mots vont être entendables et prononçables.
Il y a cinq grands genres et parmi eux deux « genres-voyelles ».
Les cinq grands genres sont : l'être, l'autre, le même, le mouvement et le repos.
Aucune chose qui n'échappe à cette pentade (le premier qui dit "pintade", je le sors).
L'être donne sa désignation [ou son existence] à chaque chose
L'autre, sa distinction ou différence.
Le même, son identité ou consistance.
Le mouvement, son devenir (sa vie ?).
Le repos, sa présence (sa mort ?)
On pourra rajouter un sixième genre, celui du non-être – que l’on pourrait définir comme l'être apophatique de l'être, ce que l'être est par ce qu'il n'est pas (je sais, c'est chiant.)
Les deux genres-voyelles sont l'être et l'autre.
L'être, ce qui désigne.
L'autre, ce qui distingue.
L'être, ce dont s'occupera le métaphysicien.
L'autre, ce dont s'occupera le dialecticien.
[Et le mouvement au physicien et biologiste et le repos au prêtre ? Pourquoi pas ?]
Évidemment, tout cela se mélange. Le métaphysicien est un dialecticien et réciproquement. N'empêche qu'il faut d’abord les distinguer en tant que tels. Il faut jouer la tautologie et l'altérité, la répétition et la différence comme dirait Gilles, le passage et la suspension. C’est après que l’on pourra passer d'un genre à l'autre, d'une forme à l'autre, d’une possibilité à l’autre – ou pas. Tout l’art apparemment impossible de la dialectique consiste dans ces rapprochements, participations, mélanges… et ruptures, blocages, verrous. L'idée est de serrer le réel au plus près et le servir au mieux – contrairement au sophiste qui le desserre et le dessert.
La dialectique comme va-et-vient sélectif, voyage de l'un dans le multiple et du multiple dans (et par) l’un, « processus continus inépuisables d'où provient le changement, et de structures parfaites et achevées qui s'imposent à eux ». Mieux : « Limite et Illimité [qui] engendrent des réalités mixtes, à la fois déterminées et indéterminées. Socrate a ainsi subsumé la totalité de l'existence sensible sous trois catégories, Limite, Illimité et Mixte ».
Cinq (ou six !) genres, trois catégories.
« Réciproquement », disions-nous. Certes, mais non « symétriquement ». Tout l'enjeu est là. Le réciproque est dialectique alors que le symétrique est sophistique. Le danger absolu de la pensée, c'est la symétrie, le même, ou plus exactement « le faux même », le « méchant même » qui confond les choses et de fait les liquide. Perversité du pair (qui est justement le contraire du père) qui dissout les choses les unes dans les autres au nom d’une égalité mortifère. Qui les dédouble, les trouble, les confond sur son écran. Le réel qui se confond avec son reflet, son image – son double, comme aurait dit Clément.
ET C'EST POUR CELA QU'IL FAUT PENSER IMPAIR.
L'IMPAIR SAUVE LA PENSEE DE LA SOPHISTIQUE.
L’IMPAIR EST LE SALUT.
L'impair est cet écart qui empêche que la chose se dissolve. La boulette qui fait que le réel reste réel et ne glisse pas dans l'irréalité (sophistique).
Donc, penser par trois, par cinq (pentade), par sept, etc.
Car ne penser que par Un, c'est ne jamais voir le Un ni rien d'autre. Penser par le deux, c'est doubler l'Un et en faire un double, un reflet (je me répète, désolé mais il faut que ça rentre). Alors que penser par le trois, c'est dépasser l'invisibilité de l'Un et l'aporie du Deux. Pas étonnant que Dieu se soit fait en trois personnes. Cinq enfin – pour dépasser le quatre (le deux fois deux) et penser la splendeur impaire du monde. Et démasquer définitivement la sophistique.

MI1 (Brian de Palma, 1996)
27 – De l'Autre au Non-être.
Entérinons.
L'Être donne l'existence.
L'Autre, la distinction.
Le Même, la consistance ou la persistance.
L'Être participe au Même et à l'Autre – mais l'Autre ne participe qu'à l'Être, car l'Autre n'est lui-même qu'en étant autre. « Pour lui, se tourner vers soi-même, c'est se tourner vers l'autre ». Être lui-même, pour l’Autre, c'est toujours être autre. Comme le Snark, il est un Boujeum. Il se distingue tout le temps de lui-même. C’est sa fonction d’être perpétuellement et réellement différent. Car l’Autre est un réel. L’Autre n’est pas une image. L'Autre n'est jamais l’image de quelque chose mais au contraire ce qui permet à chaque chose de ne pas s’enfermer dans son image – l'image étant précisément ce qui confond la chose en elle-même jusqu'à la dissoudre. L’image comme ce qui enferme la chose dans son même qui, en outre, s'avère un faux. Car l’image est toujours un faux. L’image est un faux même. L’image est un Même sans Être et incapable d'altérité. L’image est pure altération du vrai Même.
L'Autre est donc pour la philosophie le premier moyen, sinon le premier moyeu, de dépasser la sophistique – qui n'est que l'art des mêmes, des images, des faux.
Le second moyeu est le Non-être – et c'est grâce à l'Autre qu'on va le trouver. Car quel est, dans sa radicalité absolue, son altérité absolue, l'Autre de l'Être sinon le Non-être ? Et par extension, ce qui vaut pour l’Être ne vaudrait-il pas pour toute chose ? À chaque chose correspond sa négation. À chaque Être, son néant. Et c'est bien Sartre qui vient à la rescousse de Monique Dixsaut quand il définit, dans L'Être et le Néant, l'Autre comme un « être emprunté ». C'est que tout ce que possède l'Autre, il l'emprunte à l'Être (comme tout un chacun) sauf que chez lui, cet Être ne sera jamais lui-même. Ou seulement le temps de le dire. L'Autre a besoin de l'Être pour être mais être pour lui, c'est être autre que lui-même. À la lettre, l'Être de l'Autre « n'est » que le temps de naître dans la pensée – pour disparaître aussitôt, sinon pour « disparautre ». L'Être de l'Autre est une sorte de Non-lui-même – de Non-être. Un Non-être qui se pense et se pose nécessairement comme tel dès qu'on parle de l'Autre de l'Être. Le Non-être, c’est l’Autre de l’Être.
On dit donc en même temps que le Non-être « est » mais que cet être consiste à ne pas être – ou plus exactement à s'opposer à l'Être. Le paradoxe étant que c'est grâce à cette opposition à l’Être qu'on arrive ENFIN à saisir celui-ci par rapport à ce qu’il n’est pas et même le nie. C'est par la négation de l'Être et des êtres que l'Être et les êtres surgissent. « Il faut donc penser toute expression négative, y compris "Non-être", en intention ou en signification, et non pas en extension », écrit Dixsaut. Le Non-être est moins une substance qu'une signification – un sens qui permet de penser l'Être et par extension toute chose. Moins comme résultat d'une mise en opposition que comme mise en opposition (l'antithétis) elle-même. Le Non-être apparaît alors comme une mise à distance de l'être, un recul par rapport à lui - en même temps qu'une reprise de celui-ci. En ce sens, le Non-être peut se considérer comme une technique de l’Être pour se penser lui-même.
Le Non-être, technique de l'Être – ou mieux, dialectique de l’Être.
Le Non-être, distinction de l’Être, Autre de l’Être (et l’on se rappelle que l’Autre était en effet ce qui distinguait la chose.) Nier pour distinguer. Nier pour faire apparaître. On n’a jamais mieux défini la dialectique et la phénoménologie.
Et c’est pour cela qu’au bout du compte, la négation apparaît comme toute relative. La négation est plus une intention, une opération mentale, de l'être qu'une extension. Pour autant, elle est bel et bien un parricide – celui de Parménide qui avait prévenu que « s'il y a des choses qui ne sont pas, il ne faut jamais en emprunter le chemin » (Sophiste 258d), le chemin du Non-être étant en effet un chemin qui ne mène nulle part, comme dira l’autre. Et c’est là où Platon s’insurge car si ! Ce chemin conduit à quelque chose – il conduit à la raison, à la vérité ! C’est là le fameux changement de paradigme qu'opère l’athénien du Vième siècle. Platon. À l'ontologie pure de Parménide succède l'ontologie dialectique. La vie n'est plus affaire d'union mystique avec le cosmos mais bien de raisonnements compliqués tous dictés par la raison. La vie est affaire de raison. Platon ou l'âge de raison de la philosophie.
Le comble est que lui-même sera plus tard considéré comme un mystique à la pensée aristocratique (ou l'inverse), par rapport, par exemple, à Aristote. Alors que par rapport à Parménide, c'est lui, Aristote ! C’est lui qui tue le ciel – ou plus exactement qui le ramène à la raison. Comme quoi, on est toujours le Même d’un autre ! On est toujours le Père d’un fils ! À la différence que si Platon a réussi le parricide de Parménide, toute l'histoire de philosophie a échoué avec celui de Platon. Toute l'histoire de la philosophie n'est que notes de bas de page au platonisme. Et comme nous disait Monsieur Billard en classe de philo : « quand vous n'êtes pas d'accord avec Platon, cherchez pas, vous avez tort. »

MI6 - Fallout (Christopher McQuarrie, 2018)
28 – L’image
Pourquoi Platon s'en est-il tant pris à l'image – et avant les Pères de l'Église, Jean-Jacques Rousseau et les wokes (car de ce point de vue-là, Platon est un woke) ? Parce que l'image trompe, c'est entendu (caverne toussa), mais parce que l'image est un Même qui n'a pas d'être et mieux est un Autre sans être. L'image a bien un être d'image mais elle n'est jamais ce dont elle est l'image. Elle fait semblant d'être même et d'être autre. Elle fait semblant au sens propre. Elle ne relie rien. Elle est hors temps, hors espace. Mais elle nous fascine. Elle nous agrée. Elle nous drogue. On peut rester des heures devant elle à ne rien faire – comme « le miroir du Résid » dans Harry Potter. Elle agrémente nos fantasmes et même nous en invente de nouveaux. Elle est fausseté au sens le plus fort : ce qui fait semblant de donner de l'être à ce qui n'en a pas et n'en aura jamais. Elle se substitue au vrai vrai par un vrai faux. C'est là sa force indéniable : elle peut être vraisemblable. On peut croire que « Thééthète est assis » si Platon l'écrit – car Thééthète a bien dû s'assoir parfois dans sa vie. Mais qui nous dit qu'il est assis là-maintenant à part celui qui veut nous le faire croire pour passer ses informations ? L'image commence toujours par des choses plausibles. Avec elle, le vrai devient une étape du faux.

MI7 - Dead Reckoning (Christopher McQuarrie, 2023)
29 – Vérité et mort
En toute chose, il y a du même et de l'autre et en tout être il y a quelqu'un qui perçoit ce même comme un autre et cet autre comme un même. Autant de mêmes et d'autres que d'êtres. Dès lors, comment distinguer sérieusement les uns des autres – et comment le dialecticien pourrait-il l'emporter contre le sophiste ? Au fond, la complexité du réel donne raison au second : mieux vaut tout relativiser puisque rien ne peut être réellement tiré au clair. La sophistique s'impose comme la technique rêvée et jouissive du savoir – en même temps qu'une très humble sagesse. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On fait confiance à l'homme, mesure de toute chose, plutôt qu'à la vérité que l'on n'atteindra jamais tout en nous perdant. En plus de nous permettre de vivre, la sophistique est un plaisir. Et c'est contre ce plaisir que s'élève la dialectique. La dialectique est cette procédure contrariante qui ne laisse rien ni personne tranquille, qui creuse, creuse, touille, torture tout de bon l'être qui voulait se reposer sous un arbre. Qui complique ad nauseam les choses. Qui corrompt les esprits, surtout les jeunes. Et dont on est un jour obligé de se débarrasser par la ciguë. Bien plus que le Cynique et ses quatre vérités bateau, c'est Socrate qui le véritable chien de la philosophie – le pitbull qui ne lâche rien. L'acharné qui préfère la vérité à la vie, la justice à la vie – la mort à la vie. Comment ne pas le condamner ? Le brûler ? Le crucifier ?
Au bout de ce cycle, on a entraperçu ce que pouvait être la dialectique, la vérité, l'être, le non-être. Mais franchement. Sommes-nous prêts à ce sacrifice ? On était tranquillement en train de banqueter en discourant gentiment quand tout à coup, la discorde, la guerre, la mort au nom de la vérité.

MI8 - The Final Reckoning (Christopher McQuarrie, 2025)
A SUIVRE
09:28 Écrit par Pierre CORMARY | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : platon, monique dixsaut, l'un et le multiple, parménide, sophiste |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer