
A mon ami Anthony Palou sans qui la publication de ce beau livre sur Joyce par Anthony Burgess et, subséquemment, de ma découverte de FW, n’auraient pas été possibles.
 Le livre le plus difficile du monde paraît à Londres chez Faber & Faber le 4 mai 1939. Son auteur, James Joyce, qui a déjà commis en 1922 l’autre livre le plus difficile du monde, cet Ulysse qui chamboula l’histoire de la littérature, mais qui en comparaison du second, apparaîtra comme une chanson populaire, y a travaillé dix-sept ans. A sa publication, personne n’est bouleversé. Il est vrai qu’entre temps, la guerre a éclaté et qu’on a autre chose à faire que de décrypter mille pages imbitables. Les proches, surtout, évidemment, ne suivent plus. Son ami de toujours, et donc frère ennemi symbolique, Ezra Pound, et même son propre frère Stanislaus Joyce, trouvent que, là, leur génie est allé trop loin. Ulysse avait déjà été difficile à avaler mais son obscénité, son caractère scandaleux et ce monologue du vagin final avaient fait sa publicité, et du reste, il était rapidement devenu un livre culte. Impossible d’en faire autant avec ce Finnegans wake qui dès son titre propose déjà un milliard de sens possibles[1]. Quelques fanatiques, dont Samuel Beckett, prennent heureusement sa défense, et le livre commence sa carrière ésotérique. Il devient alors le passe-droit des hermétiques, la boîte de Pandore des thésards, l’abracadabra des ultra-lettreux. Ceux qui ont réussi à le lire jusqu’au bout bombent le torse. Ceux qui ont échoué arguent que c’est un texte illisible dont le seul intérêt est de marquer les limites de Joyce et d’ailleurs de la littérature. Finnegans wake, livre pour personne et fermé à tous sauf à une poignée d’intellos ? Il fallait un grand romancier populaire pour oser prétendre le contraire. Pour Anthony Burgess, auteur du plus stimulant essai jamais écrit sur Joyce et qui vient enfin d’être édité en français[2], la difficulté apparente de l’ultime opus joycien tient de la farce. En vérité, il faut lire FW comme on lirait Gargantua ou Alice au Pays des Merveilles, soit comme la plus extraordinaire fête verbale de tous les temps. Comme dans le Space Mountain de Disneyland, tant pis si l’on ne voit pas tout ! L’essentiel est de se laisser aller dans cet étourdissant train fantôme qui nous emmènera aussi loin que nous pourrons dans l’inconnu et le plaisir, pour ne pas dire dans le plaisir de l’inconnu – l’inconnu étant ici l’humanité débordante et généreuse, l’humanité infinie et totale que nous ne voyons jamais, l’humanité telle qu’elle pourrait être un jour réconciliée avec elle-même. Car cette fabuleuse percée du Logos n’est pas simplement un brillant exercice de style, elle se présente aussi comme « la plus gigantesque exaltation de la valeur humaine que le siècle [dernier] nous ait donnée », voire comme une utopie babélienne où tous les langages n’en formeraient plus qu’un, où tous les sexes, tous les âges, toutes les races se seraient fondus en un homme total, perpétuellement métamorphique, anamorphique, surhumain s’il en est.
Le livre le plus difficile du monde paraît à Londres chez Faber & Faber le 4 mai 1939. Son auteur, James Joyce, qui a déjà commis en 1922 l’autre livre le plus difficile du monde, cet Ulysse qui chamboula l’histoire de la littérature, mais qui en comparaison du second, apparaîtra comme une chanson populaire, y a travaillé dix-sept ans. A sa publication, personne n’est bouleversé. Il est vrai qu’entre temps, la guerre a éclaté et qu’on a autre chose à faire que de décrypter mille pages imbitables. Les proches, surtout, évidemment, ne suivent plus. Son ami de toujours, et donc frère ennemi symbolique, Ezra Pound, et même son propre frère Stanislaus Joyce, trouvent que, là, leur génie est allé trop loin. Ulysse avait déjà été difficile à avaler mais son obscénité, son caractère scandaleux et ce monologue du vagin final avaient fait sa publicité, et du reste, il était rapidement devenu un livre culte. Impossible d’en faire autant avec ce Finnegans wake qui dès son titre propose déjà un milliard de sens possibles[1]. Quelques fanatiques, dont Samuel Beckett, prennent heureusement sa défense, et le livre commence sa carrière ésotérique. Il devient alors le passe-droit des hermétiques, la boîte de Pandore des thésards, l’abracadabra des ultra-lettreux. Ceux qui ont réussi à le lire jusqu’au bout bombent le torse. Ceux qui ont échoué arguent que c’est un texte illisible dont le seul intérêt est de marquer les limites de Joyce et d’ailleurs de la littérature. Finnegans wake, livre pour personne et fermé à tous sauf à une poignée d’intellos ? Il fallait un grand romancier populaire pour oser prétendre le contraire. Pour Anthony Burgess, auteur du plus stimulant essai jamais écrit sur Joyce et qui vient enfin d’être édité en français[2], la difficulté apparente de l’ultime opus joycien tient de la farce. En vérité, il faut lire FW comme on lirait Gargantua ou Alice au Pays des Merveilles, soit comme la plus extraordinaire fête verbale de tous les temps. Comme dans le Space Mountain de Disneyland, tant pis si l’on ne voit pas tout ! L’essentiel est de se laisser aller dans cet étourdissant train fantôme qui nous emmènera aussi loin que nous pourrons dans l’inconnu et le plaisir, pour ne pas dire dans le plaisir de l’inconnu – l’inconnu étant ici l’humanité débordante et généreuse, l’humanité infinie et totale que nous ne voyons jamais, l’humanité telle qu’elle pourrait être un jour réconciliée avec elle-même. Car cette fabuleuse percée du Logos n’est pas simplement un brillant exercice de style, elle se présente aussi comme « la plus gigantesque exaltation de la valeur humaine que le siècle [dernier] nous ait donnée », voire comme une utopie babélienne où tous les langages n’en formeraient plus qu’un, où tous les sexes, tous les âges, toutes les races se seraient fondus en un homme total, perpétuellement métamorphique, anamorphique, surhumain s’il en est.
Notre ambition se limitera ici à la présentation de son premier chapitre, et via Burgess, de montrer en quoi le livre le plus difficile du monde, qui a 70 ans cette année, peut être une intarissable source de jouissance et de connaissance de l’âme humaine - et qu’il n’y a pas que Philippe Sollers et ses boys qui aient le droit de parler de Joyce en France. Comme le dit encore Burgess, « il sera toujours temps de couper les cheveux en quatre ».
Avertissement
Nous, lecteurs de Finnegans wake, devons éviter trois préjugés :
-Croire que le français ne rendra pas l’anglais. Comme le dit mon ami Tlön, Joyce n’écrit pas en anglais, il écrit « en Joyce ». Il est en ce sens aussi lisible ou aussi illisible en anglais qu’en n’importe quelle autre langue. En lui subsiste la tentation de Babel ou de l’esperanto, ni plus ni moins. Pas plus facile que le langage des elfes dans Le seigneur des anneaux. Pas plus difficile que la chanson de Chaplin dans Les temps modernes.
-Croire qu’il faut une immense culture pour le comprendre. Il faut de la culture, mais au sens élémentaire, c’est-à-dire universel, du terme. Il faut avoir entendu parler d’Adam et Eve, être sensible aux mythes, connaître un peu le zodiaque, avoir un certain sens des éléments et des correspondances (l’eau, c’est la matrice, donc c’est la femme), et enfin avoir médité, même une minute, sur la fameuse phrase de saint Jean : Au commencement était le Verbe. Le reste suivra.
-Croire que c’est un livre sérieux fait avant tout pour les universitaires. C’est un livre cosmique mais comique fait pour chacun d’entre nous, un livre fleuve qui nous emportera dans l’essence du Logos et le fera délirer, une sorte de Bible mise en image pour Little Nemo in Slumberland ou de Talmud revu par Tex Avery. Philippe Lavergne, le traducteur héroïque de FW en France, le compare même au Voyager de Star Treck ! Ce qui est sûr, c’est qu’il faut aimer les correspondances, les symboles et les jeux de mots, il faut savoir penser par associations d’idées, échos, ellipses. Il faut enfin posséder le goût savant du jeu. Roman ou poème en prose, FW est d’abord l’histoire de la mésaventure sexuelle d’un patron de bar errant dans un parc mise en parallèle avec celle de la chute d’un maçon alcoolique et que l’on va veiller toute une nuit, croyant qu'il est mort. Entre eux, toute l’humanité passera.

Via Vico
« erre-revie, pass’Evant notre Adame, d’erre rive en rêvière, nous recourante via Vico par chaise percée de recirculation vers Howth Castle et Environs. »
La première phrase de FW n’est pas la plus facile. A la première lecture, on n’y comprend rien, et on est tenté de fermer ce livre. Ca commence sans majuscule, ça juxtapose des séries de mots inventés ou inversés, ça emmerde tout de suite. Et pourtant, si on la lit comme un enfant qui apprendrait la langue, c’est déjà beaucoup plus clair. Il est question phonétiquement de « r » et de « v », de rive et de rêve, de rivière et d’environ, d’errance et de circulation. Alors quoi ? Une rive qui rêve ? Une rivière qui revient ? Une rivière qui rêve qu’elle revient ? Ce qui est certain, c’est que court, ça circule, « via Vico ». Mais c’est qui ce Vico ? Vite ! Wikipédia ! « Giambattista Vico ou Giovanni Battista Vico, philosophe italien du XVIIIème siècle, précurseur d’une nouvelle philosophie de l’histoire selon laquelle les sociétés humaines progressent à travers une série de phases allant de la barbarie à la civilisation pour retourner à la barbarie. Age des Dieux, âge des héros, âge des hommes. » Bon, c’est déjà ça. Ce FW a tout l’air d’être une histoire de cycle, d’éternel retour, de fleuve dans lequel on ne se baigne jamais deux fois, comme dirait Héraclite. C’est pourquoi « ça » commence sans majuscule. En fait, « ça » recommence. « Ca » recommence au milieu d’une phrase. Et si nous avons un peu d’intuition littéraire, nous pouvons parier que cette « première phrase », ce milieu de première phrase, est en fait la suite de la dernière du roman.
Et en effet ! L’ultime phrase de FW, nous le vérifions tout de suite, est :
« Au large vire et tiens-bon lof pour lof la barque de l’onde de l’ »
Voilà. Il suffit d’accrocher cette entrée finale à sa sortie initiale pour que le livre prenne, reprenne, son cours. On ne comprend peut-être pas encore le détail mais on a au moins l’idée du cycle et du mouvement. C’est déjà pas mal.
Pour autant, nous n’avons pas épuisé les possibilités de cette toute première phrase. Et même du premier mot de celle-ci, cet « erre-revie » originel (« riverrun » en Joyce anglais), et qui nous donne différentes pistes phonétiques et philosophiques : une vie qui erre, une vie qui revient, un rêve qui erre, un rêve qui revient, un air qui rêve, un hère qui revit, un homme qui renaît (ou qui ressuscite). Et que fait-il cet hère qui revit ? Il « pass’Evant notre Adame » ? Quoi ? Il passe avant notre Adam ? Il passe avant notre dame ? Il passe en Eve notre Adam ? Youhou ! Mais c'est bien sûr ! On avait le fleuve (Héraclite), on avait le cycle (Vico), on a désormais l’accrochage (la Bible). A ce propos, pas de pudibonderie ! On est chez Joyce, et chez Joyce, ça baise, ça se branle, et encore mieux ça chie et ça pisse[3]. Le sens des choses est toujours mythique et sexuel (ce qui est presque un pléonasme depuis Freud), sinon scato. Mais quoi ? « Là où ça sent la merde, ça sent l’être », disait Antonin Artaud, l’autre grand coprophage de la littérature européenne de la première moitié du XX ème siècle. Déjà, dans Ulysse, Bloom se soulageait dans les toilettes de son jardin. Ici, dans FW, on nous racontera par le menu la défécation au Phoenix Parc de Tom, Dick et Harry, les trois soldats du roman. En attendant, on a droit à « la chaise percée » par laquelle circulent et s’évacuent toutes les forces en jeu. Et on ne peut s’empêcher d’être encore plus joycien que Joyce en pensant que s’il nous avait parlé d’ « évacuation », on aurait eu un mot encore plus signifiant qu’ « erre-revie » : Eve va cul à Sion. Tout un programme.
Pour l’heure, sauf « Howth Castle et Environs », on a tout décrypté : l’eau matricielle, les cycles de la femme et de l’histoire, la femme-histoire, l’homme-chiottes, le flux de la vie et de la mort, le retour ou la résurrection. Howth Castle et Environs, cela doit être un site de Dublin, car, comme d’habitude, pour Joyce, Dublin, c’est la ville-monde. A moins que… Howth Castle et Environs ? Mais ce sont les trois initiales du futur héros du livre : HCE ! Humphrey Chimpden Earwicker ! Et qui va réapparaître des dizaines (des centaines ?) de fois sous d’autres formes mais avec toujours ces trois premières lettres[4] ! HCE, Here Comes Everybody ! HCE, lettres des Etres, lettres de l’Etre. Lettres qui précèdent l’Etre – et qui nous plongent sans crier gare au cœur de la pensée juive. Lettres qui font les mots qui font les phrases qui font le monde. Mot-monde. HCE, monogrammes de l’univers ! Ca paraît compliqué alors que ce n’est qu’élémentaire.
-Tout cela est bien joli, mais s’il faut se taper à chaque fois les milles significations d’une phrase, ou d’un mot, on n’est pas sorti de l’auberge !
-Rassurez-vous, on ne va pas faire ça à chaque phrase, mais disons qu’il vaut mieux insister sur les premières pages afin de donner certaine méthode d’appréhension de ce texte si difficilement facile. Après, ça ira tout seul….
-Vous avez tout compris, vous ?
-Que non ! Comme Ulysse était le livre du jour, FW est le livre de la nuit. Il faut s’habituer à l’obscurité, en goûter la saveur, tirer parti de ces ténèbres envoûtantes. Car au bout du compte, et même si l’on ne comprend pas tout, c’est un sacré moment que vous fait vivre ce satané bouquin.

Violeur d’amour et de moeurs
Continuons. La seconde phrase :
« Sire Tristram, violeur d’amoeurs, manchissant la courte oisie, n’avait pâque buissé sa derrive d’Armorique du Nord sur ce flanc de notre isthme décharné d’Europe Mineure pour y resoutenir le combat d’un presqu’Yseul penny… »
Traduction simultanée ?
« Sire Tristan, violeur d’amour et de mœurs [il a séduit Iseult la promise de son oncle, le roi Mark], parce qu’il a bouleversé la courtoisie [en fait l’amour courtois], a franchi la Manche, dérivant d’Armorique à l’Europe afin de soutenir, même sans le sou son amour pour Iseult. »
Mais qui est ce Tristan ? Celui de la légende [5] ? Un avatar du futur personnage ? Finnegan ? L’auteur lui-même dont on sait qu’il quitta l’Irlande avec sa femme Nora pour s’installer sur le continent et y mener une vie pécuniairement difficile ? Il faut s’y résoudre : comme Léopold Bloom et Stephen Dedalus n’étaient autres qu’Ulysse et Télémaque dans Ulysse, cet Adam et ce Tristan, deux jumeaux en culpabilité amoureuse soit dit en passant, constituent sans doute les premières « entrées » du personnage principal.
La suite est moins claire :
« … ni près du fleuve Oconee les roches premières ne s’étaient exaltruées en splendide Georgi Dublin de Laurens Comptez en doublant ses membres tout le temps ! nulle voix humaine n’avait dessouflé son micmac pour bêptiser Patrick : pas encore, mais nous y venaisons bientôt, n’avait un jeune blanc-bec flibutté le blanc bouc d’Isaac : pas encore, bien que tout soit affoire en Vanité, les doubles sœurs ne s’étaient colère avec Joe Nathan. »
Imbitable ? Apparemment oui, mais ne nous braquons pas pour autant. Comme le dit Anthony Burgess à cet endroit, apprenons à sourire plutôt qu’à froncer les sourcils. Après tout, tout cela relève du Jabberwocky cher à Lewis Carroll. Un Jabberwocky peut-être plus adulte qui veut nous faire passer dans l’interface, ou plutôt « l’aquaface » du monde. Nous entrons dans la mémoire de l’esprit et de la matière, nous commençons à pénétrer les secrets de l’histoire, laissons-nous donc glisser sur ces espace-temps mystérieux et tentons par associations, analogies, réminiscences, de comprendre ce que nous pouvons comprendre.
En premier lieu, il s’agit de Dublin et de saint Patrick le patron de l’Irlande. En second lieu, il semble que quelque chose se soit passé dans ce Dublin, un conflit de vanités entre deux personnes, un « blanc-bec » et un « blanc bouc » appelé Isaac. N’ayons pas peur des notes de bas de page. Dans l’une d’entre elles, Philippe Lavergne nous apprend que « venaisons » est une allusion au pseudonyme d’Ezra Pound, « Alfred Venison », avec lequel Joyce s’était brouillé. Par ailleurs, dans la Genèse, Isaac eut deux fils jumeaux, Jacob et Esaü qui se combattirent. Cela va déjà beaucoup mieux ! On peut parier que le thème des frères ennemis sera une part importante du livre. D’autant que la suite de cette longue phrase, avec sa « foire aux vanités » et ses « doubles sœurs-colères », confirme cette apparition thématique. Frères ennemis, sœurs colères, Joyce et Pound, peu importent les noms, les sexes et les genres (car cela pourrait être tout à fait une lutte entre éléments), l’essentiel réside dans les rapports de force qui est la seule réalité matérielle et céleste du monde.
La troisième phrase de ce premier paragraphe corrobore ces prémisses.
« Onc mais n’avaient Jhem ni Shem brassé de becquée le malte paternel sous l’arcastre solaire et l’on voyait la queue rugissante d’un arc-en-cil encerner le quai de Ringsend. »
Jhem et Shem, les premiers personnages de FW à être nommément cités ! On ne sait pas encore qui ils sont exactement mais on devine qu’ils sont frères (ils ont connu la même « becquée du mal paternel »), sans doute jumeaux (Jhem et Shem), et qu’entre eux la rivalité mimétique sera farouche. Et puis, le jumeau, c’est à la fois le même et l’autre – exactement comme le fleuve héraclitéen que l’on évoquait tout à l’heure. L’eau, le même, l’autre, le conflit, le feu. Et la menace du ciel à travers cet « arc-en-cil » fauve qui se déploie ! Chez Joyce, comme chez John Cowper Powys, les éléments accompagnent le destin. Pierres qui parlent (des menhirs en l’occurrence), arc-en-ciel qui rugit, eau qui donne la vie, feu qui consume. Mots qui s’inventent, qui s’accouplent, qui coïtent, qui accouchent. Vous ne trouvez pas que tout ça est extraordinairement excitant ?

Chute et mixtocide
Dès lors, le roman peut vraiment commencer. Et il commence par une chute. Une chute de cent mots clamant « tonnerre » du malgache au romain :
« bababadalgharaghta-kamminarronnkonnbronn-tonnerroonntuonnthunn- trovarrhounawnskawn-toohoohoordenenthurnuk ! »
Chute originelle sans aucun doute, big bang du langage, mais aussi coup de tonnerre physique et historique, crash de Wall Street, et enfin (on ne peut pas tout citer), « pftjschute de Finnegan, erse solide homme » qui tombe de son échelle et se fait une grosse bosse. Sur le coup, on croit qu’il s’est tué.
Deux chutes, donc, qui ont réveillé l’univers. Les contraires se sont mis en branle, l’être s’est déclaré la guerre à lui-même, les affirmations et les négations se disputent l’Arché :
« Que d’éclats ces ouis contre ces nons, huitrigoths contre piscigoths ! Brékkek Kékkek Kékkek ! Koax Koax Koax ! Ualu Ualu Ualu ! Quaouauh !! Les partisans de Babd et badelaires sont encore de sortie pour mathématriser Moloch McGraine et les Verduns catapelletent la Kamibalisitique déversée par les White boys du Cap Howth. Assagaies et lance-flocs. Cha chauffe m’effrères ! Saulve qui sangle ! Salves d’armes appellent aux larmes, de surcroît. Touillez, touillez, touillez, tout cha tout cha. Quel mixtocide…. »
Le mixtocide joycien ! Il faut lire à haute voix ces pages fabuleuses, rabelaiso-céliniennes, rimbaldo-shakespeariennes, ou tout ce que vous voudrez ! Il faut les chanter même ! Se rendre compte de la richesse, de l’originalité, de la profondeur de ce texte que désormais l’on ne quittera plus…
Entre « Finnegan le constructeur ». A l’origine, c’était le personnage d’une chanson populaire irlando-américaine qui s’intitulait « Finnegan’s wake » (et non « Finnegans wake » comme l’écrira Joyce), en fait un maçon alcoolique qui tombait de son échafaudage et passait pour mort. Ses amis organisaient alors une veillée funèbre autour de lui avec force bibine et au milieu de la nuit, le maçon se réveillait en pleine forme et trinquait avec tout le monde. Le livre le plus difficile de tous les temps part donc du matériau le plus trivial - et Finnegan devient métaphoriquement un bâtisseur de civilisation, un Atlas qui porte la Terre sur ses épaules (et qui s’effondre de temps en temps), un Prométhée-Gargantua qui ensemence l’humanité comme le géant débonnaire de Rabelais pissait sur la ville. Et quand nous disons « métaphoriquement », nous nous trompons. Chez Joyce, comme d’ailleurs chez Kafka, il n’y a jamais aucune métaphore, il n’y a que des métamorphoses, des fusions de personnages et de situations, des confusions historiques et logiques faites exprès, des infusions de sens perpétuelles ! Tout se mélange, tout fermente, tout donne vie. On est dans un roman épique, drolatique, cosmologique non dans un roman symbolique à la Huysmans où le héros se drogue pour sentir « autre chose ». Non, ici, « autre chose » se passe pour de bon. Donc, notre homme est tombé de son échafaudage[6] :
« l’autre hier il se brisa la tête contre le Sterne d’un tonneau où il se rinçait l’œil à contempler l’esparque de sa destinée, mais avant qu’il ait pu se retirer en Switée, en vertu du principe de Moïse, l’eau même s’en était éviparée et toutes les genèses avaient trouvé leur exode – tout ça pour vous montrer quel coquin de pataqueuque c’était ! »
Pentateuque. Pataquès. Patatras. On commence à voir que les inventions joyciennes respirent l’humour et la santé et sont en droit accessibles à tout le monde. Il fait plaisanter la théologie et rire la rhétorique. Et tant pis si l’on n’a pas lu Laurence Sterne ou les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift ! On aura retenu Moïse et son eau matricielle, l’espace-parc de la triste vie du maçon, et toutes les genèses et tous les exodes qui commencent en lui, par lui et avec lui. Finnegan, c’est l’homme-monde qui rassemble en lui tous les hommes et tous les mondes. Et qui fait tous ce que les hommes font en ce bas-monde.
« Souventefois balbutiant, la mithre en avant, sa bonne truelle en pogne et affublé d’un bleu véroleux qu’il ensemanchait habitucalièrement, tel Haroun Childéric Eudebert, il caligulait par multiplicables aletitude et maltitude jusqu’à voir se balancer à la lumière de son doublin où l’était né, son vieux clocher à tête ronde qui se dressait dans sa maiçonnerie nudement charpenté (garanti pur Joyce !) »
Bon Dieu, vous l’avez vu cette fois-ci ? Qui ? Mais HCE enfin ! Humphrey Chimpden Earwicker dont on parlait tout à l’heure ! LE personnage de FW qui apparaît une fois sur deux sous son vrai nom et neuf fois sur dix sous un autre nom (car le Snark était un boujeum, figurez-vous), mais toujours sous les mêmes initiales. HCE, donc, le tenancier du troquet du coin. Celui qui fournit peut-être Finnegan en arrière-monde. Et qui visiblement apparaît comme un joyeux fouteur qui caligule (de Caligula !), ou de manière plus inquiétante, comme un homme s’étant rendu coupable d’un très grand et très sexuel péché. Peu à peu, « l’événement », qui, nous le verrons au fur et à mesure, est celui de la culpabilité sexuelle, « l’affaire de notre péché municipal », se révèle – et avec lui apparaissent les vraies difficultés narratives du roman. Comme chez Kafka (encore !), FW sera un grand livre d’atermoiements judiciaires et moraux où il semble que plus on tente d’approcher la réalité du forfait (un inceste en l’occurrence) plus le texte s’obscurcit, plus on se frotte à l’indicible, plus on frôle l’illisible. Comme si l’appréhension du réel était impossible par les consciences. Comme si tout procès, juridique et ontologique, était forcément un processus opaque, une entrée dans les ténèbres. Allez donc fouiller dans l’âme d’un homme ou ouvrez n’importe quel livre de loi, vous y perdrez votre latin ! Le code civil, c’est aussi compliqué que la psyché.
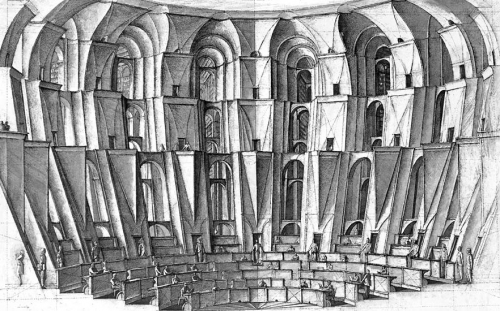
Argilivre et biblouverte
Quelques centaines de pages plus tard, on aura à peu près saisi « l’affaire ». Dans un parc (« un esparque ») appelé Phoenix Park, celui dans lequel Finnegan s’est cassé la gueule, on apprendra qu’HCE a abusé de deux filles qui se révèleront être sa femme et sa fille déguisées, le tout sous les yeux de trois soldats - soient ses deux fils sous la forme d’un trio (car un plus un font trois dans la mathématique joycienne) : Cham, Sem et Japhet. La chute physique du géant correspondrait ainsi à la chute morale du gérant. Entre ces deux événements, une pléthore d’autres événements historiques ou individuels : le duel Wellington / Napoléon, les conflits mimétiques entre les jumeaux (dont les prénoms, initialement Shem et Shaun, fluctuent en fonction des situations[7]), les bavardages des clients de l’estaminet d’HCE, souvent appâtés par la serveuse Kate, et qui se feront eux-mêmes enquêteurs et juges improbables du forfait de ce dernier, et mille et mille autres anecdotes théologiques, historiques, érotiques, sémiologiques, antédiluviennes, ou diluviennes, au choix. La seule aventure, c’est le langage, c’est-à-dire ce qui donne la vie et ce qui explique la mort.
Un langage d’ailleurs qui se prend lui-même et sans complexe comme sujet persistant. Ce n’est pas simplement au fameux chapitre cinq, dont Philippe Lavergne (vingt ans de sa vie passées à traduire FW !) disait que c’était par celui-ci qu’il fallait commencer la lecture, que le livre se met à s’expliquer lui-même, mais partout, et dès le chapitre un.
« si t’as l’esprit abécédaire, poinche-toi sur cet argilivre, c’est courrieux ces signes (je t’en prie, poinche-toi), de son alphabet. Tu peux lire (puisque toi et moi l’avons fait presque jusqu’au bout) ces modes ? C’est le même récit pour tous. Nombreux. Mixogynes sur mixogynes. Ca bas de soie. (…) Dans l’ignorance qu’implique l’impression que tisse la connaissance qui découvre l’idéoforme qui aiguise l’esprit qui transmet des contacts qui adoucissent la sensation qui conduit le désir qui adhère à l’attachement que poursuit la mort qui en-pute la naissance qui entraîne l’assurance de l’existentialité. Mais d’un élan de son nombril pour atteindre les fessedos du Mahambaratta. Terrilleuse biblouverte que cela, étrange et qui continue de craquer (…) Fesse à l’aise ! (…) Etant donné qu’une part si monade rend compte du tout bientôt nous ferons usage du total phabet. »
L’alphabet total. Les signes qui font sens littéralement et dans tous les sens. « Les Adam à dame pour l’infinité » ! En vérité, la babélisation réalisée. Le psaume, ultime car initial, initial car ultime, du Logos.
« C’est pourquoi c’est à peine s’il faut m’épeler la façon dont chaque mot devra comporter trois fois vingt et dix lectures gobissibles tout au long de ce livre d’un Dublin Chinoisé par ses deux côtés (puisse être éclaboussé d’encre le front de celui qui les séparerait) jusqu’au Dail Cliath, par ma foye, qui l’ouvre pour en fermer la porte. »
Les trois révolutions du langage ? Gutenberg. Internet. Entre les deux, Finnegans wake, 1939.
« Les mobiles se scribouillent en mouvement, marchent, tous partis, palpitant et zigzaguant en chaque parcelle avec un bout d’histoire à dire. Il est thym une fois, deux derrière le grillage, et trois dans les massifs de fraise. Et les poulets curaient leurs dents, l’âne commençait à bégayer. Tu peux demander à ton cul si c’est vrai. »
Du cul et du Logos. Quoi de plus Joyce ?
Et si vous n’êtes pas d’accord, je vous dis :
« Perkodhuskururn-barggruaugygokgorlayor-gromgremmitgughun-
dhurthrumathunaradi-dillifaitillibumullunukkunum ! »

James Joyce, Finnegans wake, traduit de l’anglais, présenté et adapté par Philippe Lavergne, Gallimard, 1982, Folio, 1997
Anthony Burgess, Au sujet de James Joyce – une introduction pour le lecteur ordinaire, Le serpent à plumes, 2008.
Jean Paris, Joyce, collection « écrivains de toujours », Seuil, 1981.
[1] Finnegans wake se traduit habituellement par « le réveil de Finnegan », mais dans ce cas on devrait alors écrire « Finnegan’s wake », à moins qu’il ne s’agisse de tous les Finnegans qui se réveillent. Sans compter que dans « Finnegan » est contenue la double idée de la fin (fin, finale, fine, finn) et de la reprise (again), « Finn Again » - le champ sémantique joycien dépassant largement le seul domaine anglais.
[2] Anthony Burgess, Au sujet de James Joyce – une introduction pour le lecteur ordinaire, Le serpent à plumes, 2008.
[3] « Je n’ai jamais été enclin à condamner ceux qui cherchent du sexe dans la littérature : peut-être dans leur quête découvriront-ils autre chose », avoue malicieusement Burgess à propos de l’obscénité d’Ulysse.
[4] Certes, on ne s’en rendra compte qu’un peu plus tard, Humphrey Chimpden Earwicker apparaissant quelques pages plus loin. Mais dans notre tentative d’expliquer FW, cette « tricherie chronologique » pourra nous être pardonnée.
[5] En fait, il s’agit de Sire Amelric Tristram qui fit construire le château de Howth Head (Howth Castel et Environs), et qui n’est donc pas le Tristan de la légende arthurienne, même si, ajoute Burgess, et cela est capital pour l’appréhension de FW, « nous devons accepter une identification onirique des deux personnages » - l’association d’idées et de référents étant chez Joyce aussi importante que la réalité « scientifique ».
[6] A dire la vérité, cette chute trouve au fil du roman toute une série de causes diverses : Finnegan a pu tomber de son échafaudage autant par ivresse que par la chute d’une brique sur sa tête. « Ce fut peut-être une brique de méfeu, comme d’aucuns le prétendent ou ce pût être dû avoir été causé par un écroulapsus de ses arrière-promesses, comme d’autres le croient (Il s’en répand à ce jour mille et une histoires, tout bien conté de la même qualité.) »
[7] Jhem et Shem, Cham et Sem, Shem et Shaun, puis Mutt et Jute, et évidemment Caïn et Abel, Romulus et Rémus, etc. Rien n’est jamais en place dans FW, sauf peut-être les rapports de force. C’est cela qu’il faut toujours avoir à l’esprit. Les noms et les situations changent, les relations persistent.
