 Un cinéma surexposé
Un cinéma surexposéUn paysage de montagne. Une voix off un rien pompeuse qui nous dit qu’ « il y a une guerre dans cette forêt, mais cette guerre n’est ni passée, ni future, c’est toute guerre, [car] tout ce qui arrive est en dehors de l’Histoire (« outside History ») [et que] seules les formes immuables de la peur, du doute et de la mort relèvent de notre monde. » Eh bien, dites-moi, ça commence bien, le premier film du plus grand metteur en scène du monde !
Pourquoi Kubrick a-t-il renié Fear and desire, son premier long métrage de 1953, et tenté d’en faire disparaître toutes les copies existantes (d’ailleurs en vain puisqu’on peut le voir depuis peu en huit parties sur Youtube avec des sous-titres italiens) ? Parce qu’au-delà de sa maladresse quasi ed woodienne, et d’ailleurs charmante, le film avait quelque chose de trop lisible dans ses intentions : le pessimisme facile, la cosmologie naïve, le retour du même un rien « mécanique », les doubles trop évidents (les « ennemis » étant en effet interprétés par les mêmes acteurs incarnant les « soldats »), les abîmes surfaits, la guerre à outrance, bref : une Weltanschauung bien trop essentialiste pour être honnête et parsemée de réflexions vraiment pas possibles : « Est-il vrai qu’aucun homme n’est une île ?, se demande en voix off l’un des protagonistes. C’était peut-être vrai il y a longtemps avant l’ère glaciaire. Les glaciers ont fondu, et maintenant, nous sommes tous des îles, des parties d’un monde qui n’est fait que d’îles. » Un grand auteur a toujours des mauvaises nouvelles du monde à apporter mais quand il le fait de manière trop transparente, il risque de passer pour un ado immature qui n’a pas digéré ses lectures et ne maîtrise pas encore ses pulsions.

 n’est pas le colonel Kurtz. Pas question non plus chez Kubrick que l’on s’identifie au héros, personne n’ayant envie de ressembler au Redmond Barry de Barry Lyndon, au Jack Torrance de Shining, ou au Bill Harford de Eyes wide shut, ce petit médecin qui ne se remet pas d’avoir failli être trompé par sa femme et qui tente de se retrouver une souveraineté masculine à travers des aventures dans lesquelles il échouera lamentablement. Et si l’on est « fasciné » par Alex, ce n’est pas parce que l'on a envie de tabasser des gens et de violer des femmes.
n’est pas le colonel Kurtz. Pas question non plus chez Kubrick que l’on s’identifie au héros, personne n’ayant envie de ressembler au Redmond Barry de Barry Lyndon, au Jack Torrance de Shining, ou au Bill Harford de Eyes wide shut, ce petit médecin qui ne se remet pas d’avoir failli être trompé par sa femme et qui tente de se retrouver une souveraineté masculine à travers des aventures dans lesquelles il échouera lamentablement. Et si l’on est « fasciné » par Alex, ce n’est pas parce que l'on a envie de tabasser des gens et de violer des femmes.
Aucune héroïsation, donc, des personnages kubrickiens. Non, des hommes sans qualités, des anonymes, souvent médiocres, tragiques malgré eux, et qui suscitent au pire le rire, au mieux la compassion. C’est cette raison qui a fait que Kubrick a « renié » Spartacus, film romantico-héroïque par excellence, mettant en scène un héros bien trop lisse pour être crédible et qui ne perd la partie non pas parce qu'il a en lui une volonté de puissance qui se transforme peu à peu en instinct mortifère selon une thématique chère au cinéaste (et qu'il aurait sans doute accompli dans son Napoléon s'il avait réussi à le faire) mais parce d'odieux pirates le trahissent, refusant de l'embarquer, lui et ses hommes, et les obligeant à remonter contre les armées romaines - une "astuce idiote" de scénario, comme le cinéaste l'expliquait à Michel Ciment dans son livre. C’est cette même raison qui nous a toujours fait douter du bien fondé des Sentiers de la gloire – le film de Kubrick prisé généralement par tous ceux qui n’aiment pas trop Stanley Kubrick et qui en font ce qu’il est en partie, à savoir un fort efficace pamphlet plein de bons sentiments antimilitaristes, saturé de manichéisme, et qui ose à la fin la victimisation lacrymale (les trois malheureux fusillés) - du jamais vu dans le cinéma profondément apolitique, pour ne pas dire amoral, de Kubrick.




Comme le dit Michel Chion qui inspire cette étude, les rapports de classe ne sont chez Kubrick qu’un avatar des rapports de force. Pas de critique du « système » chez lui (ou c’est la vie elle-même qui est un « système »), pas d’espoir d’une « société plus juste », pas de conscience sociale ni sociétale, non, la vision est simplement cosmique, anthropologique, primitive, mytho-poétique. On ne « dénonce » pas chez Kubrick, on ne plaide pas pour un monde meilleur, on se contente de montrer. On montre l’espace du monde, l’espace du temps, l’espace du XVIII ème siècle, l’espace d’un hôtel hanté, l’espace d’un camp d’entraînement, l’espace des chiottes – lieu récurrent de son cinéma, sans doute parce que « là où ça sent la merde, ça sent l’être. »
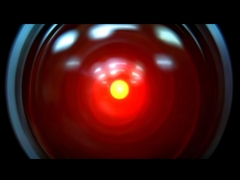 On montre et on expose. Et même on surexpose – c’est-à-dire on rend visible ce qui rend visible. On hystérise le visible. On donne trop de présence au visible. Il faut « imprimer l’œil », comme dit Chion. Il faut écarquiller les paupières. Il faut filmer la pupille en très gros plan. Il faut à fois montrer ce qui est vu et ce qui voit. Il faut montrer la vue en train de voir – parfois jusqu’à l’insoutenable. L’œil rouge de l’ordinateur. L’œil multicolore de l’astronaute. L’œil cillé, puis écarquillé d’Alex. L’œil dément de Jack Torrance ou ivre de douleur de la jeune Vietcong à la fin de Full metal jacket. L'oeil de Kubrick lui-même qui nous a toujours fait peur. Les incessants jeux de regard de Barry Lyndon et de Eyes wide shut. La caméra de Kubrick elle-même perpétuellement dans le tout voir, le tout montrer. D’où le plaisir toujours virginal de revoir, même pour la centième fois, un film de Stanley Kubrick
On montre et on expose. Et même on surexpose – c’est-à-dire on rend visible ce qui rend visible. On hystérise le visible. On donne trop de présence au visible. Il faut « imprimer l’œil », comme dit Chion. Il faut écarquiller les paupières. Il faut filmer la pupille en très gros plan. Il faut à fois montrer ce qui est vu et ce qui voit. Il faut montrer la vue en train de voir – parfois jusqu’à l’insoutenable. L’œil rouge de l’ordinateur. L’œil multicolore de l’astronaute. L’œil cillé, puis écarquillé d’Alex. L’œil dément de Jack Torrance ou ivre de douleur de la jeune Vietcong à la fin de Full metal jacket. L'oeil de Kubrick lui-même qui nous a toujours fait peur. Les incessants jeux de regard de Barry Lyndon et de Eyes wide shut. La caméra de Kubrick elle-même perpétuellement dans le tout voir, le tout montrer. D’où le plaisir toujours virginal de revoir, même pour la centième fois, un film de Stanley Kubrick 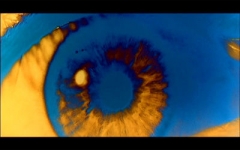 tant chaque image est une fête pour l’œil. Mais d’où, aussi, l’impression d’un « je m’as-tu-vu filmer » qui apparaît parfois dans ce cinéma. « Difficile, écrit Chion, de ne pas remarquer le découpage qui découpe, le montage qui monte, le mixage qui mixe, et difficile de ne pas entendre que la musique a été surajoutée…. » C’est ce que certains n’aiment pas dans ce cinéma qui fait de son spectacle un autre spectacle : les ellipses trop « conscientes » d’elles-mêmes (l’os que le singe envoie en l’air et qui retombe en navette spatiale dans 2001), la musique « intelligente » qui donne de la classe aux choses les plus incongrues ou les plus horribles, ou mieux, qui réinvente l’essence des choses selon une ironie flatteuse qui ne peut
tant chaque image est une fête pour l’œil. Mais d’où, aussi, l’impression d’un « je m’as-tu-vu filmer » qui apparaît parfois dans ce cinéma. « Difficile, écrit Chion, de ne pas remarquer le découpage qui découpe, le montage qui monte, le mixage qui mixe, et difficile de ne pas entendre que la musique a été surajoutée…. » C’est ce que certains n’aiment pas dans ce cinéma qui fait de son spectacle un autre spectacle : les ellipses trop « conscientes » d’elles-mêmes (l’os que le singe envoie en l’air et qui retombe en navette spatiale dans 2001), la musique « intelligente » qui donne de la classe aux choses les plus incongrues ou les plus horribles, ou mieux, qui réinvente l’essence des choses selon une ironie flatteuse qui ne peut  que plaire aux bons esthètes amoraux que nous sommes (une douce chanson d’amour de Vera Lynn, We'll Meet Again, pour accompagner l’explosion nucléaire, un Beau Danube Bleu pour une valse de l’espace, un Singing in the rain « revisité » pour une scène de torture et de viol, et Beethoven, d’abord délice onaniste, puis supplice mental d’Alex), les bougies visiblement « contentes » d’avoir été choisies et de brûler pour le maître (Barry Lyndon), les paysages ravis d’être si bien photographiés (« à la Gainsborough » dans Barry Lyndon, ou de l’hélicoptère dans le générique de Shining), les mouvements de caméra très fiers de leurs effets (à la Steadicam dans Shining, au ralenti dans Full metal jacket), les couleurs qui jouissent
que plaire aux bons esthètes amoraux que nous sommes (une douce chanson d’amour de Vera Lynn, We'll Meet Again, pour accompagner l’explosion nucléaire, un Beau Danube Bleu pour une valse de l’espace, un Singing in the rain « revisité » pour une scène de torture et de viol, et Beethoven, d’abord délice onaniste, puis supplice mental d’Alex), les bougies visiblement « contentes » d’avoir été choisies et de brûler pour le maître (Barry Lyndon), les paysages ravis d’être si bien photographiés (« à la Gainsborough » dans Barry Lyndon, ou de l’hélicoptère dans le générique de Shining), les mouvements de caméra très fiers de leurs effets (à la Steadicam dans Shining, au ralenti dans Full metal jacket), les couleurs qui jouissent  d’être là (Eyes wide shut), les génériques mêmes très conscients de leur propre monumentalité (2001 commence comme une messe !). Quand on regarde un film de Stanley Kubrick, on a l’impression que le film se regarde lui-même et se dit : « ce que je suis beau et intelligent quand même ! ». Il est vrai que le plaisir procuré par ces films vient de cette immensité accordée aux détails, dont même "l'erreur" de l'ombre de l'hélicoptère fait partie.
d’être là (Eyes wide shut), les génériques mêmes très conscients de leur propre monumentalité (2001 commence comme une messe !). Quand on regarde un film de Stanley Kubrick, on a l’impression que le film se regarde lui-même et se dit : « ce que je suis beau et intelligent quand même ! ». Il est vrai que le plaisir procuré par ces films vient de cette immensité accordée aux détails, dont même "l'erreur" de l'ombre de l'hélicoptère fait partie.
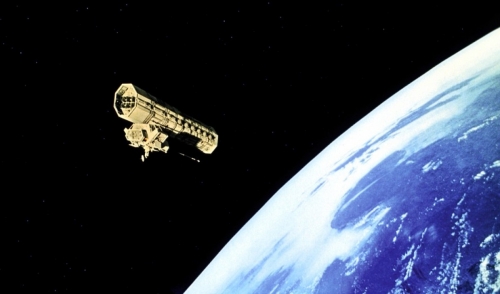


 Prenez le début apparemment si simple de Eyes wide shut dans lequel Tom Cruise et Nicole Kidman, finissant de se préparer pour aller à la soirée de Ziegler, traversent leur espace, chambre, salle de bain, couloir, salon, puis le refont chez leur hôte. Remarquez comme ils prennent possession de l'espace, à moins que cela ne soit l'espace qui prenne possession d'eux (les yeux brillants du chat représenté dans un tableau posé dans leur couloir). En moins d'une minute, on a l'impression que les deux personnages ont traversé un univers de formes, de couleurs, de sens inconnus, exactement comme la séquence du trou noir dans 2001 – et au fond, ce qui va métaphoriquement leur arriver. Ou l’extraordinaire scène du dernier duel de Barry Lyndon avec la sarabande d’Haendel joué au tambour et en sourdine, et qui donne la
Prenez le début apparemment si simple de Eyes wide shut dans lequel Tom Cruise et Nicole Kidman, finissant de se préparer pour aller à la soirée de Ziegler, traversent leur espace, chambre, salle de bain, couloir, salon, puis le refont chez leur hôte. Remarquez comme ils prennent possession de l'espace, à moins que cela ne soit l'espace qui prenne possession d'eux (les yeux brillants du chat représenté dans un tableau posé dans leur couloir). En moins d'une minute, on a l'impression que les deux personnages ont traversé un univers de formes, de couleurs, de sens inconnus, exactement comme la séquence du trou noir dans 2001 – et au fond, ce qui va métaphoriquement leur arriver. Ou l’extraordinaire scène du dernier duel de Barry Lyndon avec la sarabande d’Haendel joué au tambour et en sourdine, et qui donne la  sensation vertigineuse que le temps a vraiment été suspendu dans son vol, et cela malgré le voletage des pigeons ou grâce à celui-ci. Philippe Fraisse, l’auteur d’un essai sur Kubrick intitulé Le cinéma au bord du monde, avait raison : dans les films de Kubrick, même les moutons et les pigeons jouent bien. Pour le spectateur difficile qui n’aime pas qu’on le prenne pour un mouton ou pour un pigeon et qui d’une certaine façon prouve par là qu’il n’aime pas le cinéma, qui en fait se méfie comme de la peste de la jouissance visuelle, odieusement manipulatrice, que procure le cinéma, l’œuvre de Kubrick apparaîtra
sensation vertigineuse que le temps a vraiment été suspendu dans son vol, et cela malgré le voletage des pigeons ou grâce à celui-ci. Philippe Fraisse, l’auteur d’un essai sur Kubrick intitulé Le cinéma au bord du monde, avait raison : dans les films de Kubrick, même les moutons et les pigeons jouent bien. Pour le spectateur difficile qui n’aime pas qu’on le prenne pour un mouton ou pour un pigeon et qui d’une certaine façon prouve par là qu’il n’aime pas le cinéma, qui en fait se méfie comme de la peste de la jouissance visuelle, odieusement manipulatrice, que procure le cinéma, l’œuvre de Kubrick apparaîtra 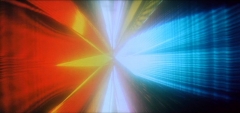 comme la plus pompière et la plus vulgaire du monde. Il trouvera insupportable ce visuel qui se fait rituel de lui-même – car non, décidément non, on ne réfléchit pas avec des reflets, on ne pense pas avec de la musique, on ne fait pas du Nietzsche sous prétexte qu’on utilise la musique d’Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss. Au fond, Stéphane Zagdanski avait raison, le cinéma, et particulièrement celui-là, est un non-art absolu, une imposture culturelle, une mort dans l’œil, une orange mécanisation du vivant…. Et ce n’est pas parce que l’on fait semblant de « dénoncer » cette mécanisation qu’on n’y participe pas de manière encore plus sournoise. Le cinéma, c’est une ombre qui dénonce une autre ombre, une caverne qui dénonce une autre caverne, un dictateur qui dénonce un autre dictateur – et Kubrick, le pire dictateur de la vue qui ait été !
comme la plus pompière et la plus vulgaire du monde. Il trouvera insupportable ce visuel qui se fait rituel de lui-même – car non, décidément non, on ne réfléchit pas avec des reflets, on ne pense pas avec de la musique, on ne fait pas du Nietzsche sous prétexte qu’on utilise la musique d’Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss. Au fond, Stéphane Zagdanski avait raison, le cinéma, et particulièrement celui-là, est un non-art absolu, une imposture culturelle, une mort dans l’œil, une orange mécanisation du vivant…. Et ce n’est pas parce que l’on fait semblant de « dénoncer » cette mécanisation qu’on n’y participe pas de manière encore plus sournoise. Le cinéma, c’est une ombre qui dénonce une autre ombre, une caverne qui dénonce une autre caverne, un dictateur qui dénonce un autre dictateur – et Kubrick, le pire dictateur de la vue qui ait été !

