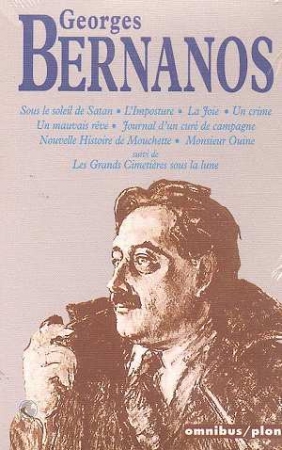 Pourquoi lire Bernanos me demandait Joseph Vebret ? Pourquoi se plonger dans ces textes difficiles, indigestes, et pour tout dire mal écrits ? Quel plaisir y a-t-il à décrypter ces métaphores compliquées et qui ne créent aucune image ? En vérité, Bernanos a le style le plus invisualisable qui soit – même s’il inspirera deux films géniaux à Robert Bresson. Il a beau parler toutes les deux lignes de ténèbres, de gouffres et d’abîmes, on ne sent jamais ni les uns ni les autres. C’est un phraseur lourdingue qui plombe tout ce qu’il touche. Rappelez-vous l’incipit calamiteux de Sous le soleil de Satan : « Voici l’heure du soir qu’aima Paul-Jean Toulet. » On ne fait pas début de roman plus maladroit. S’en suit un paragraphe approximatif où il est question d’ « horizon qui se défait », de « silence liquide », de « nuit qui monte comme un lis ». Avouez qu’il faut s’accrocher pour continuer. Je blasphème ? Tant mieux. « Le blasphème engage dangereusement l’âme, mais il l’engage. » Si l’esprit préfèrera toujours un Barrès ou un Valéry, brillant, plaisant, flatteur, français !, l’âme réclamera un Bernanos. Il est un de ces rares auteurs (Claudel ? ) dont on peut dire que le génie compense le talent. Avouons-le : ce type dont j’ai du mal à ouvrir les livres et encore plus à les terminer aura pourtant changé ma vie. Toutes les question que je me suis posées jusqu’à la nausée, il y a répondu. Ce ténébreux voit clair. Cet hermétique dit les choses les plus simples et les plus réelles sur l’âme, l’enfer, la damnation. Il rend caduque toutes les homélies, ridiculise les catéchismes, et, seul, donne le sens de la foi. Je lui dois une partie de ma conversion.
Pourquoi lire Bernanos me demandait Joseph Vebret ? Pourquoi se plonger dans ces textes difficiles, indigestes, et pour tout dire mal écrits ? Quel plaisir y a-t-il à décrypter ces métaphores compliquées et qui ne créent aucune image ? En vérité, Bernanos a le style le plus invisualisable qui soit – même s’il inspirera deux films géniaux à Robert Bresson. Il a beau parler toutes les deux lignes de ténèbres, de gouffres et d’abîmes, on ne sent jamais ni les uns ni les autres. C’est un phraseur lourdingue qui plombe tout ce qu’il touche. Rappelez-vous l’incipit calamiteux de Sous le soleil de Satan : « Voici l’heure du soir qu’aima Paul-Jean Toulet. » On ne fait pas début de roman plus maladroit. S’en suit un paragraphe approximatif où il est question d’ « horizon qui se défait », de « silence liquide », de « nuit qui monte comme un lis ». Avouez qu’il faut s’accrocher pour continuer. Je blasphème ? Tant mieux. « Le blasphème engage dangereusement l’âme, mais il l’engage. » Si l’esprit préfèrera toujours un Barrès ou un Valéry, brillant, plaisant, flatteur, français !, l’âme réclamera un Bernanos. Il est un de ces rares auteurs (Claudel ? ) dont on peut dire que le génie compense le talent. Avouons-le : ce type dont j’ai du mal à ouvrir les livres et encore plus à les terminer aura pourtant changé ma vie. Toutes les question que je me suis posées jusqu’à la nausée, il y a répondu. Ce ténébreux voit clair. Cet hermétique dit les choses les plus simples et les plus réelles sur l’âme, l’enfer, la damnation. Il rend caduque toutes les homélies, ridiculise les catéchismes, et, seul, donne le sens de la foi. Je lui dois une partie de ma conversion.
Je disais à l’instant qu’il est indigeste, lourdingue, approximatif. Sottises ! c’est moi, petit lecteur jésuite, rusé et accommodant, qui suis fondamentalement indigeste, lourdingue, approximatif. Chaque page de Bernanos charcute l’âme et c’est pourquoi l’on fait semblant de ne pas comprendre. Comme tous ces chrétiens au service de Dieu, il est doté de cette empathie antipathique qui se fout d’être agréable ou joli (alors que les députés du diable sont si beaux, eux) l’important étant de tenailler l’âme et de lui extirper ses démons. Tout ce qui détourne du salut (beauté, intelligence, morale) n’a pas lieu d’être. Le mal, c’est ce qui séduit. Lui sera l’auteur le plus antiérotique qui soit.
Tant pis, il faut y aller… Ces notes ne sont que des impressions de lecture, un voyage dans l’univers de Bernanos, une plongée dans l’abjection de la vie, car, comme il le dit dans Nouvelle histoire de Mouchette : « tout ce qui vit est sale et pue. »
Sous le soleil de Satan : damné à la place du damné.
Le problème de Bernanos, c’est la damnation. Contrairement à ce que pensait Dostoïevski, ce n’est pas la souffrance des enfants mais la souffrance des damnés qui accuse la miséricorde de Dieu. Qu’il soit de feu ou de glace, l’enfer est insoutenable à quiconque y réfléchit pour de bon. Tous ces tièdes qui se croient brûlants en affirmant tranquillement que l’enfer existe, ont-il déjà été brûlés par une flammèche ? Allons donc ! L’enfer, c’est pour les autres.
Si Dieu avait de l’humour, Il ne mettrait en enfer que ceux qui pensent que d’autres y sont. Car enfin, si, comme le disent les théologiens, l’enfer est indifférence, les élus peuvent-ils être indifférents aux suppliciés pour toujours ? Et comment faire la fête au paradis si l’on entend sa mère ou son enfant hurler d’en bas ?
Les curés nous répondent en confession que c’est là « le mystère de Dieu », et nous rassurent en précisant que si le Christ a parlé, et plusieurs fois, de la « géhenne du feu », Il n’a jamais nommé quelqu’un qui y était. Selon la belle expression d’André Frossard, l’enfer existerait mais sans qu’il n’y ait personne dedans. Pas même Judas – pour lequel l’enfant Bernanos allait demander à son curé de paroisse de prier. Prier pour Judas, prier pour le suicidé, prier pour celui que ce salaud de Dieu a abandonné à sa liberté de se damner, la voilà, la suprême charité - celle de l’abbé Donissan.
Trop facile de ne se faire que crucifier pour nous ! Le Christ avait beau jeu sur sa croix d’attendre que son petit calvaire de trois heures et demie se termine. Prendre la place du damné, risquer le pal éternel d’autrui, c’est une autre affaire. Donissan est celui qui vient se faire damner à la place du damné. Il est le saint prêt à donner son salut pour l’autre. C’est pourquoi il recherche Satan. Pour le comprendre, le connaître, et lui arracher les âmes - pour le doubler. Si le diable est celui qui mime Dieu, Donissan sera celui qui mime Satan. Pour cela, il lui faut se déshumaniser, tuer en lui l’espérance, la prudence, surtout « déraciner » sa joie - car la joie est toujours l’oubli des souffrants, et du reste, est intrinsèquement mauvaise car elle vient de Satan. Gare aussi à l’intelligence qui n’est jamais qu’ « intelligence avec l’ennemi », et dont toutes les formes, accommodement égoïste, charité intéressée, faiblesse organisée, constituent autant de brèches par lesquelles le diable s’immisce en nous – le diable dont le piège le plus irrésistible est précisément de rendre intelligent l’être qu’il va capturer : « - Nous te travaillerons avec intelligence, susurre-t-il à Donissan lors d’une de ses apparitions. Aie souci de nous nuire. Nous te tarauderons à notre tour. Il n’est pas de rustre dont nous ne sachions tirer parti. Nous te dégraisserons. Nous t’affinerons. ». Contre l’intelligence infernale, la sottise est le meilleur rempart. « Oserait-il s’avouer, ce jeune prêtre audacieux, qu’il recherche pour elle-même, la pieuse sottise ? ». Ne plus comprendre, ne plus jouir, c’est ne plus être tenté. Seuls les sots et les imbéciles l’emportent sur le diable.
Au fond, la sainteté de Donissan consiste à tenter le désespoir sans tomber dans le mal – gageure folle, car, comme le lui fait remarquer l’abbé Menou-Segrais, cet homme que Donissan n’estime pas parce que précisément il est trop intellectuel, le désespoir est ce qui conduit « de la haine aveugle du péché au mépris et à la haine du pécheur. » D’autant que Donissan a beau se perdre devant Dieu, il perd les âmes qu’il voulait sauver. Mouchette se suicide, le petit garçon ne ressuscite pas - même si Donissan l’a senti « revivre » dans ses bras un instant, un « signe » qui lui est accordé pour que toutes ses souffrances n’aient pas été vaines. Mais Mouchette ? le seul espoir qui reste est que Dieu la sauve quand même.
Après tout ça, ne reste plus à Donissan qu’à se retirer dans sa paroisse de Lumbres et à recevoir les intellectuels chrétiens dilettantes, tel cet Antoine Saint-Marin, faiseur de livres et amateur de « saints », tenant autant du journaliste que du croque-mort, et devant lequel il rendra l’âme sans avoir rien dit.
Donissan, comme Judas, a voulu presser Dieu – un Judas agissant pour la libération immédiate et totale des âmes, y compris et surtout des âmes perdues. Or, échanger son salut contre la damnation d’autrui, c’était bouleverser l’ordre de la grâce, c’était forcer Dieu à accueillir un réprouvé et Satan à prendre un élu, et dès lors, exiger de Dieu qu’il renonce à l’enfer. Hélas ! on n’exige rien de Dieu, on ne lui demande même rien, on se donne à lui, et on lui rend grâce quoiqu’il arrive. Car « Dieu ne se donne qu’à l’amour. » et Donissan, à forces de trop d’altruisme, en a manqué. Le sacrifice ne conduit pas nécessairement au salut. C’était aussi cela le piège de Satan.
Journal d’un curé de campagne : Le Christ recrucifié.
Le Christ n’a pas assez souffert sur la Croix, toutes les parents d’enfants morts vous le diront. Pour la comtesse, la haine de Dieu est le seul moyen qu’elle ait trouvé pour rester fidèle à son petit garçon. Mieux vaut être en enfer avec lui qu’au paradis sans lui. Aucune goutte de sang de ce dieu sacrificiel ne lui rendra la chair de sa chair. D’ailleurs, le Calvaire rachète-t-il quoique ce soit ? Au final, il n’y a pas une mais deux, dix, mille, plusieurs milliards de souffrances - inutiles et certaines. Enfant(s) mort(s), dieu torturé et tortureur, douleur généralisée sur toute la terre depuis le début – et tout ça, au nom de notre « liberté ». « Il faut être fort… » paraît-Il. Justement, nous n’avons aucune force. Nous sommes écrasés par notre impuissance. Nous nous sommes relevés onze fois et sommes retombés douze. Lutter pour avoir encore plus mal, c’est ça que Vous voulez ? Non, non, mieux aurait valu que rien n’existe. Pour notre bien, Dieu aurait dû nous avorter. Au lieu de ça, Il nous a empalés (accouchés) dans sa vie toutes et tous, et Son Fils avec – et si par hasard, nous n’en pouvons plus et nous nous suicidons, nous voilà en enfer ! après la flagellation temporelle, la crucifixion éternelle. C’est ça, l’amour de Dieu – une machine à torture à laquelle personne n’échappe.
Comme nous la comprenons la comtesse quand elle hurle au curé d’Ambricourt que « s’il existait quelque part, en ce monde ou dans l’autre, un lieu où Dieu ne soit pas – dussé-je y souffrir mille morts, à chaque seconde éternellement – j’y emporterai mon… (elle n’osa pas prononcer le nom du petit mort) et je dirais à Dieu : « satisfais-toi ! écrase-nous ! »
Et le curé sans nom fait face. Il sait que le blasphème est le langage de la souffrance et que la haine de Dieu est encore un appel de Dieu. Il sait surtout qu’ à « celui qui dit une parole contre le Fils de l’homme, il lui sera fait rémission » (Saint Matthieu, XII-32) et que la révolte contre le Christ n’est pas le blasphème contre l’esprit saint - qui, lui, ne sera pas remis. Cracher sur le Fils de l’Homme est « permis », c’est dire « non » au Saint Esprit qui est fatal*. Aussi peut-il donner cette réponse sublime, une de celles qui retourne comme un gant la rage en apaisement :
« Madame, si notre Dieu était celui des païens ou des philosophes (pour moi, c’est la même chose) il pourrait bien se réfugier au plus haut des cieux, notre misère l’en précipiterait. Mais vous savez que le nôtre est venu au-devant. Vous pourriez lui montrer le poing, lui cracher au visage, le fouetter de verges et finalement le clouer sur une croix, qu’importe ? Cela est déjà fait, ma fille… ».
O révélation ! Tout ce que nous pouvons avoir de rage et de révolte contre le Christ a déjà été exécuté – est déjà du passé ! La croix a rendu ringard tous nos désespoirs, a consommé toutes nos peines – même celle de l’enfant mort ! Celui-ci nous attend au Ciel ! A quoi bon persister dans sa haine de Dieu ? A quoi bon refuser Sa grâce ? Après l’avènement du Christ, il faut être idiot pour rester en enfer.
Et c’est le moment sublime où, vaincue pour son salut par le curé, la comtesse accepte de réciter le Pater Noster avec lui, de prononcer le terrible « que votre volonté soit faite ». Mais au moment où elle va le faire, cette volonté lui apparaît encore trop cruelle, ce règne qui arrive encore trop féroce… Si le Christ est réellement venu se faire crucifier pour elle, alors elle doit réellement lui planter son clou. Et pour cela, jeter au feu le médaillon qui contient une mèche de cheveux de son enfant ! Geste terrible qui est à la fois renoncement à l’affliction, acceptation du deuil et en même temps outrage à ses sentiments les plus profonds. Au curé épouvanté qui n’a pas réussi à récupérer la mèche, elle répond : « ce qui est fait est fait, je n’y peux rien » qui fait écho au « déjà fait » de la crucifixion. Tant pis, il fallait passer par cette ultime mutilation morale pour trouver la paix – se détacher de l’enfant mort et en même temps se venger de ce détachement. Le curé lui donnera tout de même sa bénédiction. Car le Christ accepte qu’on le cloue, du moment qu’on se décloue.
Nouvelle histoire de Mouchette : le seul suicide remis.
Mouchette n’aime pas la musique. Car la musique, c’est l’ordre, la joie, la célébration de la création et les remerciements au créateur. La musique est ce qui dit « oui », « merci » et « encore » à la vie. Or, de la vie, Mouchette ne connaît que la misère, la saleté et les coups. Lui dire qu’il y a « autre chose » c’est lui dire que cette « autre chose » existe sans elle, c’est lui donner conscience d’une joie dont elle est exclue. « Chaque note est comme un mot qui la blesse au plus profond de l’âme, un de ces mots lourds que les garçons lui jettent en passant, à voix basse, qu’elle feint de ne pas entendre, mais qu’elle emporte parfois avec elle jusqu’au soir, qui ont l’air de coller à la peau. » La musique agit comme un viol de l’âme.
Pourtant, lorsque M. Arsène se sera évanoui après sa crise d’épilepsie, elle se mettra à chanter pour lui et s’émerveillera de pouvoir le faire. Chanter pour autrui, même pour un meurtrier, est le secret du chant. D’ailleurs, pour Mouchette, le meurtre n’est pas plus répugnant que la vie avec « les gens de ce village détesté, noirs et poilus comme des boucs », au contraire, il excite sa révolte. L’assassinat n’est qu’une vengeance sociale, voilà tout.
Et M. Arsène, réveillé, la violera.
Mais pour une fille du peuple, être violée n’est pas pire qu’être battue. Comme chez Dostoïevski, l’enfant martyr est celui qui subit la violence familiale, « admise » par la société, avant de subir la violence criminelle, condamnée par cette même société. C’est que pour famille et société, seule la seconde fait des dégâts, alors que pour l’enfant battu, elle n’est que l’accomplissement de la première. Les coups sont une préfiguration et non une prévention du viol. Il faut être un bourgeois ou un prolo pour penser le contraire.
«Chez la plupart des filles de son espèce, la vie ne commence réellement qu’avec l’éveil des sens. C’avait été aussi pour Mouchette le temps des pires taloches, car le vieux avait sur ces choses la cruelle perspicacité particulière des rustres. »
La cruelle acuité du peuple, sa férocité vis-à-vis des siens, est un thème courant dans la littérature de ce temps. Comme Vallès, Zola ou Céline, Bernanos ne se lasse jamais de dénoncer la brutale éducation de son époque faite à coups de ceintures et d’exemples sauvages - comme dans ce dessin de Reiser qui nous revient spontanément à la mémoire, où pour apprendre à un petit paysan qu’il n’avait pas à sauver un des lapins de l’abattage, ses père et oncle prennent le sien et l’écorchent devant lui.
Ordures d’humbles.
Donc, le père bat sa fille comme plâtre pour « prévenir » tout débordement sensuel, mais après son viol, la fille confondra coups en viol en une même gigantesque blessure – à la seule différence qu’elle méprisait son père mais continuera d’admirer M. Arsène.
Le violeur, c’est celui qui force le corps… et le cœur. Si Mouchette dira plus tard que M. Arsène est son amant, c’est parce qu’elle aura vécu son viol aussi comme une libération sociale et un pressentiment d’amour. Violée, elle est blessée et révélée. Et ne peut s’empêcher d’aimer l’unique homme qui a eu l’air de l’aimer : « Ah ! si elle était sûre que M. Arsène la déteste ! Mais il ne la déteste pas. Elle n’a qu’à fermer les yeux, elle l’entend : « J’ai toujours eu de l’amitié pour toi. ». Le viol est cet atroce don de vie qui oblige à rendre grâce. Elle lui doit tout mais ce tout est abjection.
Et c’est cela qui la fait réellement souffrir, non tant le mal subi que le mal à venir – la conscience que la vie qu’on lui a donné est une vie sans espoir, éternellement, structurellement décevante. « Ce n’est pas de sa faute qu’elle a honte, non ! Elle hait sa déception fondamentale, la hideuse erreur où a sombré d’un coup sa jeunesse, sa vraie jeunesse, celle qui, hier encore, attendait de se détacher de l’enfance, de naître au jour, unique occasion perdue – ô souillure ineffaçable ! »
Au moins peut-elle enfin dire « merde » à son père. Désormais, « elle est seule, vraiment seule aujourd’hui, contre tous. » C’est son moment de gloire. Elle a un secret et une blessure qui font d’elle une héroïne de roman.
« Il lui faut un effort immense pour seulement comprendre qu’elle doit à sa déception d’amour une sorte de promotion mystérieuse, qu’elle est entrée ainsi du coup dans le monde romanesque à peine entrevu au cours de quelques lectures, qu’elle appartient désormais à ce peuple privilégié où les cœurs sensibles vont chercher, ainsi que l’amateur dans son vivier la truite la plus brillante, une belle proie pour leur pitié. »
Hélas ! le garde-chasse Matthieu est bien vivant, M. Arsène n’est pas un criminel mais un simple voleur de poules. Tous les deux se sont même réconciliés ! Et le cyclone n’était qu’une simple averse. Rien de ce qu’elle a vécu cette nuit-là n’est transfigurable. Comme dans Madame Bovary, la médiocrité s’impose comme unique réalité. Ne reste plus à Mouchette qu’à rencontrer la veilleuse des morts du village qui lui fait comprendre qu’il ne sert à rien de se défendre contre la mort quand on n’a plus d’espoir et que celle-ci est au contraire la seule consolatrice. Désespérer une âme pure, faire tout pour la pousser au suicide, c’est peut-être cela le péché contre l’esprit saint. Mais Dieu veille et ne laissera pas Mouchette passer du marais à l’enfer.
« La même force de mort, issue de l’enfer, la haine vigilante et caressante qui prodigue aux riches et aux puissants les mille ressources de ses diaboliques séductions, ne peut guère s’emparer que par surprise du misérable, marqué du signe sacré de la misère. »
Le suicide du misérable, comme celui de l’enfant, est le seul qui soit remis. Dans leur cas, le suicide est un rappel de Dieu. Et c’est pourquoi nous sommes soulagés que Mouchette meure et que « L’eau insidieuse [qui glisse] le long de sa nuque, [remplisse] ses oreilles d’un joyeux murmure de fête. »
Monsieur Ouine : l’anus maelström.
Pourquoi Monsieur Ouine est-il un livre difficile à lire en même temps qu’il est, comme le rappelle JA dans sa Littérature à contre-nuit, « le chef-d’œuvre de l’écriture bernanosienne » ? Parce qu’il n’explique rien de ce qu’il montre. Parce qu’il ne nomme pas ce qu’il énonce. On ne saura jamais si monsieur Ouine a tué le jeune valet des Malicorne ni si Steeny est violé par sa gouvernante, mais surtout on ne saura jamais ce qui se passe dans ce village où toute transcendance semble abolie. A Fenouille, l’espoir s’est retiré, mais personne ne s’en est rendu compte. A la crise morale de cette petite société correspond la crise du langage. On ne comprend plus rien car on a perdu le sens des choses. La seule qui compte est qu’il n’y ait pas de scandale, car le scandale obligerait à sortir de son indifférence. Et c’est pourquoi le maire peut dire à la lettre que rendre la justice l’ennuie, que la victime d’un meurtre cause beaucoup plus de soucis que son meurtrier et que si celui-ci n’est pas arrêté, ce n’est pas un drame :
« Son crime ! qu’est-ce qui lui en reste, de son crime ! Qu’est-ce qu’une ou deux pauvres minutes dans la vie d’un homme ? Au lieu que les macchabées, ils ont le crime au ventre, les cochons. »
La société peut continuer à vivre comme si de rien n’était.
La prouesse de Bernanos est d’avoir fait de son texte l’exact reflet de la vie qui règne à Fenouille – et ces scènes bizarres, ces dialogues déments échappent constamment à la compréhension du lecteur qui n’en pressent pas moins l’extrême violence qui se joue entre ces lignes insaisissables. Car justement, le mal est ce qui se fait sans se dire, qui fuit tout ce qu’il provoque, qui dégage dès les dégâts faits. Comme le diable, « c’est l’ami qui ne reste jamais jusqu’au bout ».
Le mal est moins carnassier que rongeur. Et précisément ronge-t-il les caractères les plus nobles, les vertus les plus irréprochables. Il excite moins les méchants qu’il ne pervertit les bons. Même la douceur, suprême qualité humaine s’il en est, est atteinte. Ce qui était chez la mère patience, mansuétude et amour, se transforme en défensive honteuse, abnégation perverse, fermeture à la vie.
« Pour tant de pauvres diables, la douceur n’est qu’absence, absence de malice ou de malignité, qualité négative, abstraction pure. Au lieu que la sienne a fait ses preuves, prudentes en ses desseins, hardie à prendre, vigilante à garder. Comment ne pas l’imaginer sous les espèces d’un animal familier ? Entre elle et la vie, le rongeur industrieux multiplie ses digues, fouille, creuse, déblaie, surveille jour et nuit le niveau de l’eau perfide. Douceur, douceur, douceur. A la plus légère ombre suspecte sur le miroir tranquille, la petite bête dresse son museau délié, quitte la rive, rame de la queue et de pattes jusqu’à l’obstacle et commence à ronger sans bruit, assidue, infatigable. »
Dans un monde pareil où l’on ne sait même plus si l’on souffre ou non, le cri désespéré de Steeny retentit comme le seul appel au secours : « Non, je ne suis pas libre, je-ne-veux-pas-l’être. » Voilà des tirets qui bouleversent. Steeny ne veut pas être libre, car il ne veut pas souffrir. Car prendre conscience de sa liberté, c’est en même temps prendre conscience de son impuissance. Etre libre, ce n’est pas choisir entre le bien et le mal (le credo petit bourgeois par excellence), c’est savoir qu’on a fait le bien ou le mal, qu’on a dit oui ou non. La liberté concerne moins l’acte que la conscience de l’acte. Steeny a cette conscience-là et c’est celle-ci qui, même s’il feint de ne pas l’avoir, le sauvera des griffes de Ouine et de ses mère et gouvernante. Pour l’heure, l’idée l’agresse. Le mot lui-même lui est insupportable. Tout comme celui de « bonheur ».
« Le mot même de bonheur - sa première syllabe de plomb, l’autre inachevée, béante – lui paraît sot. Celui de joie l’enivre par il ne sait quoi de bref, de fulgurant, d’irréparable. »
C’est que la joie est sans raison et que le bonheur en a trop. Le bonheur, « qui n’est pas gai » comme disait si justement Max Ophüls, est une construction morale et sociale qui demande des efforts et des économies et qui surtout dépend des autres. Et les autres, pour Steeny, ce sont les habitants de Fenouille, zombies désubstantialisés par ce monsieur Ouine – fade démon du lieu.
Décrit comme gras, gros et gluant, monsieur Ouine ressemble d’abord à Tartuffe, cet étranger qui s’immisce dans une famille (ici, un village), et qui, profitant des faiblesses et des mesquineries de chacun, finit par devenir propriétaire des lieux – mais à la différence du faux dévot, Ouine ne cherche pas à se faire passer pour un autre. Il n’est ni hypocrite ni dissimulateur. C’est « l’homme creux » dont parle JA dans ses travaux de dissection littéraire, qui aspire les âmes, les vide de leur joie et de leurs peines, déprime plus qu’il n’agresse.
« Quiconque l’approche n’a justement plus besoin d’aimer, quelle paix, quel silence ! L’aimer ? Je vais vous dire mon cœur : comme d’autres rayonnent, échauffent, notre ami absorbe tout rayonnement, toute chaleur. Le génie de monsieur Ouine, voyez-vous, c’est le froid. »
Froid comme l’enfer. Lui-même se décrit sur son lit de mort comme n’ayant été qu’ « orifice, aspiration, engloutissement, corps et âme, béant de toutes parts », en un mot, anus maelström à travers lequel s’engouffrent toutes les âmes qui le rencontrent.
Aussi basses soient-elles, celles-ci n’en existent pas moins, alors que lui – et c’est là son aveu final, n’existe pas. A Steeny le désespéré qui lui dit qu’il n’y a peut-être rien, « absolument rien », il répond sans colère ni indignation : « s’il n’y avait rien, je serais quelque chose, bonne ou mauvaise. C’est moi qui ne suis rien. » Le non-être « qu’il est » a beau dévorer tous les êtres, il se rend bien compte que du fait même qu’il les dévore, ils existent, et que s’il ne les dévorait pas, c’est lui qui n’existerait pas. Des monsieur Ouine, nous en avons tous rencontré un, ou une, ce sont ces êtres qui nous bouffent et qui crèvent dès qu’ils ne peuvent plus plus le faire.
Mais si les voies de Dieu sont impénétrables, alors, avoir rencontré Ouine aura permis à Steeny de faire la différence entre sa révolte (légitime) contre Dieu et l’indifférence infernale des hommes creux. Et que si la révolte consiste à dire « non » à Dieu, ce « non » est au moins une affirmation de soi-même – ce dont est bien incapable celui qui ne sait dire ni oui ni non**. Est-ce même par la révolte que l’on peut au bout du compte retrouver Dieu ? Après tout, si le gant s’est retourné à l’envers, il peut tout aussi bien se retourner à l’endroit – la grâce étant toujours prête à surgir derrière l’homme en passe de se damner.
« L’expérience même prouve que la révolte de l’homme reste un acte mystérieux dont le démon n’a peut-être pas tout le secret. »
LE DERNIER MOT DE LA REVOLTE N’EST PEUT-ETRE PAS CELUI DU DIABLE. Le voilà en plein, l’évangile bernanosien.
* En quoi consiste ce « non » au Saint-Esprit est la question qui nous obsède depuis toujours. Est-il même possible de nier Celui-ci en toute conscience quand Il se présente à vous ?
** Dans sa Littérature à contre-nuit, Juan Asensio doute que monsieur Ouine soit sauvé : « Je ne vois pas bien, écrit-il page 113, par quelle opération du Saint-Esprit la structure lacunaire, évidée, tronquée, négative de ce roman limite pourrait être investie d’une plénitude de sens, donc d’espérance… » Certes, Ouine en lui-même a assuré sa damnation, mais si l’on considère qu’il a permis à Steeny d’opérer, même négativement, la distinction entre lui, néant en action, et l’être, alors, il a servi, malgré lui, l’ordre de la grâce et dans ce cas…. Mais ne nous mettons pas à la place de Dieu, ne faisons pas notre Donissan, laissons Le mener Ses projets comme Il l’entend, et contentons-nous simplement de penser que Dieu est plus rusé que le diable.
(Journal de la culture n°14)
