 C’est le divin monstre de la littérature française. Un auteur dont tout le mal qu’on en dira sera toujours inférieur au bien qu’il nous a fait. Car, avouons-le, il faut d’abord apprendre à le lire, ce catholique fulminant, toujours survolté, toujours en colère, dont les enragements peuvent agacer et la verve tourner en rond. Parfois, l’intransigeance lasse, et la fureur perpétuelle ennuie. Mais quel homme ! Et quel écrivain ! En vérité, ce ténébreux voit clair. Cet hermétique dit les choses les plus simples et les plus réelles sur l’âme, l’enfer, la damnation. Confesserons-nous que nous lui devons une partie de notre conversion ? Et est-ce un mal de parler de soi quand on parle de Bernanos ? C’est qu’on l’a aussi détesté qu’on s’est investi en lui. Et on pourra le critiquer tant qu’on voudra, ce sera toujours lui le plus fort.
C’est le divin monstre de la littérature française. Un auteur dont tout le mal qu’on en dira sera toujours inférieur au bien qu’il nous a fait. Car, avouons-le, il faut d’abord apprendre à le lire, ce catholique fulminant, toujours survolté, toujours en colère, dont les enragements peuvent agacer et la verve tourner en rond. Parfois, l’intransigeance lasse, et la fureur perpétuelle ennuie. Mais quel homme ! Et quel écrivain ! En vérité, ce ténébreux voit clair. Cet hermétique dit les choses les plus simples et les plus réelles sur l’âme, l’enfer, la damnation. Confesserons-nous que nous lui devons une partie de notre conversion ? Et est-ce un mal de parler de soi quand on parle de Bernanos ? C’est qu’on l’a aussi détesté qu’on s’est investi en lui. Et on pourra le critiquer tant qu’on voudra, ce sera toujours lui le plus fort.
Mort et vie d’un démon de la sainteté
Il naît à Paris en 1888. Famille commerçante du côté du père, paysanne du côté de la mère. Enfance mystique. Jeunesse monarchiste. Réformé en 14, il s’engage quand même comme volontaire dans un régiment de hussards. Nombreuses blessures au champ d’honneur. En 1917, il se marie avec une descendante d’un des frères de Jeanne d’Arc dont il aura six enfants. Après la guerre, il reprend sa place dans l’Action Française, tout en collaborant aussi au Figaro, ce qui le brouille avec Maurras. Il ne supporte plus l’idéologie, et encore moins les compromissions avec elle (accords de Munich). En 1926, il publie Sous le soleil de Satan, premier roman mystique inspiré du curé d’Ars, qui sera couronné par le Grand Prix du roman de l’Académie Française. Suivront L’imposture, La joie, Un crime, Journal du curé de campagne - romans âpres, difficiles, parfois indigestes, mais qui touillent l’âme comme personne ne l’a fait avant et après lui. Des Baléares, où il séjourne, il assiste au début de la guerre d’Espagne et prend parti pour, puis contre Franco et les catholiques qui le soutiennent. Mais c’est au Brésil qu’il vivra les années de guerre dans une petite maison au creux d’une colline dénommée Cruz das almas, la Croix-des-âmes. C’est le temps des « écrits de combats ». Il soutient la Résistance et la France Libre mais ne rejoint pas Londres. De lui, de Gaulle dira un jour qu'il fut "le seul qu'il n'est pas parvenu à attacher à son char" . C’est aussi à cette époque qu’il rédige le roman le plus étonnant de la littérature française, Monsieur Ouine qui fait le bonheur des exégètes et des chercheurs d’énigmes ontologiques depuis soixante ans. A la Libération, de Gaulle le rappelle pour en faire un académicien ou un ministre, mais Bernanos, toujours aussi ombrageux et dégoûté par la médiocrité de ses compatriotes, préfère s’installer en Tunisie où il rédige les célèbres Dialogues des Carmélites. Avant de revenir à Paris pour y mourir en 1948.
Lire Bernanos ? C’est une épreuve. Comme tous ces chrétiens au service de Dieu, il est doté de cette empathie antipathique qui se fout d’être agréable ou joli, l’important étant de tenailler l’âme et de lui extirper ses démons. Tout ce qui détourne du salut (beauté, intelligence, morale) n’a pas lieu d’être. Le mal, c’est ce qui séduit. Lui sera l’auteur le plus antiérotique qui soit.
Alors, il faut y aller. Quatre voyages. Quatre romans (nos préférés). Quatre plongées dans l’abjection de la vie, car, comme le dit Bernanos dans Nouvelle histoire de Mouchette : « tout ce qui vit est sale et pue. »
 Sous le soleil de Satan : damné à la place du damné.
Sous le soleil de Satan : damné à la place du damné.
Le problème de Bernanos, c’est la damnation. Contrairement à ce que pensait Dostoïevski, ce n’est pas la souffrance des enfants qui accuse la miséricorde de Dieu, c’est la souffrance des damnés. Qu’il soit de feu ou de glace, l’enfer est insoutenable à quiconque y réfléchit pour de bon. Tous ces tièdes qui se croient brûlants en affirmant tranquillement que l’enfer existe... Ont-il déjà été brûlés par une flammèche ? Allons donc ! Pour eux, l’enfer, c’est pour les autres. Mais Dieu a de l’humour et sans doute ne met-Il en enfer que ceux qui pensent que d’autres y sont. Car enfin, si, comme le disent les théologiens, l’enfer est indifférence, les élus du paradis peuvent-ils être indifférents aux suppliciés de l’enfer ? Et comment faire la fête avec les anges en entendant les hurlements d’en bas de votre mère ou de votre fils ? Les curés nous répondent en confession que c’est là « le mystère de Dieu », et nous rassurent en précisant que si le Christ a parlé, et plusieurs fois, de la « géhenne du feu », Il n’a jamais nommé quelqu’un qui y était. Selon la belle expression d’André Frossard, l’enfer existerait mais sans qu’il y ait personne dedans. Pas même Judas – pour lequel l’enfant Bernanos allait demander à son curé de paroisse de prier. Prier pour Judas, prier pour le suicidé, prier pour celui que Dieu a abandonné à sa liberté de se damner, la voilà, la suprême charité - celle de l’abbé Donissan.
Trop facile de ne se faire que crucifier pour nous ! Le Christ avait beau jeu sur sa croix d’attendre que son petit calvaire de trois heures et demie se termine. Prendre la place du damné, risquer le pal éternel d’autrui, c’est une autre affaire. Donissan est celui qui vient se faire damner à la place du damné. Il est le saint prêt à donner son salut pour un autre. C’est pourquoi il recherche Satan. Pour le comprendre, le connaître, et lui arracher les âmes - pour le doubler. Si le diable est celui qui mime Dieu, Donissan sera celui qui mime Satan. Pour cela, il lui faut se déshumaniser, tuer en lui l’espérance, et surtout « déraciner » sa joie - car la joie est toujours le fait de ceux qui oublient les souffrances des autres. Gare aussi à l’intelligence qui n’est jamais qu’ « intelligence avec l’ennemi », et dont toutes les formes, accommodement, égoïste, charité intéressée, faiblesse organisée, constituent autant de brèches par lesquelles le diable s’immisce en nous. « -Nous te travaillerons avec intelligence, susurre-t-il à Donissan lors d’une de ses apparitions. Aie souci de nous nuire. Nous te tarauderons à notre tour. Il n’est pas de rustre dont nous ne sachions tirer parti. Nous te dégraisserons. Nous t’affinerons ». D’où le recours à « la pieuse sottise » qui est le meilleur rempart contre l’intelligence infernale. Ne plus comprendre, ne plus jouir, ne plus être tenté. Seuls les sots et les imbéciles l’emportent sur le diable.
Au fond, la sainteté de Donissan consiste à tenter le désespoir sans tomber dans le mal – gageure folle, car, comme le lui fait remarquer l’abbé Menou-Segrais, ce supérieur que Donissan n’estime pas parce que précisément il est trop intellectuel, le désespoir est ce qui conduit « de la haine aveugle du péché au mépris et à la haine du pécheur ». Donissan a beau se perdre devant Dieu, il perd les âmes qu’il voulait sauver. Mouchette se suicide, le petit garçon ne ressuscite pas. Le seul espoir est que Dieu les sauve quand même. Comme Judas, Donissan a voulu presser Dieu. Echanger son salut contre la damnation d’autrui, c’est bouleverser l’ordre de la grâce, c’est forcer Dieu à accueillir un réprouvé, et Satan à prendre un élu. C’est se croire plus rusé que le diable et plus altruiste que Dieu. Mais « Dieu ne se donne qu’à l’amour », et Donissan, à force de trop d’altruisme, a manqué d’amour. Le sacrifice ne conduit pas nécessairement au salut. C’était aussi cela le piège de Satan.
 Journal d’un curé de campagne : le Christ recrucifié..
Journal d’un curé de campagne : le Christ recrucifié..
Le Christ n’a pas assez souffert sur la Croix, tous les parents d’enfants morts vous le diront. Pour la comtesse, la haine de Dieu est le seul moyen qu’elle ait trouvé pour rester fidèle à son petit garçon. Mieux vaut être en enfer avec lui qu’au paradis sans lui. Aucune goutte de sang de ce dieu sacrificiel ne lui rendra la chair de sa chair. D’ailleurs, le Calvaire rachète-t-il quoique ce soit ? Comme nous la comprenons quand elle hurle au curé d’Ambricourt que « s’il existait quelque part, en ce monde ou dans l’autre, un lieu où Dieu ne soit pas – dussé-je y souffrir mille morts, à chaque seconde éternellement – j’y emporterai mon… (elle n’osa pas prononcer le nom du petit mort) et je dirais à Dieu : « satisfais-toi ! écrase-nous ! ».
Mais le curé sans nom fait face. Il sait que le blasphème est le langage de la souffrance, et que la haine de Dieu est encore un appel de Dieu. Il sait surtout qu’ à « celui qui dit une parole contre le Fils de l’homme, il lui sera fait rémission », et que la révolte contre le Christ n’est pas le blasphème contre l’esprit saint - qui, lui, ne sera pas remis. Cracher sur le Fils de l’Homme est « permis », c’est dire « non » au Saint Esprit qui est fatal. Aussi peut-il donner cette réponse sublime, une de celles qui retourne comme un gant la rage en apaisement : «Madame, si notre Dieu était celui des païens ou des philosophes (pour moi, c’est la même chose) il pourrait bien se réfugier au plus haut des cieux, notre misère l’en précipiterait. Mais vous savez que le nôtre est venu au-devant. Vous pourriez lui montrer le poing, lui cracher au visage, le fouetter de verges et finalement le clouer sur une croix, qu’importe ? Cela est déjà fait, ma fille… ». O révélation ! Tout ce que nous pouvions avoir de rage et de révolte contre le Christ est déjà du passé ! La croix a rendu ringards tous nos désespoirs, a consommé toutes nos peines – même celle de l’enfant mort ! Celui-ci nous attend au Ciel ! A quoi bon persister dans sa haine de Dieu ? A quoi bon refuser Sa grâce ? Après l’avènement du Christ, il faut être idiot pour rester en enfer. Car le Christ accepte qu’on le cloue, du moment qu’on se décloue.
 Nouvelle histoire de Mouchette : le seul suicide remis.
Nouvelle histoire de Mouchette : le seul suicide remis.
Mouchette n’aime pas la musique. Car la musique, c’est l’ordre, la joie, la célébration de la création, et la reconnaissance accordée au créateur. La musique est ce qui dit « oui », « merci » et « encore » à la vie. Or, de la vie, Mouchette ne connaît que la misère, la saleté et les coups. Lui dire qu’il y a « autre chose », c’est lui dire que cette « autre chose » existe sans elle, c’est lui donner conscience d’une joie dont elle est exclue. « Chaque note est comme un mot qui la blesse au plus profond de l’âme, un de ces mots lourds que les garçons lui jettent en passant, à voix basse, qu’elle feint de ne pas entendre, mais qu’elle emporte parfois avec elle jusqu’au soir, qui ont l’air de coller à la peau ». Pourtant, lorsque M. Arsène se sera évanoui devant elle, elle se mettra à chanter pour lui, et s’émerveillera de pouvoir le faire. Chanter pour autrui, même pour un meurtrier, est le secret du chant. D’ailleurs, pour Mouchette, un meurtrier n’est pas plus répugnant que « les gens de ce village détesté, noirs et poilus comme des boucs ». Au contraire, il excite sa révolte. L’assassinat n’est qu’une vengeance sociale, voilà tout.
Quant à être violée par lui, ce n’est pas pire que d’être battue par son père. «Chez la plupart des filles de son espèce, la vie ne commence réellement qu’avec l’éveil des sens. C’avait été aussi pour Mouchette le temps des pires taloches, car le vieux avait sur ces choses la cruelle perspicacité particulière des rustres » (c'est nous qui soulignons). Comme chez Dostoïevski, l’enfant martyr est celui qui subit la violence familiale, « admise » par la société, autant que la violence criminelle, condamnée par cette même société. La société blâme qu’on viole ses enfants mais pas qu’on les batte. Or, pour l’enfant battu, les coups ne sont qu’une préfiguration (et non une prévention, comme le croient les braves gens) du viol. Il faut être un bourgeois ou un prolo pour penser le contraire. Donc, le père bat sa fille comme plâtre pour « prévenir » tout débordement sensuel, mais après son viol, la fille confondra coups en viol en une même gigantesque blessure – à la seule différence qu’elle méprisait son père mais continuera d’admirer M.Arsène.
C’est que Mouchette a vécu son agression autant comme une libération sociale que comme un pressentiment d’amour. Violée, elle est blessée et révélée. Et ne peut s’empêcher d’aimer l’unique homme qui a eu l’air de l’aimer. Grâce au violeur, elle est femme adulte qui peut enfin dire « merde » à son père. Désormais, « elle est seule, vraiment seule aujourd’hui, contre tous. » C’est son moment de gloire. Elle a un secret et une souffrance qui font d’elle une héroïne de roman. « Il lui faut un effort immense pour seulement comprendre qu’elle doit à sa déception d’amour une sorte de promotion mystérieuse, qu’elle est entrée ainsi du coup dans le monde romanesque à peine entrevu au cours de quelques lectures, qu’elle appartient désormais à ce peuple privilégié où les cœurs sensibles vont chercher, ainsi que l’amateur dans son vivier la truite la plus brillante, une belle proie pour leur pitié ».
Hélas ! Il s’avère que M. Arsène n’a pas vraiment tué le garde-chasse et qu’il s’est même réconcilié avec lui. Le criminel antisocial n’était qu’un voleur de poules, comme le cyclone qu’elle s’est imaginée traverser n’était qu’une simple averse. Rien de transfigurable dans ce qu’elle a cru vivre. Comme dans Madame Bovary, la médiocrité s’impose comme unique réalité.
Ne reste plus à Mouchette qu’à se suicider – car comme le lui dit la veilleuse des morts du village, la mort reste encore le seul espoir pour celui ou celle qui n’en a plus. Pousser une âme simple à se supprimer, c’est peut-être cela le péché contre l’esprit saint. Mais Dieu veille et ne laissera pas Mouchette passer du marais à l’enfer. « La même force de mort, issue de l’enfer, la haine vigilante et caressante qui prodigue aux riches et aux puissants les mille ressources de ses diaboliques séductions, ne peut guère s’emparer que par surprise du misérable, marqué du signe sacré de la misère. » Le suicide du misérable, comme celui de l’enfant, est le seul qui soit remis – le seul rappel de Dieu, peut-être. Et c’est pourquoi nous sommes soulagés que Mouchette meure dans une « eau insidieuse » qui glisse « le long de sa nuque » et remplit « ses oreilles d’un joyeux murmure de fête. »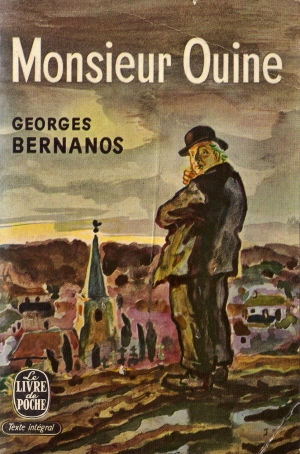 Monsieur Ouine : l’anus maelström.
Monsieur Ouine : l’anus maelström.
Pourquoi Monsieur Ouine est-il un livre si difficile à lire en même temps qu’il est, de l'avis de la plupart des bernanosiens le chef-d'oeuvre de son auteur ? Parce qu’il n’explique jamais rien de ce qu’il montre. Parce qu’il ne nomme pas ce qu’il énonce. On ne saura jamais si monsieur Ouine a tué le jeune valet des Malicorne, ni si Steeny a été violé par sa gouvernante. On ne saura pas, surtout, ce qui se passe dans ce village où toute transcendance semble abolie. Si l’espoir s’est retiré à Fenouille, personne ne s’en est rendu compte. L’essentiel est que la société puisse continuer à vivre comme si de rien n’était. La seule chose qui compte est qu’il n’y ait pas de scandale, car le scandale obligerait à sortir de son indifférence. Et c’est pourquoi le maire peut dire à la lettre que rendre la justice l’ennuie et que la victime d’un meurtre cause finalement plus de soucis que son meurtrier. « Son crime ! qu’est-ce qui lui en reste, de son crime ! Qu’est-ce qu’une ou deux pauvres minutes dans la vie d’un homme ? Au lieu que les macchabées, ils ont le crime au ventre, les cochons ».
A cette crise morale correspond une crise du langage. La prouesse de Bernanos est d’avoir fait de son texte l’exact reflet de la vie apathique qui règne à Fenouille – et ces scènes bizarres, ces dialogues déments, qui échappent constamment à la compréhension du lecteur, sont comme autant de trous dans lesquels sombrent sens et parole. Le mal, c’est-à-dire le diable, c’est ce qui se fait sans se dire, c’est ce qui fuit tout ce qu’il provoque, c’est ce qui dégage dès les dégâts faits. C’est, comme le dit Bernanos, « l’ami qui ne reste jamais jusqu’au bout ».
Dans ce monde où l’on ne sait même plus si l’on souffre ou non, le cri désespéré de Steeny retentit comme le seul appel au secours : « Non, je ne suis pas libre, je-ne-veux-pas-l’être ». Voilà des tirets qui bouleversent. Etre libre, ce n’est pas choisir entre le bien et le mal (le credo petit bourgeois par excellence), c’est savoir qu’on a fait le bien ou le mal, qu’on a dit oui ou non. La liberté concerne moins l’acte que la conscience de l’acte. Steeny a cette conscience-là, et c’est celle-ci qui, même s’il s’en défend, le sauvera des griffes de ses mère et gouvernante, sinon de tous les habitants de Fenouille, zombies désubstantialisés par ce monsieur Ouine – fade démon du lieu.
Décrit comme gras, gros et gluant, monsieur Ouine ressemble d’abord à Tartuffe, cet étranger qui s’immisce dans une famille (ici, un village), et qui, profitant des faiblesses et des mesquineries de chacun, finit par devenir propriétaire des lieux. Sauf qu’à la différence du faux dévot, Ouine ne cherche pas à se faire passer pour un autre. Il n’est ni hypocrite ni dissimulateur. C’est l'être dépressif (au sens propre) qui aspire les êtres et les vide de leur joie et de leurs peines. «Quiconque l’approche n’a justement plus besoin d’aimer, quelle paix, quel silence ! L’aimer ? Je vais vous dire mon cœur : comme d’autres rayonnent, échauffent, notre ami absorbe tout rayonnement, toute chaleur. Le génie de monsieur Ouine, voyez-vous, c’est le froid. » Froid comme l’enfer. Lui-même se décrit sur son lit de mort comme n’ayant été qu’ « orifice, aspiration, engloutissement, corps et âme, béant de toutes parts », en un mot, anus maelström à travers lequel s’engouffrent toutes les âmes qui le rencontrent.
Aussi basses soient-elles, celles-ci n’en existent pas moins, alors que lui – et c’est là son aveu final, n’existe pas. A Steeny le désespéré qui lui dit qu’il n’y a peut-être rien, « absolument rien », il répond sans colère ni indignation : « s’il n’y avait rien, je serais quelque chose, bonne ou mauvaise. C’est moi qui ne suis rien ». Le non-être « qu’il est » a beau dévorer tous les êtres, il se rend bien compte que du fait même qu’il les dévore, ils existent, et que lui n’existe qu’en tant que néant qui les vide de leur être.
Si les voies de Dieu sont si impénétrables qu’on ne le dit, alors avoir rencontré Ouine aura permis à Steeny de faire la différence entre son être révolté à lui et le non-être révoltant des hommes creux. Et si la révolte consiste à dire « non » à Dieu, ce « non » est au moins une affirmation de soi-même - ce dont est bien incapable celui qui ne sait dire ni oui ni non, ni ouine ni non. Est-ce même par la révolte que l’on peut au bout du compte retrouver Dieu ? Après tout, si le gant s’est retourné à l’envers, il peut tout aussi bien se retourner à l’endroit – la grâce étant toujours prête à surgir derrière l’homme en passe de se damner. « L’expérience même prouve que la révolte de l’homme reste un acte mystérieux dont le démon n’a peut-être pas tout le secret. »
Le dernier mot de la révolte n’est peut-être pas celui du diable. Le voilà en plein, l’évangile bernanosien.
(Cet article paru dans Le magazine des livres n°10 en juin 2008, à l'occasion de la réédition des oeuvres complètes de Bernanos chez Le Castor Astral sous la houlette de Gilles Bernanos, est une "reprise" revue et corrigée d'un ancien post sur Bernanos, "Bernanos - des pages qui changent une vie", commis en mai 2005)
