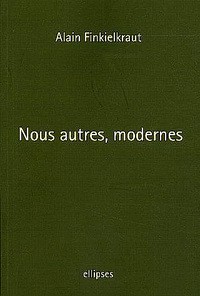En attendant la suite de mon autoportrait politique, je remets en ligne, et avec de nouvelles illustrations, ce (trop) long post consacré à l'essai d'Alain Finkielkraut, Nous autres, modernes, dévoré en son temps, et qui me semble être la transition idéale, un rien sérieuse, entre deux textes aussi égographiques que politiques - même si le premier a eu ses soixante dix commentaires ! Une lecture détergente, donc, à faire en plusieurs fois, vu la taille du truc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Le Moderne ne s’oppose plus qu’au Moderne. La rupture se bat avec la cassure. La contradiction avec la dérangeance. L’art de maintenant avec l’art d’actuellement. Le neuf avec le nouveau. L’instable avec le mouvant. Le changeant avec le mutant. Le déraisonnable avec le délirant. Le dingue avec le fou. Le transgressant avec le dépassant. »
Philippe Muray, Moderne contre Moderne, Exorcismes spirituels IV.
Ouest contre ouest, rationnel contre rationnel, « moderne contre moderne », et même islam contre islam. Il semble que le débat contemporain ne se passe plus qu’à l’intérieur des mêmes entités et non plus entre elles. On ne joue plus tant à la bataille qu’au solitaire. L’adversaire est le frère d’arme plus que celui du camp d’en face – à celui-ci, on est d’ailleurs tenté de souhaiter un « joyeux Noël » comme dans le film de Christian Carion. De même en politique, les combats les plus rudes ont moins lieu entre la droite et la gauche qu’entre différentes droites et différentes gauches. On se dispute les tolérances, on s’étripe les droits de l’homme, on s’écartèle les bonnes causes. Que l’on décide de voter une loi contre les insultes sexistes et homophobes, et voilà certaines féministes qui s’indignent que l’on va désormais être plus attentif à la dignité des homosexuels qu’à celle des femmes. Et lorsque l’on reparle de la lutte contre le racisme, c’est à savoir de qui entre les noirs, les arabes, les juifs et les asiatiques, en attendant les corses et les bretons, voire les parisiens et les provinciaux, sont les plus menacés. Ainsi, comme le note Philippe Muray en riant, « le communautariste se dresse contre le pluraliste, le pluraliste contre le multiculturaliste, le multiculturaliste contre le multicommunautariste ». Tout cela, bien sûr, au nom d’une modernité (plurielle !) qui est devenue notre seul horizon et vers lequel il est impossible d’arrêter, voire de freiner notre bateau ivre sans se faire disqualifier. Malheur au marin qui se laisserait aller à la contemplation de la mer allée avec le soleil ! Et malheur à Alain Finkielkraut qui ne la ramène toujours que pour ralentir notre course et nous obliger à passer devant les yeux horribles des pontons de la modernité..
Prométhée contre Orphée
Faut-il être moderne ? demande en premier lieu l'auteur cultissime de La défaite de la pensée. Oui, bien sûr. En fait, nous le sommes tous, modernes, même les anti-modernes, même les réacs. Quoiqu’ils disent, ils sont d’accord, sinon dans leurs « opinions », du moins dans leur comportement, avec l’idée qu’en l’homme la liberté prime sur la nature et que par celle-ci il peut agir sur celle-là.
C’est en 1482 que Pic de la Mirandole écrit son Oratio de hominis dignitate et dans lequel Finkielkraut voit la naissance de la pensée moderne. L’homme est désormais celui dont l’agir ne découle pas de l’être mais l’être de l’agir. Et la Vérité n’est plus fille de l’Autorité ou de l'Eternité - mais du temps. L’on pourra toujours invoquer comme Joseph de Maistre l’ancienne onto-théologie, le langage que l’on utilisera pour le faire sera malgré lui empreint de cette modernité détestée. On plaidera pour un retour en arrière avec un langage en avant. Quoiqu’on veuille lui faire dire de régressif, le Verbe se sera humanisé (corrompu diront les « moisis »). Maistre aura beau faire l’apologie du Roi et du Pape, lorsque nous entendrons sa voix, nous n’entendrons plus que les cris et les râles des suppliciés de sa majesté et de sa sainteté. Et de même, ce qui nous fera prendre nos distances avec la modernité seront précisément ses cris et ses râles à elle.
 C’est la mort et la souffrance qui nous ont dégoûté d’une certaine tradition, ce sera la mort et la souffrance qui nous dégoûteront d’une certaine modernité. Au fond, c’est toujours l’enfer qui nous fait agir ou réagir.
C’est la mort et la souffrance qui nous ont dégoûté d’une certaine tradition, ce sera la mort et la souffrance qui nous dégoûteront d’une certaine modernité. Au fond, c’est toujours l’enfer qui nous fait agir ou réagir.
Avec ses camps de la mort, ses goulags et ses laogaï, le XX ème siècle a pu nous faire relativiser quelque peu les mérites infinis de la modernité. Après dix neuf siècles chrétiens, certes plein de croisades, d’inquisition et de supplices, un siècle d’athéisme aura suffi à nous faire dire, à l’instar d’Andréi Tarkovski, que le vingtième n’avait pas quarante ans qu’il était déjà le pire que l’histoire ait connue. Et Vassili Grossman, dans Vie et destin, le Guerre et Paix du XX ème siècle, a pu montrer la consanguinité du nazisme et du communisme – héritiers monstrueux mais modernes de l’athéisme de masse, l’industrialisation totale de l’homme, l’utopie socialiste, qu’elle soit nationale ou soviétique.
Difficile en effet, après ces dizaines de millions de morts, de parler encore d’un « travail du négatif » au service d’une raison supérieure de l’histoire et du progrès humain. Après Auschwitz, ce n’est pas tant la poésie qui est caduque que la dialectique. Alors que l’on pouvait toujours légitimer, malgré leurs crimes, César, Alexandre ou Napoléon, et considérer que tout n’était pas négatif dans la colonisation ou l'inquisition (invention de la loi moderne !), l’on ne peut en revanche rien récupérer de « positif » dans l’hitlérisme, le marxo-léninisme et le maoïsme. L’agrégat a rendu impossible le processus. Comme le dit Michel Foucault, cité par Finkielkraut,
« l’épreuve décisive pour les philosophes de l’Antiquité, c’était leur capacité à produire des Sages ; au Moyen Age, à rationaliser le dogme ; à l’âge classique, à fonder la science ; à l’époque moderne, c’est leur aptitude à rendre raison des massacres. Les premiers aidaient l’homme à supporter sa propre mort, les derniers à accepter celle des autres. »
 En vain, bien entendu, car si l’on est en droit et même en devoir d’accepter la mortalité de l’homme, il nous semble obscène de légitimer la mort des hommes. Autant nous sommes prêts à accepter la condition tragique de l’humanité et à comprendre celle-ci à travers le péché originel ou la dette antique, autant nous sommes scandalisés devant l’idée qu’un bien (imposé) pour tous dépende du sacrifice de quelques-uns (quelques millions de quelques uns devrait-on dire plus justement), selon l'abject credo que l’on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs ni de révolutions sans casser des hommes, des femmes et des enfants. Une catastrophe naturelle qui tue trois mille personnes nous choque moins qu’un César Battisti qui en tue deux au trois au nom d’un "idéal fraternel".
En vain, bien entendu, car si l’on est en droit et même en devoir d’accepter la mortalité de l’homme, il nous semble obscène de légitimer la mort des hommes. Autant nous sommes prêts à accepter la condition tragique de l’humanité et à comprendre celle-ci à travers le péché originel ou la dette antique, autant nous sommes scandalisés devant l’idée qu’un bien (imposé) pour tous dépende du sacrifice de quelques-uns (quelques millions de quelques uns devrait-on dire plus justement), selon l'abject credo que l’on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs ni de révolutions sans casser des hommes, des femmes et des enfants. Une catastrophe naturelle qui tue trois mille personnes nous choque moins qu’un César Battisti qui en tue deux au trois au nom d’un "idéal fraternel".
Or, pour certains de nos modernes, les plus à gauche dirons-nous pour plus de commodité, c’est le péché, notion anti-moderne par excellence qui est à rejeter absolument, et c’est la dialectique, pour laquelle rien n’est tragique, qu’il faut réhabiliter coûte que coûte. Pour ces derniers, le don des larmes (cette expression humble et sublime qui nous vient de la tradition mystique du catholicisme) n’est jamais qu’un abus de sensibilité « bourgeoise » destiné avant tout à nous empêcher d' « agir » - l’ « action » devant primer sur tout et d'abord pulvériser ces sports de riche que sont la contemplation, la prière ou le poème. Si l’on veut pleurer, et bien, que l’on pleure pour les damnés de la terre, les petits africains qui meurent de faim, et toutes les victimes de l’exploitation de l’homme par l’homme, mais que l’on se garde bien d’en faire autant pour le voisin du dessus qui s’est jeté par la fenêtre ou pour l’alcoolique d’à côté qui a tout perdu à cause de son vice.
D'ailleurs, cette modernité-là préfère les sanglots aux larmes, le chagrin collectif et abstrait plutôt que celui provoqué par une singularité crucifiée. On ne pleure plus son prochain, on pleure son lointain. On est ému non plus par humanité mais par principe humanitaire.
« Cruauté idéologique, idéologie lacrymale ; horreur noire, bibliothèque rose »,
écrit Finkielkraut avec génie. Le chagrin privé est à bannir car il est ce qui détourne de la cause. Quand on pleure sa mère, on n’est plus dans le coup. Et c’est en effet dans les jours qui ont suivi la mort de sa mère que Roland Barthes a écrit la fameuse phrase :
« Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent d’être moderne ».
Du deuil privé, qui fait partie de « l’ordre des choses », au deuil collectif, dont l’histoire aurait pu se passer, c’est toujours la mort qui s’immisce dans la belle âme et qui, selon notre objecteur de conscience, freine son adhésion à ce qui va être tant lui manque ce qui n’est plus. Le devoir de mémoire naît contre le devoir d’être moderne. Se reconnaît ainsi le moderne à ce qu’il n’a jamais vécu la mort, qu’il ne sait pas ce que signifie survivre et qu’il ne cherche à exister qu’en fonction de ce qui va arriver. Son souci est d’aller toujours de l’avant comme Prométhée en prenant garde de ne jamais se retourner comme Orphée l’a fait avec Eurydice. Au contraire, l’anti-moderne est le survivant d’un monde ou d’un amour perdus dont il se considère comme le débiteur ou l’héritier.
« Le conservateur, c’est l’homme qui accueille le donné comme une grâce et non comme un poids, qui a peur pour ce qui existe et qu’émeut toujours la patine du temps sur les êtres, les objets ou les paysages (…) Sensible à ces maux, incapable de tourner la page, le conservateur voit des mondes finir là où d’autres regardent s’accomplir la fin de l’histoire. A l’optimisme démocratique de la révolution, il oppose son amour mélancolique du déjà-là et des vieilles traditions chancelantes. Il vit sous le regard des morts, il plaide pour la félicité, il est celui qui regrette la lenteur quand tout s’accélère et qui trouve constamment trop cher le prix à payer pour ce qu’on appelle le progrès ».
Au siècle des Lumières, il préfère la lumière des siècles, selon la belle expression de Villiers de l’Isle-Adam. Surtout, il ne croit pas à l’origine sociale des choses et fait la grimace quand on lui explique que seule la situation matérielle rend compte « concrètement » de tous les phénomènes humains – et qu’il suffirait de changer le système pour trouver le bonheur absolu. Pessimiste par nature, c’est-à-dire convaincu que l’imperfection de la vie n’est pas politique mais originelle, et que l’on n’éliminera pas le mal par un décret, une réforme ou une révolution, le conservateur admet la tragédie du monde et préfère cultiver son jardin et sauver son âme plutôt que sauver le monde contre lui-même et le détruire encore plus. Ainsi estime-t-il que si l’égalité est un moyen de préserver la dignité de l’homme, elle ne saurait être une fin en soi. L’égalité parfaite est un idéal qui se retourne contre lui-même et se transforme en goulag… ou en démocratie dégénérée.
 Foutaise de la « fracture sociale ».
Foutaise de la « fracture sociale ».
Ce que n’ont pas vu les marxistes, c’est que le moteur de l’histoire n’est plus la lutte des classes, si elle ne le fut jamais, mais ce que Tocqueville appelle « le développement graduel de l’égalité des conditions » La démocratie a fait que l’homme ne rencontre plus que son semblable. Certes, il y a toujours des riches et des pauvres, mais la donne a changé : il n’y a plus de supérieurs et d’inférieurs, de nobles et de manants. L’appartenance sociale ne définit plus l’individu. L’homme est à égalité avec lui-même. Ce qui relevait de la nature relève maintenant de la convention. La hauteur n’impressionne plus personne.
A cela, les imbéciles rétorquent que si la distinction a été abolie, l’inégalité n’a pas du tout disparu, et même l’écart entre les nantis et la plèbe persiste de plus belle. D’ailleurs Tocqueville lui-même ne parle-t-il pas d’ « égalité imaginaire » ?
« Mais dans le lexique de Tocqueville, rappelle Finkielkraut, imaginaire ne veut pas dire illusoire ou fictive. L’imagination dont il crédite l’opinion démocratique n’est pas folle mais révélante. Elle ne s’absorbe pas dans les images, elle détruit les idoles. Elle ne fabule pas, elle déconstruit »
Egalité non pas économique mais ontologique et sociale. Et c’est pourquoi l’on peut dire avec Renaud Camus que s’il y a bien une fracture économique,
 « IL FAUT ETRE SOURD, AVEUGLE ET AMNESIQUE POUR CROIRE QU’IL Y A ENCORE UNE FRACTURE SOCIALE. Les barrières ont cédé : l’indifférenciation règne. Du bas en haut de l’échelle, des marges à la jet set, le même homme démocratique, soucieux d’être authentiquement ce qu’il est par- delà le rôle, le rang ou le moment, déchire le voile des convenances et s’exprime avec la même décontraction, dans le même idiome relâché. Tout en restant divisé, la société s’homogénéise et la pensée critique qui s’entête à opposer les droits formels aux droits réels passe à côté de l’essentiel, c’est-à-dire de la pression qu’exerce continûment la cravache de l’imagination démocratique sur la réalité effective. »
« IL FAUT ETRE SOURD, AVEUGLE ET AMNESIQUE POUR CROIRE QU’IL Y A ENCORE UNE FRACTURE SOCIALE. Les barrières ont cédé : l’indifférenciation règne. Du bas en haut de l’échelle, des marges à la jet set, le même homme démocratique, soucieux d’être authentiquement ce qu’il est par- delà le rôle, le rang ou le moment, déchire le voile des convenances et s’exprime avec la même décontraction, dans le même idiome relâché. Tout en restant divisé, la société s’homogénéise et la pensée critique qui s’entête à opposer les droits formels aux droits réels passe à côté de l’essentiel, c’est-à-dire de la pression qu’exerce continûment la cravache de l’imagination démocratique sur la réalité effective. »
Pauvre pensée critique qui oppose le réel au symbolique sans s’apercevoir que de toute éternité et partout il n’y eut jamais rien de plus réel que le symbolique. Dire que dans une démocratie ce qui compte est moins la situation que l’intention n’est donc pas du tout se foutre du monde. Le droit à chacun d’être tous l’a emporté sur la différences des intelligences et des éducations. Le plouc vaut socialement et politiquement autant que l’érudit, et comme il y a plus de ploucs que d’érudits, et que c’est la majorité qui prime, ce seront les érudits qui devront accepter les décisions des ploucs. Déjà, dans La défaite de la pensée, Alain Finkielkraut stigmatisait le triomphe malfaisant du tout culturel. Dans un monde démocratissiste, s’il n’y a plus de têtes aristocratiques à couper, il reste des esprits aristocratiques à gazer. De l’excellence, faisons aussi table rase.
Déculturation, scientisme et positive attitude
Le pire est que ce nivellement par le bas n’est pas tant le fait de la masse elle-même que celui d’ intellectuels accordant, ou faisant semblant d'accorder à la masse le droit d’être aussi intellectuelle qu’eux. L’ennemi de l’une et des autres, c’est "l’imbuvable classe dominante" qu'il faut absolument mettre à terre. Or, comme la culture appartient à cette classe dominante, il faut faire haro sur elle. Et d’abord désacraliser l’œuvre d’art, car à travers elle c’est Dieu que l’on abolit et le bourgeois que l’on renverse. La seule valeur qu’on daigne laisser à la littérature est celle de témoigner de son époque, mais pas plus. Molière nous parle éventuellement du XVII ème siècle mais c’est une erreur profonde, voire une faute sociale que de croire qu’il nous concerne encore – nous les Précieux Ridicules, les Bobos Gentilhommes et les Dépressifs Imaginaires du XXI ème siècle. Comme dit Sartre, « Les livres qui passent d’une époque à l’autre sont des fruits morts » - sans doute parce qu’il pressentait que les siens allaient pourrir presque sitôt écrits.
L’autre tendance consiste à partager le Verbe entre tous. Au nom de l’indistinction, marque distinctive de la modernité démocratique, le lecteur devient un producteur de textes comme un autre. D’ailleurs, il n’y a plus de texte mais seulement de l’intertextualité.
« L’eschatologie égalitaire réclame à la fois que nous soyons tous auteurs et que s’efface pour de bon la figure paternelle, transcendante, intimidante de l’Auteur. Tous auteurs dans un monde sans auteur : telle est la formule ultime de l’égalité. »
L’aristocratie de l’excellence artistique et philosophique n’existe plus. La culture a fait sa nuit du quatre août. Défaite de la pensée à laquelle personne ne résistera. Comment pourrait-on s’en prendre à ce qui nous donne tant de bien-être, nous promet la liberté et nous permet l’égalité parfaite ? On ne peut plus rien contre des gens qui sont heureux et qui ne sentent plus ni la mort ni l’éternité.
 « Ils seront heureux et ne sauront rien de leur déchéance », disait déjà Witkiewicz dans L’adieu à l’automne.
« Ils seront heureux et ne sauront rien de leur déchéance », disait déjà Witkiewicz dans L’adieu à l’automne.
A quoi bon des poètes et des romanciers dans un monde moderne? L’assentiment à ce qui est de toute éternité n’est plus de mise et la parole poétique qui dit l’essence des choses n’a plus cours dans un monde où l’existence précède l’essence. Mais puisque, paraît-il, nous avons eu de grands poètes, eh bien nous organiserons des « printemps » rien que pour eux – et ainsi dans le métro, des hauts-parleurs nous réciteront, sans qu’on n’ait rien demandé, des vers de Baudelaire ou de Verlaine. La poésie pour tous et non plus pour chacun - tel est l'un des credo contemporains. La sociologie a de toutes façons investi tout le champ existentiel. Le moi a été mis au piquet par le nous. Toute pensée n’est qu’un produit social comme toute poésie n’est qu’une construction psychologique. La seule tâche de la post-culture est de mettre à l’horizontale l’ancienne verticalité des arts et des lettres.
« Le soupçon est entré dans le sanctuaire ; les gardiens du temple ont perdu la foi ; les passéistes ont pris un coup de jeune (…) l’intelligence se fait gloire d’abattre le mur érigé par une tradition aristocratique entre l’admirable et l’ordinaire. »
Le culturel a bien pulvérisé le cultivé. Le mot d'ordre, désormais, c'est : « Tous auteurs dans un monde sans auteur ! »
Il est évident que l’avènement scientifique a largement contribué à transformer notre relation au monde et notre statut d’humain. Il est encore plus évident de reconnaître que les progrès technologiques et scientifiques nous ont fait plus de bien que de mal. Nous sommes tous modernes au sens où le soulagement de la condition de l’homme est devenu, depuis Descartes, l’idéal (nous devrions dire plutôt : « la méthode ») qui a remplacé celui, classique, de la contemplation désintéressée de l’éternel. Encore une fois, personne ne renoncera à son confort médical, social et moral. Il n’est pas sûr en revanche qu’au nom de celui-ci l’on ne renonce pas à son humanité.
En fait, il s’agit de voir en quoi la modernité nous a autant libéré des maux traditionnels que des biens originels.
« Tout le malheur des hommes ne vient pas de ce qu’ils ont d’abord été des enfants, comme le prétend Descartes, mais de ce qu’ils ont voulu annuler leur date et leur dette de naissance. »
Si la mode n’est plus, Dieu merci, au « sustine et abstine » - « souffre et abstiens-toi » cher à Joseph de Maistre, elle n’est plus non plus au « connais-toi toi-même » ou au « Anagké sténaï » - « il faut s’arrêter » propre aux Grecs. Nous ne nous connaissons plus en tant qu’êtres humains et nous ne nous arrêtons plus dans notre technologisme inhumanisant, notre industrialisation désincarnante, nos tentatives d’immortalité et d’abolition de la douleur par le clonage.
C’est contre ces atteintes de l’être qu’en avait déjà le romantisme.
« A la clarté du concept, [celui-ci] oppose les replis, les demi-teintes, les contradictions de la présence humaine. La réalité, dit-il, transcende l’intelligibilité. Et nul privilège d’extraterritorialité ne doit être accordé à la conscience : celle-ci n’est pas une instance séparée, disjointe, coupée de toute tradition et de toute collectivité. Elle a une géographie, une histoire, un patrimoine de mots, avec leurs harmoniques, leurs résonances venues du fond des âges et qui se saisissent d’elle au moins autant qu’elle se saisit d’eux. Je pense parce qu’il y avait quelqu’un avant moi. Toute première fois a une passé. Toute prise de conscience est une reprise. »
Certes, cher Finkielkraut, on ne pense pas de soi-même par soi-même. On n’atteint pas la maîtrise sans maîtres. Mais ces derniers peuvent-ils encore être des écrivains ? Au fond, depuis Galilée, tout est devenu « littérature ». La science a sonné le glas de l’âge symbolique, les fanfares ont célébré le début de l’âge opératoire. Le soleil ne tourne plus autour de la terre et l’homme commence à avoir le tournis. C’est « la grande vexation cosmologique de l’héliocentrisme. »
En 1929 paraît à Vienne, sans nom d’auteur, mais préfacé par d’éminents mathématiciens et logiciens de l’époque La conception scientifique du monde. Le monde n’est plus que ce que la science en dit. La métaphysique avec ses grands mots, « inconditionné », « infini », « Etre de l’étant », « Esprit absolu », est bonne à jeter aux orties – un métaphysicien n’étant rien d’autre qu’un musicien sans talent. Quant à la philosophie, elle n’apporte rien à la connaissance mais peut avoir sa place en tant que méthode de l’analyse logique. Autrement dit, la pensée est une technique comme une autre - la technique (et son corollaire le social dans les sciences humaines) s’imposant du reste comme le seul regard possible, « objectif », valable, sur les choses. Aux grandes questions d’antan, seule la question « comment ça marche ? » a droit de cité. « Ni traces, ni symbole, ni analogie – lois. »
 A ce scientisme triomphant, deux vrais philosophes vont répondre. Le premier, Husserl, montrera dans sa Crise de l’humanité européenne « comment » la révolution galiléenne, dont se réclame le cercle de Vienne, a accompli la mathématisation totale du monde et finalement recouvert de ses chiffres toutes les lettres, la parole n’étant plus considérée que comme une équation comme une autre. Le second, évidemment Heidegger, définira cette sommation du réel par la seule raison selon le fameux concept d’Arraisonnement – « Gestell ». Sera dit « arraisonné » l’être que l’on ne requiert qu’en vue d’une rationalisation totale et fonctionnelle, d’une simple pratique du monde. Dès lors, la question qui se pose est de savoir comme un homme qui a si bien vu la désincarnation de l’homme a-t-il pu participer à une politique qui organisa la plus terrible destruction de celui-ci ? Comment le penseur génial de l’Arraisonnement a-t-il pu se montrer « arraisonnable » à ce point ? Dit autrement, comment un contempteur de la modernité comme lui ne s’est-il pas aperçu de ce que le nazisme avait de plus effroyablement moderne ? On laissera aux historiens le soin de répondre comme il se doit à cette question, mais l’on se demandera quand même si le rejet que provoque encore aujourd’hui Heidegger tient moins à son engagement dans cette barbarie absolue que fut le nazisme qu’à sa critique de la modernité comme barbarie. Heidegger ne serait-il pas finalement plus coupable aux yeux des modernes d’avoir dit que le nazisme était moderne plutôt que d’avoir été nazi ?
A ce scientisme triomphant, deux vrais philosophes vont répondre. Le premier, Husserl, montrera dans sa Crise de l’humanité européenne « comment » la révolution galiléenne, dont se réclame le cercle de Vienne, a accompli la mathématisation totale du monde et finalement recouvert de ses chiffres toutes les lettres, la parole n’étant plus considérée que comme une équation comme une autre. Le second, évidemment Heidegger, définira cette sommation du réel par la seule raison selon le fameux concept d’Arraisonnement – « Gestell ». Sera dit « arraisonné » l’être que l’on ne requiert qu’en vue d’une rationalisation totale et fonctionnelle, d’une simple pratique du monde. Dès lors, la question qui se pose est de savoir comme un homme qui a si bien vu la désincarnation de l’homme a-t-il pu participer à une politique qui organisa la plus terrible destruction de celui-ci ? Comment le penseur génial de l’Arraisonnement a-t-il pu se montrer « arraisonnable » à ce point ? Dit autrement, comment un contempteur de la modernité comme lui ne s’est-il pas aperçu de ce que le nazisme avait de plus effroyablement moderne ? On laissera aux historiens le soin de répondre comme il se doit à cette question, mais l’on se demandera quand même si le rejet que provoque encore aujourd’hui Heidegger tient moins à son engagement dans cette barbarie absolue que fut le nazisme qu’à sa critique de la modernité comme barbarie. Heidegger ne serait-il pas finalement plus coupable aux yeux des modernes d’avoir dit que le nazisme était moderne plutôt que d’avoir été nazi ?
Les infortunes de l’intellectuel.
Contrairement à ce que pensait Michel Winock, le XX ème siècle aura eu peu de chance avec ses intellectuels. Pour un Heidegger compromis avec le nazisme (alors que philosophiquement il n’aurait pas dû en être), des centaines de Sartre ou de sous-Sartre qui ont été politiquement et philosophiquement à la botte du communisme, et qui, quoiqu’on dise, quoiqu’on fasse, ont toujours pignon sur rue. A ses égarements, ses erreurs et ses complaisances s’ajoutent le fait que l’intellectuel a été perçu et a fini par se percevoir lui-même comme une belle âme inactive et impuissante, un bavard impénitent qui en a plus pour sa chaire et son carrosse que pour sa cause, un homme inutile et incertain.
Dans un monde placé sous le signe de la praxis, sinon de la guerre et de la révolution, il est vrai qu’il fait triste mine avec ses appareils de réflexion et ses théories critiques. Plus que nul autre, il doit comparaître au tribunal de l’Histoire Universelle, et c’est cette comparution qui inspire à Finkielkraut cette belle page masochiste :
 « Il doit répondre de ses privilèges, de son inaction, de son aisance, de son inutilité, de son intérieur calfeutré, de ses ongles soignés, de son embourgeoisement et lui, l’oisif, lui, l’homme du primat du spirituel, de sa complicité objective avec la classe dominante. Et puis, quoi qu’il fasse, il tire à blanc. Il ne connaît que métaphoriquement l’épreuve du feu. Ses mots, aussi précis, aussi cruels, aussi blessants soient-ils, ne sont jamais que des mots. (…) Il méprise les militaires et la mort au champ d’honneur, mais l’image ineffaçable du militant révolutionnaire fauché en plein assaut ne cesse de lui rappeler qu’il ne fait pas le poids. Il s’en veut, il rougit intérieurement d’être un combattant de pacotille dans un monde ensanglanté. Il agit certes, il attaque, il dénonce, il accuse ; le soupçon cependant le tourmente et le nargue de n’avoir jamais franchi le pas de l’action véritable, c’est-à-dire violente. A peine a-t-il comparé sa plume à un pistolet ou ses phrases à des projectiles que déjà il se traite de menteur. (…) What do you read my Lord ? – Words, words, words. »
« Il doit répondre de ses privilèges, de son inaction, de son aisance, de son inutilité, de son intérieur calfeutré, de ses ongles soignés, de son embourgeoisement et lui, l’oisif, lui, l’homme du primat du spirituel, de sa complicité objective avec la classe dominante. Et puis, quoi qu’il fasse, il tire à blanc. Il ne connaît que métaphoriquement l’épreuve du feu. Ses mots, aussi précis, aussi cruels, aussi blessants soient-ils, ne sont jamais que des mots. (…) Il méprise les militaires et la mort au champ d’honneur, mais l’image ineffaçable du militant révolutionnaire fauché en plein assaut ne cesse de lui rappeler qu’il ne fait pas le poids. Il s’en veut, il rougit intérieurement d’être un combattant de pacotille dans un monde ensanglanté. Il agit certes, il attaque, il dénonce, il accuse ; le soupçon cependant le tourmente et le nargue de n’avoir jamais franchi le pas de l’action véritable, c’est-à-dire violente. A peine a-t-il comparé sa plume à un pistolet ou ses phrases à des projectiles que déjà il se traite de menteur. (…) What do you read my Lord ? – Words, words, words. »
Infortuné intellectuel qui lorsqu’il s’engage se trompe immanquablement et lorsqu’il ne s’engage pas est accusé d’être un lâche et un déserteur ! Le moyen aussi de trouver une place dans une société qui encourage la révolte à tout va et donne des bons points à « tout discours en marge » ? Car si le conservatisme aujourd’hui est la honte, la radicalité, elle, est subventionnée. Et Finkielkraut de rappeler ce concours d’écriture organisé il y a quelques années par Le monde et Télérama sur un thème ainsi libellé : « Paroles de révoltes. Place aux paroles en rupture, paroles de mouvement et de rébellion, paroles de tous ceux qui savent se cogner aux interdits et aux stéréotypes. » Ah le foutage de gueule intégral ! Reconnaissons-le : si un jour la modernité nous fait mourir, ce sera de rire. Est venu le temps de la distribution des prix de désobéissance ! Tableau d’honneur à celui qui transgressera le plus ! Mais félicitations à celui par qui le scandale arrive ! Le plus drôle, c’est quand le scandale arrive pour de bon avec des œuvres qui prennent vraiment l’époque à rebrousse poil comme La passion du Christ de Mel Gibson ou bien La chute de d’Olivier Hirschbiegel – les deux seuls films qui ont vraiment heurté ces derniers temps la sensibilité officielle – et qui du reste se sont fait descendre par des critiques au bord de l’apoplexie. Pareil en littérature. On plaide pour le grand livre « dérangeant », celui que bien sûr la critique officielle encensera, mais qu’un Houellebecq, un Dantec, un Renaud Camus… ou un Finkielkraut s’impose, et c’est immédiatement le branle-bas de combat, la chasse à cours, l’autodafé. Rendons hommage à Alain Finkielkraut que nous suivons depuis longtemps et qui pour le coup mériterait, lui, un vrai prix de désobéissance et de non-suivisme intellectuel pour l’ensemble de son œuvre et particulièrement de celle que nous traitons ici.
A l’heure où toute la gauche s’est « retrouvée » pour clamer son indignation à propos d’un bilan "globalement positif" de la colonisation, rappelons avec notre mécontemporain que celle-ci fut pourtant l’une des grandes missions de la gauche d’antan. Il faut relire ces discours de Jules Ferry, le maître d’œuvre de l’empire colonial français, où il parle des « races supérieures qui doivent affranchir les races inférieures » et du devoir de remise à niveau que l’Europe a vis-à-vis du reste du monde. Mettre à l’école laïque, gratuite et obligatoire les enfants comme les nègres, tel fut le grand chantier du meilleur des socialistes – et dont les opposants étaient précisément les gens de droite qui trouvaient la colonisation trop chère, trop peu rentable, et faite au détriment de l’Alsace et de la Lorraine qu’il fallait récupérer avant tout : « j’ai perdu deux sœurs et vous m’offrez vingt domestiques » s’exclamait Paul Déroulède.
Enfin, il ne faut oublier que la colonisation fut aussi pensée comme une réaction préventive à celle que les pays arabes imposèrent pendant des siècles à une partie de l’Europe.
« On oublie ainsi que, pendant près d’un millénaire, du premier débarquement des Maures en Espagne au second siège de Vienne par les Turcs en 1683, l’Europe a vécu sous la menace de l’Islam. Oubli d’autant plus préjudiciable à notre compréhension des choses que le processus complexe de l’expansion et de la domination européennes découle, en partie, de cette confrontation. (…) Comme le montre Bernard Lewis, c’est le combat contre l’envahisseur qui poussa les Européens au-delà de leurs frontières. »
 Un Islam qui aujourd’hui, non content de s’être radicalisé comme jamais, s’est en plus modernisé dangereusement. « Modernisation sans Occidentalisation », précise fort justement Finkielkraut. L’intégriste désormais, ce n’est pas le plouc, c’est l’intellectuel, celui qui accomplit l’alliance du Dogme et de la Méthode, de la charia et de l’internet. Et qui,contrairement à l’intellectuel occidental, est un homme d’action et de sacrifice, lui – un terroriste cultivé. Ben Laden. Tarik Ramadan. Mohammed Atta. Sami Nacéry (bon, celui-là n’est peut-être pas si cultivé, c’est vrai, mais quel homme d’action !) Face à eux, nos intellectuels risquent encore de manquer le coche du XXI ème siècle.
Un Islam qui aujourd’hui, non content de s’être radicalisé comme jamais, s’est en plus modernisé dangereusement. « Modernisation sans Occidentalisation », précise fort justement Finkielkraut. L’intégriste désormais, ce n’est pas le plouc, c’est l’intellectuel, celui qui accomplit l’alliance du Dogme et de la Méthode, de la charia et de l’internet. Et qui,contrairement à l’intellectuel occidental, est un homme d’action et de sacrifice, lui – un terroriste cultivé. Ben Laden. Tarik Ramadan. Mohammed Atta. Sami Nacéry (bon, celui-là n’est peut-être pas si cultivé, c’est vrai, mais quel homme d’action !) Face à eux, nos intellectuels risquent encore de manquer le coche du XXI ème siècle.
Vivant trop vivant.
Ce XXI ème siècle, dont la tarte à crème consiste à dire qu’il « sera religieux ou ne sera pas », risque en effet d'échapper à nos intellectuels s’ils n’abandonnent l’un de leurs préjugés les plus tenaces - à savoir le primat du social sur le spirituel. Il ne s’agit pas, Dieu nous en garde, de nier le poids des déterminismes socio-économiques, mais il s’agit de voir en quoi ces derniers sont peut-être eux-mêmes déterminés par une culture particulière, un dogme singulier, une « Weltanschauung » mythique et symbolique. Ce que l’on a dans l’assiette dépend en effet plus de ce que l’on a dans la tête que de ce que le voisin a dans la sienne. Dieu précède (et conditionne) la survie. S’il y a une leçon que nous pouvons recevoir de l’islam est bien celle de la confiance et de la force que donne Dieu à ses soumis, qu’ils soient riches ou pauvres. Aux vrais musulmans, la misère sociale ne fait jamais oublier l’abondance spirituelle.
Pour Charles Péguy, dont on sait la place qu’il tient dans le cœur et l’esprit d’Alain Finkielkraut, ce n’est pas la pauvreté qui est le scandale mais la misère. Le pauvre, dont les conditions de vie sont assurées, peut relever la tête, « regarder devant et derrière lui, soustraire une part de son existence à l’intendance d’exister », rendre grâce à Dieu et à la beauté du monde. Socialiste et chrétien, Péguy n’adhère pas à une promesse d’abondance matérielle : « Quand tout homme est pourvu du nécessaire, du vrai nécessaire, le pain et le livre, peu nous importe la répartition du luxe », écrit-il. Alors que le misérable, tout absorbé par la survie, est privé de toute possibilité de transcendance – d’oubli de soi.
« Pas de dehors pour l’homme dont l’existence économique n’est pas assurée. Pas de donnée stable. Rien, jamais ne lui apparaît comme une chose : il ne saisit de l’environnement que ce qui est proie éventuelle ou possibilité d’assouvissement. (…) La vie dans la misère, c’est l’impossibilité faite aux individus de décoller de l’espèce, c’est la soumission uniformisante aux normes du biologique ; c’est la vie tout court, ce n’est jamais la vie de quelqu’un. Il faut un monde à la vie pour qu’elle devienne vie individuelle.»
« La vie tout court » - soit l’enfer. Notre dignité a toujours consisté à donner un sens supérieur à cette vie tout court. Or, malencontreusement, la modernité contemporaine, même luxueuse, n’est occupée que de la vie.
En effet, il n'y a pas que le misérable qui soit obsédé par la « seule » vie. Comme l’a bien vu Hannah Arendt, la culture de masse, « ce n’est pas l’assujettissement de la vie aux normes bourgeoises, c’est la constitution du monde en proie pour la vie. » Qu’on se drogue ou qu’on fasse du sport, qu’on fasse l’amour ou un régime, l’injonction moderne est de vivre « à fond », d’aller toujours « plus haut, plus vite, plus fort », de faire de sa vie une performance permanente. Notre époque est celle du dopage et du Viagra, de la chirurgie esthétique et de la santé optimum. Avouons que ce culte du dépassement de soi ne laisse pas de nous inquiéter. « Maintenant, quand un record tombe, notre cœur se serre, car, dans le recordman, nous flairons le mutant. » Au fond, en restituant l’ensemble des réalités du monde au processus vital, nous ne nous sommes pas rendu compte que nous étions en train de jouer le vivant contre l’humain « car l’humain dans la vie se signale précisément par l’interruption du processus vital. »
 L’humain est ce qui maîtrise la vie et non ce qui se fait maîtrisé par elle. Et maîtriser la vie n’est pas autre chose que connaître ses limites, autrement dit, maîtriser la vie, c'est prendre conscience de la mort. Or, la mort, c’est précisément ce que les supervivants survitaminés que nous sommes ont expulsé de leur existence. Non par indifférence ataraxique mais plutôt par panique non avouée. Contre toute attente, le moderne est celui qui a peur de la mort… comme tout un chacun pourrait-on dire, sauf que lui n’a plus les moyens de l’appréhender. Tout au plus la regarde-t-il de loin comme un spectacle qui ne le concerne pas. D’où sa perpétuelle fuite en avant qui lui fait à la fois désirer tout ce qui augmente son potentiel de vie et en même temps lui fait prendre les mesures les plus drastiques pour prévenir tout ce qui pourrait attenter à sa chère vie potentialisée. Ce que Finkielkraut appelle « l’émergence de la précaution » est cette propension à étendre tout azimut le domaine de la responsabilité (celle bien sûr de la collectivité et de l’Etat et non pas la sienne) jusqu’aux coups du hasard.
L’humain est ce qui maîtrise la vie et non ce qui se fait maîtrisé par elle. Et maîtriser la vie n’est pas autre chose que connaître ses limites, autrement dit, maîtriser la vie, c'est prendre conscience de la mort. Or, la mort, c’est précisément ce que les supervivants survitaminés que nous sommes ont expulsé de leur existence. Non par indifférence ataraxique mais plutôt par panique non avouée. Contre toute attente, le moderne est celui qui a peur de la mort… comme tout un chacun pourrait-on dire, sauf que lui n’a plus les moyens de l’appréhender. Tout au plus la regarde-t-il de loin comme un spectacle qui ne le concerne pas. D’où sa perpétuelle fuite en avant qui lui fait à la fois désirer tout ce qui augmente son potentiel de vie et en même temps lui fait prendre les mesures les plus drastiques pour prévenir tout ce qui pourrait attenter à sa chère vie potentialisée. Ce que Finkielkraut appelle « l’émergence de la précaution » est cette propension à étendre tout azimut le domaine de la responsabilité (celle bien sûr de la collectivité et de l’Etat et non pas la sienne) jusqu’aux coups du hasard.
« Il y a là une nouvelle donne qui oblige les industriels, les ingénieurs, les politiques, tout un chacun à redoubler d’attention, et qui conduit le droit à pénaliser même l’involontaire afin que nul ne puisse se prévaloir de son inadvertance. »
Ainsi de la météo qui relève aujourd’hui de la politique car nous sommes désormais responsables par nos modes de vie du temps qu’il fait ou de ce qui se passe dans l’espace (par exemple, il nous fut dit il y a quelques années qu’il ne fallait plus utiliser de déodorant afin de protéger la couche d’ozone).
« Le « Il » de « Il neige », « Il vente », « Il fait chaud » n’est plus tout à fait un pronom impersonnel. La politique est cosmique et c’est la ville qui pleut quand il pleut sur la ville. »
Comme Voltaire, nous nous indignons des catastrophes naturelles qui mettent à mal notre droit de propriété sur la nature mais comme Rousseau nous pensons que c’est bien fait pour nous quand un tsunami ou un tremblement de terre nous arrive car nous n’aurions pas dû être si négligent avec la nature – dans les deux cas, celle-ci est nôtre et relève de nos choix prométhéens, bons ou mauvais. Certes, il n’a jamais été facile d’être sage, mais du fait que les limites étaient autrefois inscrites dans l’univers, la sagesse avait ses alliés naturels alors qu’aujourd’hui nous sommes les seuls législateurs. C’est que nous avons pris la place de Dieu et que nous considérons que les seules « limites » à la création sont les nôtres. Par là-même, nous avons évacué tout principe de réalité puisque nous sommes la seule réalité. Inutile de dire le désastre que représente ce nouvel homme Dieu.
« Quand Dieu est cause de soi, Il est Dieu et seulement Dieu : l’individu, en Lui, se confond avec le genre. C’est l’homme générique, en revanche, qui peut être dit causa sui, pas l’homme individuel. Celui-ci n’est pas Dieu, car il est au (au moins) deux, la cause et l’effet, Pygmalion et Galatée, celui qui passe commande et le produit optimal qui lui est livré. »
En nous prenant pour Dieu, nous avons non seulement la volonté de dominer la nature, mais aussi la tentation de nous créer nous-même. Nous poussons jusqu’au bout l’idée moderne du soulagement de la condition et de l’autonomie humaines en rêvant d’une vie qui serait à la fois sans douleur et sans mort – une vie clonée. Mais qui parmi nous mérite la vie éternelle ?
Et Finkielkraut de se lancer dans une paradoxale apologie de la peur en laquelle il voit la meilleure défense immunitaire contre les ravages de la modernité.
« Il y a, en d’autres termes, la clairvoyance du tremblement ou selon Hans Jonas une heuristique de la peur. La peur est bonne conseillère. Elle nous apprend quelque chose. Loin d’obscurcir notre entendement, elle l’éclaire, elle est plus intelligente que nos désirs. Sachons donc lui faire bonne accueil et prêter davantage l’oreille aux prophéties du malheur qu’à la prophétie du bonheur»
 Comme il l’attendait, « cette réhabilitation de la peur a provoqué une avalanche d’objections et de réprimandes. » Au sens du moderne, la peur est par excellence le péché non rémissible. Elle est la négation de Prométhée et la honte de Zarathoustra. Le moderne, c’est celui qui veut à tous prix ne pas avoir peur de la vie afin, et c’est là que l’anti-défaitiste de la pensée se révèle véritablement philosophe, d’oublier qu’il a peur de la mort.
Comme il l’attendait, « cette réhabilitation de la peur a provoqué une avalanche d’objections et de réprimandes. » Au sens du moderne, la peur est par excellence le péché non rémissible. Elle est la négation de Prométhée et la honte de Zarathoustra. Le moderne, c’est celui qui veut à tous prix ne pas avoir peur de la vie afin, et c’est là que l’anti-défaitiste de la pensée se révèle véritablement philosophe, d’oublier qu’il a peur de la mort.
Le moderne est « l’ homme que la mort fait claquer des dents, l’ homme qui maudit la mort, l’homme que la mort empêche de dormir. »
« Le téméraire » Michel Onfray ne célèbre lui-même la jouissance et l’hédonisme et ne plaide pour « tout ce qui fait peur » (clonage, manipulation du génome, transgénèse, optimisation technique de l’enfant à naître, fabrications de corps frankensteinienne) que parce que sa compagne est atteinte d’un cancer et que la mort lui paraît l’ennemi à abattre. On comprend évidemment la douleur, la rage et l’épouvante de l’homme, tout philosophe qu’il soit, devant « la faucheuse », mais le philosophe est justement celui qui apprend à mourir alors qu’Onfray apparaît au contraire comme le philosophe qui s’enivre de « vie » pour oublier qu’il va mourir, ce qui n’est pas, admettons-le, très philosophique, surtout lorsqu’on se réclame de Nietzsche, Spinoza et Epicure. Hédoniste par défaut et matérialiste par échappatoire, il incarne à merveille ce vivant trop vivant qui a refoulé sa mortalité et qui se trouve pathétiquement désemparé quand celle-ci s’impose à lui. Misère de la philosophie vitaliste ! Voilà notre désirant vulcanologue se mettre à délirer les fantasme d’une santé parfaite, d’une immortalité envisageable, d’une possibilité d’une île (un comble pour lui qui déteste Houellebecq !), sans se rendre compte que la possibilité du divin était peut-être la plus désirable…et la moins inhumaine. C’est lorsqu’il va mourir que l’homme de la mort de Dieu se met à cruellement regretter Celui-ci.
Et c’est le beau message final que délivrent les leçons du professeur Finkielkraut : avoir un peu plus peur de la vie et un peu moins de la mort.
Nous autres, modernes, Alain Finkielkraut, Ellipses/Ecole Polytechnique.
(Cet article est paru dans le numéro deux de la Presse littéraire en janvier 2006 et a été mis une première fois en ligne en mars 2006)