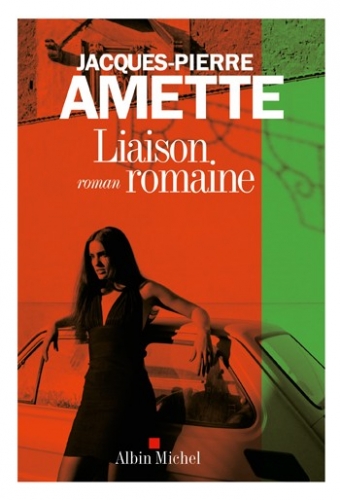Cet article a été l'occasion de ma première contribution au nouveau site de Joseph Vebret et Loïc Di Stefano, le très hautement recommandable SALON LITTERAIRE, où chacun peut y aller de son texte, sa critique, son commentaire, ses éphémérides, en plus d'avoir la possibilité de participer à des communautés de lecteurs autour d'un écrivain ou d'un thème favori, voire de fonder les siennes, et à la fin de rencontrer la femme ou l'homme de ses rêves. Le Salon littéraire, c'est à la fois feu Le magazine des livres, Facebook et Meetic. C'est votre bibliothèque performative, votre bar et votre boudoir.
Rome pour aimer, mourir et écrire

Bientôt, plus personne n’écrira comme ça :
« Elle passa une main nonchalante sur des vestes en lin couleur caramel ou vert tilleul, puis elle prit un chemisier en coton bleu pâle à l’encolure ronde qu’elle plaqua contre elle. Elle décrocha ensuite une petite robe noire à manches courte, au décolleté carré, et s’enferma dans une cabine d’essayage. Je rôdai entre les bacs pleins de jeans en vrac ou de débardeurs kaki ou fleuris. Une robe bustier zippée sur le devant me fit rêver à ces moments où, au début de notre liaison, Constance se déshabillait avec une ardeur inattendue. Je m’attardai devant des escarpins noirs alignés comme à la parade. D’autres jeunes femmes entraient ou sortaient des cabines d’essayage, à moitié déboutonnées, sans chaussures, se plantant devant un miroir. Elles pressaient contre elles les étoffes fluides ou caressaient leurs hanches. Constance, à son tour, se regarda dans le miroir, tout absorbée à traquer le moindre défaut de coupe de cette robe noire, puis elle se tourna, remit d’aplomb une manche sur son épaule et pivota pour vérifier si le décolleté mettait en valeur ses deux grains de beauté sur ses seins. »
Le voyeurisme multicolore de Jacques-Pierre Amette. Sa sensibilité stendhalienne. Sa prose flaubertienne. Et peut-être aussi son fétichisme zolien. Aucun pli de robe qui ne lui échappe. Aucun tissu dont il ne fasse une chair. Aucun escarpin qui ne fasse tic-tac dans son cœur. Mais sans doute parce qu’il sait que la liaison est provisoire, que la femme va le quitter, que la solitude le menace – et qu’il faut bien donner un peu de présence réelle à ce qui va passer et de couleur à ce qui sera bientôt gris.
Comme l’indique le « je me souviens » qui ouvre le texte, le bonheur est un souvenir. Pour autant, ce roman du « je » n’est pas un roman du « moi ». Ce « je » absorbe mais ne se répand pas. Au contraire, il s’efface sans cesse derrière l’être aimé mais aussi derrière les paysages, les vêtements, les objets. Tout défile devant lui comme derrière la vitre d’un train où d’ailleurs le récit commence. Gestes, ombres, silhouettes, vent, fleurs, fontaines, femmes. Comme dans un Monet, on voit tout sauf les visages. Ecriture impressionniste d’Amette - à la fois visuelle et aveugle. « A travers cette coulée d’incandescence, on reste aveuglé puis on discerne quelques taches et des contours. »
Et cela, dès la première page. Constance, « la main en visière » (qui se cache les yeux, donc), regardait défiler derrière la vitre un paysage lunaire de collines grises sous un ciel laiteux ». Plus tard, on la verra « penchée au-dessus de moi, les prunelles agrandies d’ombre. ». Dans ce roman de la vue, on ne voit jamais les yeux – eux-mêmes pris sans cesse à partie par la « folle réverbération » de l’esplanade de la gare, « le sableux » des parkings, « la sensation de marcher dans une brèche trop lumineuse ». Ce n’est pourtant pas les couleurs qui manquent : « bleu métallisé » d’une poignée de valise, « murailles en marbre blanc sale », « carrefour souterrain noir », « papier peint d’un rose défraîchi », enfin « bleu huileux » de méchants tableaux accrochés aux murs de l’hôtel. Après les couleurs, les matières. Les objets. Les statues. « Une statue de la Vierge qui statue de la Vierge trônait au pied de l’escalier près du porte-parapluies ». Puis, « une lampe de bureau verte rafistolée avec un élastique », et la clef de leur chambre que leur donne le réceptionniste, et qui devient dans leur main une « lourde étoile de cuivre ». Enfin, la chambre constituée par « deux lits jumeaux creusés en leur milieu » qui déconcertent le narrateur. Car dans cet univers purement matériel, le désir de l’homme pour la femme tente à chaque instant de trouver sa place. Et l’on pressent que la femme sera dure rien qu’en la voyant poser ses affaires : « Constance pendit ses jupes et ses chemisiers à des cintres en fil de fer ». La femme associée au cintre de fer. Dès lors, tout contact avec elle aura un ton métallique, ferrailleux, grinçant. Le moindre sourire s’accompagnera toujours d’une dissonance : « Elle me fixa d’un air tendre et moqueur pour effacer le malaise. Entre-temps, il y eut le fracas grinçant d’une grille qu’on tirait sur la devanture d’une bijouterie, la ruelle devenait déserte. » Déserte comme le sera bientôt la vie du narrateur. Celui-ci peut alors tenter de lui caresser la nuque et les cheveux, ses doigts ne peuvent aboutir qu’au « fin métal d’une épingle ». Chez Amette, c’est l’objet qui fait l’affect, c’est le paysage qui révèle le sentiment. Les coups au cœur sont picturaux.
Comme le visage de Constance, la scène d’amour est perpétuellement différée. Le désir, condensé à l’extrême, ne s’accomplit jamais sous nos yeux. Pourtant, l’Eros est partout : dans « la pression molle d’un sein de la dentiste » qu’il doit un moment consulter pour soigner une dent, dans les pieds nus d’une vendeuse de bijoux ethniques ainsi que dans « le sorbet rose de sa robe qui moulait son corps dodu », et même dans le témoignage de cette femme qui raconte, à la manière d’un conte de Boccace, comment, dans le temps, « les femmes se refaisaient une beauté en sortant du confessionnal ». Lui-même pense aux semences dont nous sommes tous issus, imagine les couples aller après dîner « se démener cruellement et avec acharnement pour, à coups de giclées et de petits cris furtifs et extasiés, produire une nouvelle génération. » Pensées romaines, s’il en est, qui mêlent le pape et les poitrines des femmes, l’immaculée et le fertile, le culte et le cul.
Et donc, Rome. Sa « folie bagnoleuse ». Son raffut permanent : « cafés, camion benne, chantiers, pelures de pommes, fientes d’oiseaux, petites places, grands palais, herbes, murs, campagne, grappa » On pense à Fellini, à Scola, à Petri. Mais aussi son « legato si indéfinissable : paix soudaine, engourdissement, mélange de bien-être, de fluidité et d’anxiété » et qu’ont connu Pavèse, Léopardi, ces grands tristes de l’Italie. En vérité, Rome est « un royaume fabuleux pour toute prose ». Surtout en période de Pentecôte où les langues de feu concernent l’écrivain plus que tout autre. « Je pensai alors bêtement qu’il suffisait de croire au miracle pour que les mots apparaissent, plaisants, malicieux, vrais. » N’est-il pas du reste venu dans la ville éternelle pour lui consacrer un article commandé par son journal ? Mais comment être journaliste quand on est écrivain ? Comment plaire au rédacteur en chef qui veut surtout plaire au pékin sans trahir son style ? Comment assurer « la volupté d’être l’ultime représentant d’une prose bucolique dans un hebdo aux titres rageurs » ?
C’est l’autre sujet tout aussi douloureux de cette Liaison : le conflit immémorial entre le styliste et l’éditorialiste et le pouvoir qu’exerce bien illégitimement le second sur le premier, « l’intrusion sournoisement pédagogique » dans l’art de celui-ci et qui va de pair avec « une désapprobation de ma méthode lunaire, fureteuse, oblique, obstinée. » Malheureux auteur qui doit s’adapter aux exigences antiartistiques du journaleux ! « Il devait mépriser mes flâneries impressionnistes, ma baignade un peu myope dans les couleurs de Rome. Mon approche nuageuse des foules romaines devait l’accabler. Lui n’était qu’informations vérifiées, chiffres, recadrages, dialectique, paragraphes structurés, sèches analyses, ton autoritaire. ». Le journalisme, c’est la solution finale de la littérature.
L’oral contre l’écrit. Avec le journaleux comme avec Constance, la parole est cruellement informative. On parle peu dans ce couple. Et quand on parle, l’écriture si chaude et si colorée de l’auteur se fait blanche, neutre, glaciale. Ce n’est pourtant pas le fait du narrateur qui implore sans cesse la parole de la femme : « Parle-moi, Constance. (…) Dis-moi quelque chose » Mais la femme a fait de la parole une guillotine :
« — Oui, j’ai rencontré quelqu’un.
— Il y a longtemps ?
— Non.
— Je le connais ? Je l’ai vu ?
— Non.
Elle ajouta :
— Quelqu’un qui me parle gentiment. »
Et c’est la tristesse de la seconde partie. Tristesse sans fin de l’homme sans femme. L’homme orphelin, abandonné, perdu, « les paumes vides ». L’homme dont la fidélité n’a pas suffi et dont le talent commence à ennuyer. L’homme à qui il ne reste que 453 euros dans son porte-monnaie. L’homme qui a tout perdu dans la ville qui devait tout lui donner. L’homme pour qui les passants se sont transformés en zombies. « Dans cette foule, des hommes et des femmes mal coloriés bougeaient et dérapaient avec douceur, décalcomanies encore trempées dans l’eau d’un bol, face aux pavillons de brique d’un hôpital en carton-pâte. Ils traînaient tous dans la lumière. Les yeux, les nez, les fronts, les bouches devaient être en papier mâché peint ou en matière plastifiée. Des artistes anonymes savaient dessiner astucieusement des sourires ou des plis amers. Voilà, c’était comme ça. » Lui n’est plus reconnu comme artiste. Ne lui restent plus que la Grappa et l’Orvieto - et peut-être des souvenirs de Côtes d’Armor, trouées bretonnes d’un autre monde, bouffées d’air frais d’un autre livre et qui aèrent celui-ci. Mais que valent ces madeleines face à l’absente volontaire ? Alors, on décide de faire ce que l’on fait le mieux, malgré l’avis du journaleux. Tenter une dernière fois l’écriture de l’amour. Ecrire à la femme abandonneuse une lettre « dégoulinante de sentimentalité, implorante et laborieuse, avec des complaisances, des impudeurs et des répétitions, des expressions filandreuses, des rappels honteux, des détails scabreux exprimés d’un ton mou. » Mais à quoi bon puisqu’elle ne nous a jamais dit ses secrets ? Puisque l’on ne l’a jamais réellement connue ? Femmes que l’on aime, pourquoi ne nous aimez-nous pas ?