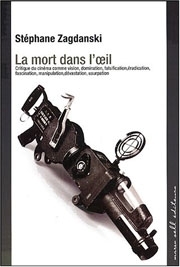 Cet article, publié une prem ière fois dans Le Journal de la culture n°13 en avril 05, puis recyclé en avril 2010 pour Les carnets de la philosophie, et que je remets en ligne aujourd'hui à la suite de ma critique de François Meyronnis qui dit au fond la même chose sur la littérature que ce que dit Zagdanski sur le cinéma, est sans doute un de ceux qui ont le plus comptés pour moi et à travers lequel j'ai pu découvrir une de mes thématiques favorites, à savoir cette barbarie du littéral en laquelle se perdent même des intellectuels surcultivés comme les zouaves nommés. Comment peut-on, quand on s'appelle Zagdanski, Meyronnis, mais aussi à sa manière Michel Onfray, entretenir ce que Philippe Muray appelait si justement "le droit à la lecture au premier degré" ? Confondre Chaplin avec Hitler ou Les Bienveillantes avec la Shoah, soutenir mordicus qu'un Eisenstein fracasse pour de bon les crânes et que voir un de ses films, c'est participer d'une manière ou d'une autre au Goulag (et devenir communiste malgré soi), ou que Houellebecq plaide pour le clonage, parce qu'il a écrit un roman sur le clonage, c'est ce qui ne me laisse pas de me stupéfier, et à la fin de m'inquiéter. Car si c'est cela, la nouvelle critique, alors, j'ai bien peur qu'il ne faille un jour organiser un vaste bûcher où l'on jettera tous les films et tous les livres, et cela non au nom d'une dictature de la petite bourgeoisie, étriquée et illettrée, et qui se serait imposée, mais bien au nom d'une élite littératrice, post-sollersienne, anticatholique au possible (le comble), qui se sera persuadée que l' image est une réalité et que le mot est la chose, rejoignant ainsi le pire de ce qu'elle croyait combattre. La mort dans l'oeil de Zagdanski, De l'extermination considérée comme un des beaux-arts de Meyronnis, auxquels on peut ajouter Le crépuscule d'une idole de Onfray s'imposent en tous cas comme les trois premiers jalons de cette nouvelle tendance qui a totalement intégré l'abolition de la distinction, fait de la lettre la mort de l'esprit et de l'image le tombeau du réel.
Cet article, publié une prem ière fois dans Le Journal de la culture n°13 en avril 05, puis recyclé en avril 2010 pour Les carnets de la philosophie, et que je remets en ligne aujourd'hui à la suite de ma critique de François Meyronnis qui dit au fond la même chose sur la littérature que ce que dit Zagdanski sur le cinéma, est sans doute un de ceux qui ont le plus comptés pour moi et à travers lequel j'ai pu découvrir une de mes thématiques favorites, à savoir cette barbarie du littéral en laquelle se perdent même des intellectuels surcultivés comme les zouaves nommés. Comment peut-on, quand on s'appelle Zagdanski, Meyronnis, mais aussi à sa manière Michel Onfray, entretenir ce que Philippe Muray appelait si justement "le droit à la lecture au premier degré" ? Confondre Chaplin avec Hitler ou Les Bienveillantes avec la Shoah, soutenir mordicus qu'un Eisenstein fracasse pour de bon les crânes et que voir un de ses films, c'est participer d'une manière ou d'une autre au Goulag (et devenir communiste malgré soi), ou que Houellebecq plaide pour le clonage, parce qu'il a écrit un roman sur le clonage, c'est ce qui ne me laisse pas de me stupéfier, et à la fin de m'inquiéter. Car si c'est cela, la nouvelle critique, alors, j'ai bien peur qu'il ne faille un jour organiser un vaste bûcher où l'on jettera tous les films et tous les livres, et cela non au nom d'une dictature de la petite bourgeoisie, étriquée et illettrée, et qui se serait imposée, mais bien au nom d'une élite littératrice, post-sollersienne, anticatholique au possible (le comble), qui se sera persuadée que l' image est une réalité et que le mot est la chose, rejoignant ainsi le pire de ce qu'elle croyait combattre. La mort dans l'oeil de Zagdanski, De l'extermination considérée comme un des beaux-arts de Meyronnis, auxquels on peut ajouter Le crépuscule d'une idole de Onfray s'imposent en tous cas comme les trois premiers jalons de cette nouvelle tendance qui a totalement intégré l'abolition de la distinction, fait de la lettre la mort de l'esprit et de l'image le tombeau du réel.
---------------------------------------------------------------------------------------
 « Quand on aime le cinéma, on n’aime pas la vie » disait François Truffaut qui aimait les femmes et le cinéma, ou plus exactement les femmes au cinéma. « Quand on aime le cinéma, on consomme de la mort » écrit Stéphane Zagdanski dans La mort dans l’œil, assurément l’essai le plus iconoclaste de l’année 2004 et qui aura décimer plus d’un amateur de salles obscures. Epaulé par Baudelaire, Kafka, Proust, Céline, Claudel, Heidegger qui lui servent de rabatteurs, et de l’inévitable Guy Debord, le chien d’arrêt de tous les penseurs spectaculaires de l’anti-spectacle, la chasse du comte Zagdanski peut commencer
« Quand on aime le cinéma, on n’aime pas la vie » disait François Truffaut qui aimait les femmes et le cinéma, ou plus exactement les femmes au cinéma. « Quand on aime le cinéma, on consomme de la mort » écrit Stéphane Zagdanski dans La mort dans l’œil, assurément l’essai le plus iconoclaste de l’année 2004 et qui aura décimer plus d’un amateur de salles obscures. Epaulé par Baudelaire, Kafka, Proust, Céline, Claudel, Heidegger qui lui servent de rabatteurs, et de l’inévitable Guy Debord, le chien d’arrêt de tous les penseurs spectaculaires de l’anti-spectacle, la chasse du comte Zagdanski peut commencer
Voilà un livre qui ne fait pas de quartier. Pour qui Murnau, Fellini ou Cassavetes comptent autant que Molière, Stendhal ou Nietzsche, difficile en effet de s’entendre dire à tout bout de champ que la cinéphilie est une « Schlague », qu’ « aimer les films intellectuels est un plaisir de pédophile », que le cinéma, cette « glue hypnotique » qui a perverti le goût, n’a jamais existé en tant qu’art, et qu’il ne faut d’ailleurs rien comprendre à l’art pour croire que « cette trouvaille de foire » en est un.
Evidemment, ça va pleurer dans les salles de rédaction des Cahiers du cinéma et des Inrockuptibles. Ce n’est pas tous les jours que l’on traite Eisenstein comme Walt Disney, que l’on met Godard au niveau de Spielberg, et même au dessous, car « Godard est même plus probablement un peu plus imbécile que Spielberg [car] il l’ignore qu’il l’est. », que l’on compare le Rashomon de Kurosawa à un James Bond, et que l’on dit que son plan préféré dans l’histoire du cinéma est celui, « dionysiaque » à souhait, de Michael Jordan bondissant sur Bugs Bunny dans Spacejam.
 Sans compter l’accusation de fascisme, inhérente au cinéma depuis ses débuts[1], mais qui, sous la plume de Zagdanski, (guy-)déborde tout ce qui se dit d’habitude entre citoyens vigilants. Nulle différence, à ses yeux, entre le cinéma de propagande et le cinéma qui dénonce la propagande. Quoiqu’elle fasse, l’image, qui n’est qu’une copie des choses, est incapable de dire le vrai ou de subvertir le faux. Chaplin a beau faire, son Dictateur se confond avec Hitler du fait même qu’il mime Hitler. Idem avec Godard dont on ne sait jamais dans ses Histoires du cinéma s’il condamne ou approuve le nazisme. Quand il tente de traiter l’histoire, tout cinéaste, du plus probe au plus racoleur, se retrouve révisionniste malgré lui. Au cinéma, résister, c’est collaborer. Bref, qu’on soit devant Amélie Poulain ou un film des Straub, on est toujours devant du fascisant. Rien que pour imaginer la tête de Kaganski le lisant, le livre de Zagdanski vaut le coup.
Sans compter l’accusation de fascisme, inhérente au cinéma depuis ses débuts[1], mais qui, sous la plume de Zagdanski, (guy-)déborde tout ce qui se dit d’habitude entre citoyens vigilants. Nulle différence, à ses yeux, entre le cinéma de propagande et le cinéma qui dénonce la propagande. Quoiqu’elle fasse, l’image, qui n’est qu’une copie des choses, est incapable de dire le vrai ou de subvertir le faux. Chaplin a beau faire, son Dictateur se confond avec Hitler du fait même qu’il mime Hitler. Idem avec Godard dont on ne sait jamais dans ses Histoires du cinéma s’il condamne ou approuve le nazisme. Quand il tente de traiter l’histoire, tout cinéaste, du plus probe au plus racoleur, se retrouve révisionniste malgré lui. Au cinéma, résister, c’est collaborer. Bref, qu’on soit devant Amélie Poulain ou un film des Straub, on est toujours devant du fascisant. Rien que pour imaginer la tête de Kaganski le lisant, le livre de Zagdanski vaut le coup.
Hélas ! contrarier les vigiles de la culture ne suffit pas. Pour autant qu’il soit drôle et hygiénique, le propos de Zagdanski n’en est pas moins tellement radical qu’on se demande à la fin si cette manière de ne voir dans le cinéma qu’une mise à mort de la pensée par la vue n’est pas ajouter de l’eau aux moulins des fascismes imaginaires, et par là-même se retrouver super vigile. C’est l’impression que donne ce livre : partir du culturellement incorrect le plus audacieux - c’est vrai, le cinéma, comme le gaullisme, est « une cause victorieuse » à laquelle on ne s’attaque jamais, c’est vrai, la cinéphilie est un cancer culturel qui fait de l’image une pensée et du générique un savoir, c’est vrai, Orson Welles est un imposteur qui participe à l’idolâtrie ambiante tout en feignant de la critiquer -, et tomber dans le politiquement correct le plus affligeant - le cinéma, qui ne nous dit rien et nous cache tout, n’est qu’un programme capitalistotalitaire qui nous surveille de près, nous régit de loin, nous insinue son néant, nous prépare au clonage généralisé, bref se révèle une matrice effrayante et mortifère à laquelle même le film Matrix participe.
 Des machines désirantes aux machines pensantes.
Des machines désirantes aux machines pensantes.
Derrière son ironie et ses sarcasmes, il ne rigole pas du tout, l’homme qui a conchié sur De Gaulle et qui maintenant pisse sur le septième art.
Si celui-ci n’est qu’une technique de domination qui falsifie le réel, éradique le temps, fascine la mort, manipule la vie, dévaste les esprits et usurpe le Verbe, c’est qu’il est d’abord de la vision. Or, et Zagdanski de typographier en gros pour qu’on comprenne bien, LA VISION NE PENSE PAS. Penser, c’est ce qui se passe dans le cerveau après que tous les sens aient été conviés. Or, en ne s’adressant qu’à l’œil, ce « boulet pour le cerveau », l’image en mouvement ne sollicite que les mauvaises perceptions, celles qui nous font prendre des vessies pour des lanternes (magiques), des fantômes pour des êtres réels, celles, surtout, qui réveillent en nous ce que Gilles Deleuze, pas plus à la fête que Godard dans ce livre, appelait « l’automate spirituel » - soit un corps mécanique qui prend le pas sur le corps vivant, qui n’est sensible qu’aux stimuli les plus basiques (meurtre, poursuite, baiser), qui nous fait perdre notre sens des causalités, qui nous réduit enfin à n’être plus qu’un objet fasciné incapable de liberté et d’intelligence, une « orange mécanique » que le pouvoir va utiliser à ses fins (exactement comme dans le film de Kubrick où Alex se voit à la fin promettre un travail par l’Etat où il pourra user de ses pulsions de mort en toute légalité)… mais un automate, dont Deleuze nous dit, en bon sophiste décadent, qu’il pense ! Après les machines désirantes, les machines pensantes ! Et l’anti-père de l’Anti Œdipe de concevoir sa fameuse théorie du noochoc – une « pensée » (noésis en grec) qui résulterait du choc entre l’œil et l’image. La voilà en plein l’imposture de la pensée cinématographique et à laquelle Zagdanski a déclaré la guerre. En effet, le noochoc parle à notre automate aussi bien qu’à celui des autres – or, si nous sommes tous « différents », notre automate est le même, et c’est à ce « même » que l’image s’adresse. Autrement dit, loin de solliciter notre singularité, le noochoc deleuzien excite en nous le dénominateur commun, nous prépare à l ‘ « opinion » collective, dissolvant notre altérité en un « même » qui se reproduit de spectateur en fauteuil, et de pensée en pop-corn. Impossible de dire moi quand « nous » voyons un film. C’est le sens de la formule communiste d’Eisenstein et que Deleuze reprend au compte de son noochoc : « le cinéma soviétique doit fendre les crânes ».
Pour Zagdanski, tout est dit : le cinéma est bien cette illusion d’optique au service du pouvoir panoptique, cet art kolkhozien qui abrutit les consciences, annihile les sens, fait des corps des machines et des désirs des instincts grégaires, le tout relayé par la philosophie française la plus corrompue. N’en déplaise à Deleuze, rien d’étonnant après que « l’image-mouvement, associé à la machine désirante, [ne soit rien] d’autre que la bien nommée tournante. » L’image est un viol. Le cinéma est bien un rêve d’Alex. Et Alex, c’est nous.
 Maman et Mamon.
Maman et Mamon.
Hitchcock le disait lui-même : la mise en scène est moins une « direction d’acteurs » qu’une « direction de spectateurs » - les uns et les autres n’étant, selon un autre de ses mots célèbres, que du « bétail » qu’il faut faire marcher ensemble, enfermer ensemble, marquer au fer rouge ensemble, gaver de farine pelliculaire ensemble, reproduire à l’image des images, lui faire payer sa place, enfin. Au cinéma, non seulement nous devenons des clones, mais nous donnons notre argent pour l’être.
Que nous dépouillerions-nous pour rejoindre la matrice ! Au fond, le cinéma fonctionne comme une mère : il nous regarde en gros plan, nous cajole, nous pouponne, nous chatouille, nous rend le monde inquiétant pour qu’on reste avec lui – avec elle, nous console après nous avoir fait les gros yeux (c’est ainsi que le suspense et le thriller fonctionnent), nous ramène toujours dans ses jupes, et nous réaccouche sans père et sans peine. « Menace + motion = money », tel fonctionne cette suprême idole des temps modernes qui synthétise en elle les deux principales : Maman et Mamon. Maman assure l’espèce, Mamon encaisse. Peu importe la couleur politique de l’image du moment que celle-ci conduit au clonage. Impur par nature, « le cinéma est aussi aisément de droite que de gauche, stalinien ou nazi, capitaliste ou tiers-mondiste ; il triomphe à toutes les sauces, précisément grâce à sa neutralité originelle, qui n’est autre que celle du buvard de la mort. » La magie va de pair avec l’idéologie. De Méliès l’illusionniste à Godard le militant, le film est le même. Il est bien cet appareillage infernal qui après nous avoir mené dans les camps de la mort nous dirige aujourd’hui vers les banques de sperme.

 Athènes ou Jérusalem ?
Athènes ou Jérusalem ?
Mais qui est responsable de tout ça ? Comme dans tout film, il faut un coupable idéal – pour Zagdanski, un coupable idéaliste. Platon ! On frémit. Comment ? Le Platon qui nous a délivré de la caverne ? Le Platon qui nous a appris le bien, le vrai, le beau, et sans qui notre comportement amoureux aurait été autre s’il n’avait pas écrit le Banquet ? Eh bien oui, c’est ce même Platon qui, aux yeux de Zagdanski, loin de nous avoir ouvert les nôtres, a conçu dans le Timée rien moins qu’une métaphysique d’ asservissement par le regard qui fait de lui le véritable inventeur du cinéma et le plus grand fasciste de tous les temps. L’image-clonage, c’est lui, le générique-génétique, c’est encore lui, la maïeutique comme accouchement des esprits – des clones, c’est toujours lui.
L’homme n’est plus qu’un spectateur des Formes, autrement dit un sectateur des Images au service de l’objectif qui tue. Telle s’érige la République : d’un côté, une humanité aveuglée et manipulée, de l’autre, des philosophes rois qui tirent les ficelles ou plutôt font défiler le film. « Entre Wall Street et la fourmilière, le choix reste donc restreint. »
Mais comme tout thriller américain où le méchant ne cesse de ressusciter, la démonstration zagdanskienne ne s’arrête pas là. Pour la République cinématographique, il ne s’agit pas simplement d’asservir, encore faut-il faire oublier qu’on asservit. Et pour cela, éradiquer le temps. Or, seule l’image, en tant qu’étendue mobile, peut mettre à plat le temps, en faire un écran où défileront la pellicule des fantasmes. Contrairement à Gaspard Noé, autre platonicien roi, qui dans Irréversible voulait nous faire croire que « le temps détruit tout », c’est l’image qui détruit tout. C’est l’image qui faisant du temps une toile, dédouble le réel, le fait disparaître de fondu en fondu, procède par surimpression, effacement de l’effacement, négation de la négation, arroseur arrosé.
Ainsi Stéphane Zagdanski pervertit-il Platon, non pas tant en le fascisant abusivement - on savait depuis belle lurette que Platon n’était pas un bon démocrate, mais en faisant passer son fascisme au nom de la vérité pour un fascisme au nom du mensonge. Tel le grand architecte de Matrix qui balade l’humanité de matrice en matrice, Platon est celui qui nous délivre de la caverne pour nous mettre dans une caverne plus grande et plus sophistiquée où nous serons clonés de père en film pour l’éternité. La plus grande production jamais tournée.
 A ce niveau de lecture, on se demande ce qui pousse Zagdanski à tant de haine anti-idéaliste. Après tout, c’est grâce à Platon que nous avons le Logos qui nous a permis de penser et que…. FAUX ! rétorque Stéphane. Le Logos, le beau, le vrai, le bon, ne nous vient pas de Platon mais des poètes – ces mêmes poètes que Platon considérait comme des faussaires du réel et décidait qu’ils ne pouvaient rester dans la cité. Or, pour Zagdanski, c’est la poésie qui détient la vérité, et c’est la philosophie qui détient le pouvoir. Un pouvoir qui veut, par l’image, se débarrasser de la Parole. Une image qui dans le Logos veut prendre la part du « Davar » hébreux – le Verbe. NOUS Y VOILA ! Ce dont Platon est fondamentalement accusé, c’est d’avoir métamorphosé le Verbe en Vision.
A ce niveau de lecture, on se demande ce qui pousse Zagdanski à tant de haine anti-idéaliste. Après tout, c’est grâce à Platon que nous avons le Logos qui nous a permis de penser et que…. FAUX ! rétorque Stéphane. Le Logos, le beau, le vrai, le bon, ne nous vient pas de Platon mais des poètes – ces mêmes poètes que Platon considérait comme des faussaires du réel et décidait qu’ils ne pouvaient rester dans la cité. Or, pour Zagdanski, c’est la poésie qui détient la vérité, et c’est la philosophie qui détient le pouvoir. Un pouvoir qui veut, par l’image, se débarrasser de la Parole. Une image qui dans le Logos veut prendre la part du « Davar » hébreux – le Verbe. NOUS Y VOILA ! Ce dont Platon est fondamentalement accusé, c’est d’avoir métamorphosé le Verbe en Vision.
Contrairement au Verbe qui dit et crée, l’image ne dit rien, ne crée rien, mais recopie servilement tout, confondant le réel dans son buvard et rendant sa copie à celui qui la voit. « Il n’y a pas image où il y va de l’œil mais là où il y a du liant ». Si l’image est mauvaise, c’est qu’elle se lie à nous malgré nous. Même si nous savons que ce que nous voyons est faux, nous y croyons quand même – d’autant que, comme dit Alex à qui on projette des films de la pire violence pour précisément le désensibiliser à la violence, « les couleurs de la vie ne semblent vraiment vrai que lorsqu’on les voit sur un écran de cinéma. » C’est pourquoi il est impératif pour Zagdanski de jouer à fond le poétique contre le politique, la mystique du langage contre la piété de l’image, l’interprétation contre la fascination. Et de recourir sans hésiter à l’interdit juif de la représentation qui « est à la fois un bouclier contre la fascination et un devoir d’interprétation, cette distorsion divisante à laquelle correspondent la pensée et l’art. » Ainsi, le génie juif a su détourner le regard de la vue, c’est-à-dire du Diable, « celui qui vous en veut de détourner votre regard », et se tourner vers le Verbe créateur qui « met le monde en mots avant de le voir. » Dieu devance la vue. Dieu devance le diable. La vision est d’essence satanique.
En Stéphane Zagdanski s’incarne donc le conflit entre Athènes et Jérusalem. D’un côté, le Logos grec qui tend à falsifier le réel par la production d’images et au nom de la reproduction des espèces, de l’autre, le Verbe qui dit le vrai et crée des hommes libres et égaux.
Rien que pour avoir remis ce débat au goût cinématographique du jour, on le remerciera d’avoir écrit ce livre. Pour autant, peut-on le suivre jusqu’au bout dans sa volonté de décimer le cinéma ? Pourquoi le faux serait-il exclusivement du côté de l’image ? En quoi les poètes ne seraient-ils pas eux aussi des menteurs ? Platon n’avait-il pas raison de les exclure ? En quoi, surtout, le contrôle des espèces est-il plus le fait de la raison grecque que celui du Verbe hébreux ? Jéhovah ne nous a-t-il pas créés pour que l’on procrée ? Enfin, si l’image est si détestable, pourquoi Dieu nous a-t-il fait à la Sienne ?
 Le bovarysme, maladie littéraire.
Le bovarysme, maladie littéraire.
Après tout, Don Quichotte est devenu fou d’avoir lu trop de romans de chevalerie, et Emma Bovary est morte d’avoir trop cru la littérature romantique. Avant l’image, le texte a pu tout autant fasciner, falsifier, manipuler, dévaster, usurper. Pourquoi Zagdanski qui se démène à nous mettre en garde contre la confusion des images et des choses, ne dit-il rien de la confusion des mots et des choses ? Passons sur sa candeur qui lui fait dire que le grand écrivain ne s’est jamais compromis avec le pouvoir (ben voyons ! Bossuet n’était pas curé du roi, Chateaubriand n’était pas ministre de Louis XV, Hugo n’était pas pair de France, Claudel n’était pas diplomate), ni surtout avec le pire (Céline n’était pas antisémite), et essayons de comprendre son dogme. Le Verbe est sacré, dit-il, et ne peut tromper. Celui de Dieu, sans aucun doute, mais Baudelaire a beau être un génie absolu, ce n’est pas Dieu. Et son verbe est profane. Autant l’art peut être conçu comme une célébration de Dieu, autant un minimum d’orthodoxie nous retient de le considérer comme une transsubstantiation esthétique. Le verset n’est pas un vers. Le Verbe n’est pas littéraire. On a un peu honte de rappeler de pareilles évidences, mais c’est aux évidences aussi que Zagdanski a déclaré la guerre.
Bref, de l’écrit à l’écran, la différence est technique et l’on ne voit pas très bien en quoi la littérature serait-elle exemptée d’avoir aussi plagié la vie. De la mère de Schopenhauer incitant son fils à « mettre de côté pour quelque temps tous les écrivains sans exception [car] la vie[lui] semblera insupportable avec cette habitude prise si jeune de perdre tout ton temps à [s]’occuper d’art »[2] – imagine-t-on aujourd’hui un parent dire ça à son enfant ? - à l’exhortation drolatique de César à Marius, « tu lis trop », dans la trilogie de Pagnol, on ne compte plus les éducateurs, les penseurs, les philosophes qui ont mis en garde les lecteurs contre les dangers de la lecture. Lire dévirilise. L’art détourne du réel. L’esthète n’est qu’un drogué et l’artiste qu’un dealer. C’est la vérité la plus décevante qu’on ait jamais eu à dire, mais quand on aime l’art, on n’aime pas la vie. Truffaut avait raison. Quelqu’un qui aime vraiment la vie se contente d’honorer ses parents, d’élever ses enfants en vue d’en faire de futurs parents, est heureux de travailler dur, respecte l’ordre du monde, chérit l’espèce plus que l’individu, rend grâce à Dieu, et surtout se fout complètement de Shakespeare et de Mozart qui lui apparaissent comme des idoles susceptibles de le détourner de ses bottes et de sa herse. Heureusement, un monstre pareil n’existe pas dans nos cercles. Personne n’adhère totalement à la vie. Même Nietzsche avouait que sans la musique, la vie serait une erreur – soit dit en passant, voilà une phrase que n’aurait pas osé le pire homme du ressentiment !

 La musique, justement. Zagdanski n’en parle jamais, trop emballé par la littérature : « Le plan le plus sublime du plus parfait chef-d’œuvre du plus somptueux cinéaste n’est jamais arrivé à la cheville de n’importe quelle phrase de Proust ou tirade de Shakespeare ». Certainement Stéphane, mais ne pourrait-on pas tout aussi continuer dans cette lancée et dire que la plus belle page de Proust ou le plus beau vers de Shakespeare ne sont jamais arrivés à l’orteil d’ une mesure de Bach ou de Mozart ? La musique est ce qui rend le Verbe inutile et incertain – surtout quand elle l’utilise à ses fins, quand elle fait du livre un livret. Mozart est supérieur à Molière, Rossini est supérieur à Beaumarchais, Offenbach est supérieur à Hoffmann, Verdi est supérieur à Shakespeare, Wagner est supérieur à Chrétien de Troyes, Berg est supérieur à Büchner, Strauss est supérieur à Hofmannsthal, et Debussy est largement supérieur à Maeterlinck.
La musique, justement. Zagdanski n’en parle jamais, trop emballé par la littérature : « Le plan le plus sublime du plus parfait chef-d’œuvre du plus somptueux cinéaste n’est jamais arrivé à la cheville de n’importe quelle phrase de Proust ou tirade de Shakespeare ». Certainement Stéphane, mais ne pourrait-on pas tout aussi continuer dans cette lancée et dire que la plus belle page de Proust ou le plus beau vers de Shakespeare ne sont jamais arrivés à l’orteil d’ une mesure de Bach ou de Mozart ? La musique est ce qui rend le Verbe inutile et incertain – surtout quand elle l’utilise à ses fins, quand elle fait du livre un livret. Mozart est supérieur à Molière, Rossini est supérieur à Beaumarchais, Offenbach est supérieur à Hoffmann, Verdi est supérieur à Shakespeare, Wagner est supérieur à Chrétien de Troyes, Berg est supérieur à Büchner, Strauss est supérieur à Hofmannsthal, et Debussy est largement supérieur à Maeterlinck.
Après La mort dans l’œil, Zagdanski pourrait tout aussi bien écrire La mort dans l’oreille. A l’ouïe aussi on peut faire croire n’importe quoi. Plus que l’image et le verbe, la musique est l’art ensorcelant par excellence. Et qui peut être tout aussi « totalitaire » que l’image – Platon la recommandait même dans l’éducation militaire. Du rythme et de l’algèbre, et on marche au pas ! « A chaque fois que j’entends du Wagner, j’ai envie d’envahir la Pologne » disait Woody Allen. Avec l’utilisation du Leitmotive, de la mélodie continue, et de l’orchestre invisible de Bayreuth (à vrai dire, placé sous la scène), Wagner a imposé une conception pré-cinématographique de l’opéra et qui avait déjà attiré les foudres de Nietzsche : « Mais vous pensez que toute musique est musique du convive de pierre, - que toute musique doit sortir du mur et secouer l’auditeur jusqu’aux entrailles ?… que, d’après vous, c’est seulement ainsi qu’agit la musique ! – Et sur qui agit-elle alors ? Sur une chose sur laquelle un artiste de qualité ne doit jamais agir, - sur la masse ! sur les immatures ! sur les blasés ! sur les maladifs ! sur les idiots ! sur les wagnériens !… » (Nietzsche contre Wagner) Remplaçons « wagnériens » par « cinéphiles » et « musique » par « image » et nous retrouvons Zagdanski. Notons que Nietzsche distingue la mauvaise musique de la bonne (quoiqu’on se demande quelle est-elle, vu qu’en parlant de « convive de pierre », il sous entend que l’auteur de Don Giovanni relèverait de la première catégorie), alors que Zagdanski, lui, ne sauve personne de son enfer cinématographique.

 L’homme sans ombre.
L’homme sans ombre.
Mais c’est quand il arrive au film porno-
-graphique que sa dé-
-monstration commence à faire long feu. Pour Zagdanski, évidemment, le porno est le genre cinéma-
tographique par excellence. Ou plutôt, c’est le cinéma qui est d’essence pornographique. Le gros plan, les zooms, les travellings (mouvements de va et vient), le montage enfin semblent n’avoir été inventés que pour filmer des accouplements improbables, inimaginables dans la réalité puisque dans la réalité, on cherche à faire l’amour et non à montrer que l’on fait l’amour. Ici, l’on sera d’accord avec lui, « l’X réalise l’impossible vision : voir son propre coït à hauteur de sexe » comme on acquiescera volontiers à sa définition du porno comme étant, « outre un banal commerce lucratif, un instrument de propagande, grossier mais efficace, au service de la manipulation du vivant. » Pour autant, sa définition de l’érotisme, qu’il tente de concevoir le plus purement et le plus sainement possible, autrement dit, dénué de toute image - « l’érotisme ne ressortit pas à la vision, mais au volume » - n’en laisse pas moins perplexe. Que l’image sexuelle soit la honte du sexe, soit, mais qu’on puisse s’en passer sous prétexte qu’elle nous ramène à notre mécanique pavlovienne manipulée par le pouvoir, c’est ce qui ne va pas du tout de soi. N’en déplaise à Zagdanski, le sexe est aussi une affaire biologique, donc d’image. Et l’image, malgré tout ce qu’il peut dire contre elle, fait bander. Et c’est ici que Zagdanski devient physiologiquement inquiétant. Sous prétexte que l’image est une déformation du réel, et que lui, Zagdanski n’aime que le réel, il pousse la probité à ne pas bander pour une image. On l’admire, mais on ne l’envie pas. Comme on n’envie pas sa capacité à ne pas être sensible aux trucages d’un film. Pauvre résistant qui rit aux travellings, se moque des zooms et ricane au moindre effet…
Est-il pour de bon cet homme sans représentation, sans fantasme, sans miroir, et dont la sexualité se passe obscènement d’images ? Cet homme qui s’est vraiment débarrassé de tout ce qui pouvait polluer son innocence adamique et qui pose à poil, avec Alina Reyes, sur la couverture de leur livre commun, « La vérité nue » ? ce mutant extralucide qui arrive à ne pas croire ce qu’il voit ?
Oui, Stéphane Zagdanski est bien cet être sursexué qui se passe vraiment d’images pour vivre, ce monstre de pureté qui bande en dehors des lois génétiques et qui baise contre l’espèce, ce pur homme de lumière qui vit le monde selon sa volonté et sans aucune représentation. Cet homme sans ombre.

Le problème, quand on vit sans ombre – sans image, c’est que l’on panique dès que l’on en voit une. Si l’image est la mort, alors plus d’image. Zagdanski a beau se moquer du cinéma d’un rire dionysiaque, on finit par craindre que sa grande santé nietzschéenne ne vire progressivement à l’hygiénisme terroriste et que sa pureté ne devienne puritaine - le puritain étant précisément celui qui ne supporte pas rétinalement qu’on prenne son dieu pour une idole et qui ne voit plus que des idoles partout. Craignant de brûler par les images, il se met alors à brûler les images. Autant les vampires craignent la lumière du jour, autant les puritains craignent la lumière artificielle, celle de la nuit.
Zagdanski n’en finit pas de hurler que le cinéma agit comme un tour de magie et qu’en ce sens, il nous trompe, mais justement, devant un tour de magie, nous faisons semblant de croire aux sortilèges, nous savons qu’il y a un truc. Zagdanski, spectateur candide et puritain, est indifférent au truc. De toutes ses forces d’anti-idolâtre, il refuse qu’on le trompe même pour rire, il refuse qu’on fasse « comme si », il refuse de se laisser aller au rêve éveillé.
On a beau lui répéter que le cinéma ne nous ment et ne nous manipule que pour mieux nous rendre compte du mensonge et de la manipulation, il se bouche les oreilles. Et quand on lui dit que le cinéma est là pour révéler nos mauvaises perceptions – celles qui font croire aux images - et pour nous aider à prendre nos distances avec elles, il s’insurge, car lui, précisément, n’a pas de mauvaises perceptions, pas plus qu’il n’a de mauvaises érections.
Comme Artaud à qui il dédie son livre, Zagdanski prend tout comme un idiot, c’est-à-dire comme quelqu’un qui appréhende les choses que dans leur singularité univoque, et qui, par conséquent, prend toute image comme une menace physique directe sur le réel. Au fond, il critique le cinéma comme on critiquait le théâtre au Moyen Age. Mimer Satan, c’est être Satan. Pour l’inquisiteur qu’il devient, la catharsis n’est qu’un autre moyen d’asservissement visuel. D’ailleurs, c’est Bernardo Guy Debord, son maître, qui lui souffle cette confusion. L’obsession d’échapper à la spectacularisation de la société fait qu’on se défie de tout spectacle. Aller au cinéma, c’est aller au peep show ou à la morgue ou à l’asile. A ses yeux, Freaks est vraiment du voyeurisme. « Si le cinéma glorifie les monstres(Frankenstein), les débiles (Forest Gump), c’est qu’il est une immense geôle. »
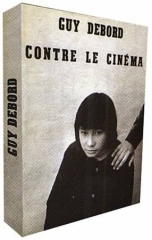
 Pauvre Zagdanski ! Lui qui tendait au surhomme nietzschéen, le voilà dans la peau de Charles Ingalls de La petite maison dans la prairie. Sous ses allures d’essai nietzschéen à coups de marteau, La mort dans l’œil finit par virer au sermon protestant qui dénonce les idoles catholiques. C’est aussi là que se joue la Mort dans l’œil. Poser l’interdit juif de la représentation contre la catholicité du cinéma. Béthléem contre Jérusalem. Ce n’est plus Platon qui menace Moïse, ce sont les rois mages – précisément « mages », avec leur encens, leur myrrhe, leur or, tout ce qui met dans un état second ou qui flatte les sens. Le Christ les accepte volontiers, car il ne dédaigne pas être homme jusque dans l’image. Est catholique celui qui n’a pas peur des visions, et qui sait qu’en lui les mauvaises perceptions abondent. Mais là où le péché abonde, la grâce aussi abonde. Inutile donc de faire un drame de l’image qui n’est que le mal nécessaire de l’Incarnation. Païen pour rire, le catholique ne prend pas pour argent comptant les images qu’on lui montre, même s’il s’y complait un moment.
Pauvre Zagdanski ! Lui qui tendait au surhomme nietzschéen, le voilà dans la peau de Charles Ingalls de La petite maison dans la prairie. Sous ses allures d’essai nietzschéen à coups de marteau, La mort dans l’œil finit par virer au sermon protestant qui dénonce les idoles catholiques. C’est aussi là que se joue la Mort dans l’œil. Poser l’interdit juif de la représentation contre la catholicité du cinéma. Béthléem contre Jérusalem. Ce n’est plus Platon qui menace Moïse, ce sont les rois mages – précisément « mages », avec leur encens, leur myrrhe, leur or, tout ce qui met dans un état second ou qui flatte les sens. Le Christ les accepte volontiers, car il ne dédaigne pas être homme jusque dans l’image. Est catholique celui qui n’a pas peur des visions, et qui sait qu’en lui les mauvaises perceptions abondent. Mais là où le péché abonde, la grâce aussi abonde. Inutile donc de faire un drame de l’image qui n’est que le mal nécessaire de l’Incarnation. Païen pour rire, le catholique ne prend pas pour argent comptant les images qu’on lui montre, même s’il s’y complait un moment.
Zagdanski a beau jeu de rappeler que Griffith était au service du Klux Klux Klan, qu’Eisenstein était communiste et Riefenstahl nazie, il ignore superbement les cinéastes qui auraient pu purifier sa mémoire oculaire. On aurait aimé savoir ce qu’il pense des films de Ford, de Tarkovski, d’Ozu, de Bresson, de Dreyer, de Miyazaki, véritables faiseurs d’icônes et dont on se demande bien en quoi ils manipulent le vivant, éradiquent le temps, et falsifient le réel. Quant aux iconoclastes, les Welles, Huston, Kubrick, Tex Avery, ils n’ont cessé de nous avertir des dangers de la matrice. C’est par le mal qu’on soigne le mal, c’est pas la petite caverne qu’on sort de la grande, c’est par Chaplin ou Lubitsch ou Begnini qu’on se distingue du nazisme.
Tant pis, on admirera l’impossible exigence de Stéphane Zagdanski à réhabiliter le verbe contre l’image, on se corrigera secrètement de sa cinéphilie ostentatoire, on se refusera à confondre spectacularisation et spectacle, on continuera à se réjouir de la beauté d’un visage bergmanien, d’une grimace fellinienne, d’une main bressonienne, d’un œil kubrickien, on admettra sans s’en plaindre que si nous aimons le cinéma, c’est, selon le mot de Nietzsche, parce que nous sommes encore pieux, on s’étonnera enfin que si le cinéma n’est peut-être plus « folie pour les grecs », il reste encore « scandale pour les juifs », du moins pour celui-ci. Les autres ont fait des films, parmi les plus beaux du monde, le laissant écrire le pire livre sur l'art de ce début de siècle.
La mort dans l’œil, critique du cinéma comme vision, domination, falsification, éradication, fascination, manipulation, dévastation, usurpation, de Stéphane Zagdanski, Maren Sell Editeurs, 389 pages. 20 euros

