MICHEL HOUELLEBECQ,
GONCOURT 2010.










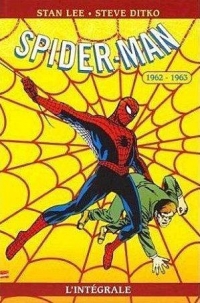


On n’en finirait pas de l’observer à la loupe cette Carte et de l’arpenter sans relâche ce Territoire. Roman de science-fiction au présent, tryptique tragi-comique à la narration irrésistible, apocalypse en sourdine, le dernier opus de Michel Houellebecq éblouit par sa propension à percer notre contemporanéité, à tracer l’organigramme quasi-religieux de nos existences, à touiller, une fois de plus, nos âmes malgré nous. Petit chemin de traverse dans une œuvre capitale.
D’où vient ce plaisir si particulier de lire Houellebecq ? La proximité que l’on a tout de suite avec lui – et qui est renforcé par le fait que tant de gens ne l’ont pas et trouvent répugnant qu’on l’ait ? Le sentiment de consolation qui se dégage de chacune de ses phrases et dont on peut dire pour de vrai qu’elles nous ont sauvé ? L’extraordinaire humanité qui émane du bonhomme ? Nous mentirions si nous répondions par la négative. Ainsi nous avions de la souffrance à partager – de la souffrance « moyenne » sans doute, « commune », c’est-à-dire non reconnue, sinon moquée par les autres. Nos parents qui avaient osé vivre leur vie sans nous, et parfois, contre nous, n’en reviendraient pas. Les femmes qui s’étaient détournées de notre visage nous comprendraient enfin et peut-être nous embrasseraient. Même le chauffe-eau tenterait de nous amadouer. Salope de vie qui s’est toujours mêlée de notre existence sans qu’on ne lui demande rien et qui lui a fait tout le mal dont elle était capable - comme elle fait la vexée depuis que nous avons lu Rester vivant ! Non, nous ne sommes plus seuls. Nous avons un prochain qui s’appelle Michel Houellebecq et qui porte notre croix à notre place. Nous avons des romans qui parlent de nous et de l’époque et nous nous réjouissons de la tête à Toto que le romancier fait à l’époque. Le roman comme décloisonnement de la souffrance. Le roman comme ce qui permet de sortir de sa solitude et de sa misère. Il est bouleversant ce moment où Houellebecq, dans le bel et long entretien qu’il a accordé sur le Ring à Marin de Viry et Pierre Poucet, raconte comment il reçut un jour la lettre d’une femme laide qui voulait tuer des gens au hasard dans la rue (des gens beaux et heureux, si possible), avant de retourner l'arme contre elle, et qui finalement ne l’a pas fait, peut-être parce qu’elle lui avait écrit. Ecrire les choses pour ne pas les faire – c’est ce que ne comprendront jamais les puritains et les terroristes. La pire pensée de tous les temps, déjà dénoncée dans saint Paul, c’est la lettre contre l’esprit - l’abominable « littéral » (synonyme de « barbare » selon Adorno) ou le non moins abject « antilittéraire » qui lit ou écrit toujours au premier degré. Il est vrai que et comme le disait Houellebecq lui-même dans son Lovecraft : « Quand on aime la vie, on ne lit pas. On ne va guère au cinéma non plus, d’ailleurs. Quoi qu’on en dise, l’accès à l’univers artistique est plus ou moins réservé à ceux qui en ont un peu marre. » Romantisme facile ? Autopromotion dépressive à bon marché ? Complaisance digne des chochottes que nous sommes ? Au lieu de blâmer notre faiblesse, donnez-nous donc un peu de votre force, vous qui, paraît-il, êtes si forts, vous qui n’avez pas besoin de catharsis pour vivre, vous à qui la vie convient comme un gant. Rendez-nous beaux, rendez-nous baisants, vous qui êtes apparemment si beaux et qui baisez avec tant de succès. Et réapprenez à lire.
 « Anagké sténaï »
« Anagké sténaï »
Le plaisir du texte comme échange d’affects ? Oui, mais pas seulement. Le texte, aussi et surtout, comme plaisir de structurer, de construire, d’inventer de nouvelles formes de temps et d’espace – a fortiori dans un livre qui s’appelle La carte et le territoire. Et de ne pas tout dire. De laisser des blancs, du vide, de l’inabouti – pourquoi donc la mère s’est-elle suicidée ? Qui était réellement Adolphe Petissaud ? Le réalisme est l’art de l’inconséquence, disait John Cooper Powys. Dans le roman, comme dans la vie, l’organique n’est pas forcément le logique. Le romancier avisé met tout en lien mais en faisant en sorte que ce lien ne soit pas forcément causal et en gardant à l’esprit que le livre se fait aussi dans la tête du lecteur. « Juxtaposer des choses différentes et imaginer que le lecteur fait la synthèse (…) Jamais oublier que le lecteur fait cinquante pour cent du travail », dit Michel Houellebecq dans l’entretien déjà cité. Lui laisser ce plaisir, justement, au lecteur.
Exemple : est-ce Marthe Taillefer qui a dépucelé Jed Martin quand il était adolescent ou plutôt Geneviève rencontré quelques années plus tard ? De la première, rencontrée « sur un balcon de Port-Grimaud » (mais « rencontrée » pour de bon ou observée de loin ?), on nous dit que c’est par son « entremise » que le héros découvrit le fonctionnement sexuel de son corps – mais les détails de cette « entremise », s’il vous plaît ? De la seconde, l’auteur écrit que : « c’est même avec elle, en réalité, qu’il avait perdu sa virginité ». Que s’est-il donc passé avec Marthe ? Et quelle est la nature de cette réalité ?
Chez Houellebecq, comme chez Kafka, tiens, tout est atermoiement, tergiversation, indécision (Jed se faisant traiter à plusieurs reprises par Olga de « petit Français indécis… »), ou simplement mutisme. Mutisme des hommes. Mutisme douloureux entre les pères et les fils qui ne savent pas communiquer sans un tiers féminin. Car ce sont toujours les femmes qui apportent les fleurs et la parole. Quoique peu de femmes en ces territoires que le désir et l’altérité semblent avoir déserté. Ou qui ne viennent que pour disparaître ou repartir. Il est vrai que les femmes ne savent pas lire les cartes et que le territoire est toujours une affaire de mâle.
La phrase elle-même participe à ces mises en absence permanentes, neutralisant presqu’à chaque coup ce qu’elle avait l’air d’annoncer. A chaque annonce, son espoir et son arrêt. A chaque phrase, sa promesse et son eau de boudin, sa poursuite du bonheur et sa contrariété : « Il noua cependant des amitiés, quoique pas très vives… » ou : « il noua également quelques relations amoureuses, dont aucune non plus ne devait se prolonger », sans compter le magnifique et houellebecquissime : « Il n’avait pas été malheureux dans cette chambre, pas très heureux non plus. » L’état moyen à son plus haut niveau, aurait-on envie de dire en riant – car Houellebecq est aussi un auteur comique, ne l’oublions jamais :
« Le Sushi Warehouse de Roissy 2E proposait un choix exceptionnel d’eaux minérales norvégiennes. Jed se décida pour la Husqvarna, plutôt une eau du centre de la Norvège, qui pétillait avec discrétion – quoique, en réalité, pas davantage que les autres (…) le point commun des eaux minérales norvégiennes semblait être la modération. Des hédonistes subtils, ces Norvégiens, se dit Jed en payant sa Husqvarna.»
Comme dans un film de Tati, on essaye de survivre à l’hypertechnologie et à la vitesse supersonique du marché, même si tout n’est pas à rejeter et qu’au bout du compte on en profite aussi. Après tout, « lire le mode d’emploi d’une Mercedes demeure un réel plaisir ». Les objets sont là, ils nous envahissent, mais on s’y attache, et on est même capable de pleurer pour une parka que des concepteurs sadiques ont décidé de ne plus fabriquer :
« C’est brutal, vous savez, c’est terriblement brutal. Alors que les espèces animales les plus insignifiantes mettent des milliers, parfois des millions d’années à disparaître, les produits manufacturés sont rayés de la surface du globe en quelques jours, il ne leur est jamais réservé de seconde chance, ils ne peuvent que subir, impuissants, le diktat irresponsable et fasciste des responsables de lignes de produit qui savent naturellement mieux que tout autre ce que veut le consommateur, qui prétendent capter une attente de nouveauté chez le consommateur, qui ne font en réalité que transformer sa vie en une quête épuisante et désespérée, une errance sans fin entre des linéaires éternellement modifiés. »
Pauvre Michel ! En fait, c’est la nouveauté perpétuelle et génocidaire qui est proprement infernale, non le progrès en soi. Si l’on savait s’arrêter, la vie serait tellement plus vivable ! « Anagké sténaï », comme disait Aristote – « il faut s’arrêter ». Au moins ralentir. Idéal du « progrès lent ». Bonheur de l’ennui. Félicité de la progression escargot comme celle, par exemple, du Tour de France :
« Il aimait ces longs plans ennuyeux, en hélicoptère, qui suivaient le peloton avançant paresseusement dans la campagne française. »
Tout ce qui freine la marche de l’humanité est bon à prendre. Dans Interventions II, Houellebecq allait jusqu’à parler du contentement que chacun d’entre nous a ressenti au moins une fois dans sa vie lorsque quelque chose tombe en panne, un réseau de transmission qui ne transmet plus, un système d’information qui n’informe plus, un centre informatique qui bugue, ou même une coupure de courant qui oblige à recourir quelques heures aux bougies pour le plus grand amusement des enfants : « une fois donc l’inconvénient admis, c’est plutôt une joie secrète qui se manifeste chez les usagers ; comme si le destin leur donnait l’occasion de prendre une revanche sournoise sur la technologie. » Le salut comme suspension. La neutralisation des choses comme sauvetage de celles-ci - et comme apaisement. D’où la tentation de l’immobilisme, de l’arrêt sur image, du besoin impérieux d’une pause à la marche du monde qui va de toutes façons à sa perte. C’est le paradoxe de La carte de nous plonger dans un monde qui bouge en permanence et qui est arpenté par un personnage qui ne cherche qu’à fixer les choses, à les éterniser, par la peinture et la photographie, deux arts du figement s’il en est – et cela dès la première phrase du livre :
« Jeff Koons venait de se lever de son siège, les bras lancés en avant dans un élan d’enthousiasme. »
Enthousiasme, énergie, érection de l’artiste contemporain le plus en vu du moment et qui est prêt à conquérir le monde. Et pourtant, non : représentation de cet enthousiasme, de cette énergie, de cette érection dans un tableau. Le seul vrai mouvement de cette première scène, c’est le recul du peintre devant sa toile. La seule réalité, c’est l’atelier du peintre – et qui est en train de faire ses Ménines. On se croyait dans un élan vital à la gloire du capitalisme « artistique », on est dans un travelling arrière qui met en scène celui-ci et de façon critique. Les vacheries commencent en effet tout de suite. Si Jeff Koons se révèle « aussi difficile [à peindre qu’] un pornographe mormon », son interlocuteur Damien Hirst est saisi autant dans sa « rebellitude » d’artiste révolté que dans sa vulgarité essentielle, genre « je chie sur vous du haut de mon fric » - et qui annonce d’ailleurs la grande scène future de Patrick Le Lay éructant sur M6 que sa chaîne a pulvérisé : « on les a enculés jusqu’à l’os ! jusqu’à l’os ! ». Premiers échos. Premiers liens.
Mais ce tableau ne satisfait pas l’artiste. Dérangé qui plus est par des problèmes de chauffe-eau, celui-ci est obligé d’aller dormir dans l’hôtel Mercure d’à côté et de laisser son œuvre en jachère. Entre-temps, la narration nous aura ramené à ce qui se passait un an auparavant, le premier Noël chez son père à Raincy (son père qu’il a également peint dans une scène de pot de départ d’entreprise), l’achat de son atelier, boulevard Auguste-Blanchi, avant de nous faire revenir à l’an présent, le second Noël avec son père, cette fois-ci dans une maison de retraite à Boulogne. Dans ce prologue, et comme ce sera le cas par la suite, tout bouge et tout se fige. On va et vient dans le temps et dans l’espace entre deux images immobiles, deux toiles dont l’une est faite et l’autre impossible à finir. On zigzague dans l’univers sans arriver à faire aboutir son travail – auquel il faudra alors renoncer et marquer ainsi une « fin de cycle ». Telle se structure La carte : de petites séquences, de petits espaces, parfois même en forme de collages, qui s’entrecroisent et « s’entre-signent» et constituent une véritable diégèse du mouvement et du figement.
A chaque situation, ses probabilités. A chaque axe ses possibilités - d’îles ou de bonheur. Là-dessus, Marin de Viry a tout dit dans son admirable Moment nu : nul déterminisme ne préside au monde de Jed Martin. « L’homothétie entre le grand (le territoire) et le petit (la carte) » n’est en rien une harmonie préétablie. Le destin, c’est du hasard. L’ordre du monde, un ordonnancement conjoncturel ni plus ni moins. La carte est bien ce roman opératoire qui fait la part belle au clinamen (ou à la physique quantique), et qui marque ce moment historique qui est le nôtre et par lequel toute existence, individuelle ou collective, peut bifurquer dans telle ou telle direction, selon telle ou telle croyance, catholique, grecque, fasciste, etc. Nous sommes en effet comme jamais dans cette « ère du possible » où toutes les « Weltanschauung » sont permises, où toutes les virtualités peuvent s'actualiser, où la réalité elle-même devient « alternative » - et cela sous couvert de menace de fin du monde, mais une fin du monde douce et végétale. Peut-être est-cette « douceur » apocalyptique qui a pu déconcerter certains houellebecquiens plus habitués à l’ironie féroce ou à la violence dépressive de leur auteur fétiche et qui ne le reconnaissent plus dans ce qu’il faut bien appeler une sorte d’abnégation devant le monde. En vérité, il n’est pas si facile d’être son propre contemporain et de percevoir en live la marche du monde. De Plateforme à La carte, le monde a changé, et le romancier l’a compris.
 Nature et culture
Nature et culture
Et pourtant, dans ce monde « post-moderne » où chaque chemin semble ne mener nulle part et peut-être parce qu’ils sont tous possibles (comme dans le village du Loiret aux rues portant des noms de philosophe !), où seul le hasard semble mener la danse (le meurtre se résolvant lui aussi par « un hasard pur »), où l’aporie tient lieu de lot pour tout le monde, les échos ne cessent de se multiplier, les correspondances de se répéter, les ressemblances de s’imposer. « J’ai l’impression que les gens se ressemblent beaucoup plus qu’on ne le dit habituellement, surtout quand je fais les méplats, les maxillaires, j’ai l’impression de répéter les motifs d’un puzzle », affirmera le peintre page 176. Monde sans doute inconséquent mais monde en rimes. Aléa des situations et des postures mais parallélisme de celles-ci. Voici des personnages qui ne se croisent pas mais qui agissent en jumeaux ou plus exactement en « binômes », tels les techniciens de scène de crime de l’Identité Judiciaire que le commissaire Jasselin déteste tant. Ainsi l’enterrement de la grand-mère où « Jed se dit qu’ils étaient, son père et lui, remarquablement adaptés à ce genre de circonstances » et qui préfigure celui de Houellebecq auxquels assistent les deux policiers : « Jasselin et Ferber étaient l’un comme l’autre assez bons pour les enterrements. » Au fond, la grande illusion moderne, c’est l’individu dont les désirs sont finalement moins « mimétiques » que relatifs à l’espèce. En bon disciple de Schopenhauer, Houellebecq croit plus au vouloir-vivre indistinct plutôt qu’à l’affirmation de la singularité et de la distinction. Si « les petits garçons dessinent des monstres sanguinaires, des insignes nazis et des avions de chasse (ou, pour les avancés d’entre eux, des chattes et des bites), des fleurs rarement », c’est que l’instinct de mort, tout aussi violent que l’instinct de vie, et d’ailleurs supposé par lui, est en eux. Quoique les fleurs, on le sait depuis Schopenhauer, n’ont jamais rien été d’autres que « des vagins bariolés ornant la superficie du monde, livrés à la lubricité des insectes ». Hélas ! La splendide innocence sexuelle des fleurs n’a que peu à voir avec l’horrible sexualité des hommes, celle-ci étant toujours apparue aux yeux de Jasselin comme « la manifestation la plus directe et la plus évidente du mal », la plupart des crimes n’ayant jamais d’autre motif que le fric ou le cul. Pour Houellebecq comme pour Schopenhauer, les hommes aiment la mort, les femmes aiment la vie, et les féministes se grattent.
Quant à la « mère-nature » (que l’on devrait plutôt appeler marâtre), elle est ce qui doit être inlassablement combattue. Lieu de tous les dangers et de la cruauté indifférenciée (la campagne infestée de mouches, de serpents et de scorpions, les oiseaux « indifférents à tout drame humain » et dont la vie stupide est vouée à la dévoration d’insectes et de larves), la nature ne saurait être un refuge pour l’humanité et encore moins l’objet d’un « retour ». Aussi violente qu’une cour de récréation d’école primaire où les plus forts maltraitent les plus faibles, la nature n’est qu’une jungle où le struggle for life est la seule loi. Inhumains seront désignés ceux qui ne jurent que par elle et pire veulent « la retrouver » à leur mort en y faisant disperser leur putain de cendres.
« De fait, il se rendait compte qu’il désapprouvait totalement la tendance modeste, moderne, consistant à se faire incinérer et à disperser ses cendres en pleine nature, comme pour mieux montrer qu’on retournait en son sein, qu’on se mêlait à nouveau aux éléments. (…) L’homme ne faisait pas partie de la nature, il s’était élevé au- dessus de la nature, et le chien, depuis sa domestication, s’était lui aussi élevé au-dessus d’elle, voilà ce qu’il pensait au fond de lui-même. Et plus il y réfléchissait plus il lui paraissait impie, bien qu’il ne crût pas en Dieu, plus il lui paraissait en quelque sorte anthropologiquement impie, de disperser les cendres d’un autre être humain dans les prairies, les rivières ou la mer… »
C’est clair : la nature, c’est la mort, et l’attirance que l’on peut avoir pour elle est une attirance mortifère – celle des trois personnages principaux en l’occurrence et dont le rêve de bonheur vaguement rousseauiste se confond avec le retour aux origines, à la maison familiale, et même en ce qui concerne le personnage de Houellebecq, au lit de son enfance. Une fois de plus, il s’agira de ne pas confondre le constat moral que fait l’auteur des désirs fœtaux de ses personnages (dont il est) avec une quelconque « utopie sociale ». Tout comme le clonage dans La Possibilité d’une île, la nature apparaît aussi dans La carte, du moins dans sa dimension végétale, régressive, et avec l’indéniable bien être que suppose toute régression, ce que l’homme désire le plus et qui le perd.
 Transcendance et transindividualité
Transcendance et transindividualité
Dans ce monde où tous les individus se ressemblent, la dissemblance a lieu à l’intérieur de l’individu – tel Marylin Prigent, l’attaché de presse, d’abord laideron malheureux, « pauvre petit bout de femme, au vagin inexploré », et qui lorsqu’elle réapparaît un peu plus loin dans le récit a changé du tout au tout. Le tourisme sexuel a fait d’elle une femme neuve, « chaude », baisante, et dont la transformation radicale, et d’ailleurs porteuse d’espoir, fait dire à Jed : « C’est impressionnant quand même à quel point les gens coupent leur vie en deux parties qui n’ont aucune communication, qui n’interagissent absolument pas l’une sur l’autre ». Le paradoxe est que Houellebecq fait exactement le contraire dans son roman – que tout interagisse, se croise ou se répète, notamment les personnages, prouvant ainsi que « l’individualité n’ est guère qu’ une fiction brève. » Un, nous pouvons être plusieurs. Plusieurs, nous ne formons plus qu’un.
Hasard des particules, donc. Pour autant, l’éparpillement n’a jamais lieu. L’association d’idées fonctionne et loin de disséminer le sens le concentre à taux plein - et notamment via la première association, l’originelle association, celle entre la mort et le sexe. C’est en plein enterrement de la grand-mère chérie que Jed se rappelle Geneviève, la première femme aimée, qui sur le plan érotique « lui avait tout appris », et parce qu’elle lui avait aussi parlé, en bonne malgache qu’elle était, des coutumes d’exhumation pratiquées dans son pays où le mort est réellement considéré. Mais le souvenir n’a pas simplement une valeur mémorielle personnelle, il peut aussi opérer un lien inattendu entre différents individus comme dans la scène, la plus belle du roman à notre avis, où Jed, frappé par l’intensité du regard de Houellebecq, se rappelle de ce que lui disait Olga du sien – et décide alors de peindre celui de l’écrivain. Au-delà de l’introjection plus ou moins narcissique de Jed pour Houellebecq (et peut-être de Houellebecq pour lui-même - même si réduire le roman à une « autosatisfaction glorieuse » comme l’a fait Tahar Ben Jelloun relève d’une incompréhension stupéfiante du romanesque), cette scène marque le début du processus transindividuel qui sera dès lors à l’œuvre dans le monde de La carte - chaque individu n’étant que le miroir d’un autre et Michel Houellebecq étant le miroir souverain de chacun, sinon le monogramme christique de l’humanité (et qui en ce sens ne pouvait qu’être sacrifié).
Jed Martin d’abord, puis le commissaire Jasselin dans la troisième partie, seront ainsi houellebecquisés à leur corps défendant autant qu’à leur âme consentante. C’est pourtant avec Jasselin que ce que l’on serait presqu’en droit d’appeler une métempsychose a lieu. « D’où lui venait la sensation qu’il y avait quelque chose qui le concernait tout particulièrement, à titre personnel ? », lit-on au sujet de celui-ci chargé de résoudre le meurtre de l’écrivain – et cela juste après nous avoir dit que l’un et l’autre, dans leur métier respectif d’écrivain et de policier, prodiguaient les mêmes recommandations, à savoir qu’il ne faut jamais rester inactif dans l’écriture comme dans la criminelle. Identicité des pensées et des paroles. Intérêt existentiel, quasi gémellaire du vivant pour le mort et qui ira jusqu’à la prière bouddhiste de l’Asubhà, « méditation sur le cadavre », établissant ainsi un contact au moins symbolique (1) entre eux. Finalement, la transindividualité est une forme de transcendance.
Reste la question de la foi, véritable pierre d’achoppement du roman, et contre laquelle certains critiques chrétiens risquent de forcer la leur – exactement comme le fait Patrick Kéchichian dans le roman qui à chaque fois qu’il voit une exposition de Jed Martin croit y déceler un mysticisme flamboyant exprimant la coparticipation de Dieu et de l’homme à travers une nouvelle Incarnation ! Ne serait-ce que pour provoquer nos « contemporains [qui] en savent en général un peu moins sur la vie de Jésus que sur celle de Spiderman », la tentation d’une interprétation religieuse est grande et les raisons d’y céder apparemment légitimes. Une référence à Chesterton par ci, une autre à Fra Angelico par là, une digression bien sentie sur la condition des prêtres page tant, jusqu’au baptême discret du personnage Houellebecq lui-même, sans compter l’indiscutable topique « jobienne » présente depuis le début chez l’auteur des Particules élémentaires, tout cela semble tracer une aspiration nouvelle mais sincère de ce dernier au catholicisme. On aurait alors toutes les raisons de faire de Houellebecq une sorte de Huysmans de notre temps, et qui, comme Huysmans dans le sien, aurait commencé son œuvre par la description de la charogne fin de siècle avec Lovecraft– contre le monde, contre la vie (son A rebours ?) puis serait passé à la misère sexuelle dans Extension, Particules, et Plateforme (ses En rade ?), aurait été ensuite tenté par le satanisme dans La possibilité d’une île (le clonage étant une volonté diabolique), son Là-bas, et aurait terminé sa carrière dans le roman de conversion avec un Oblat, notre Carte. En vérité, le problème de Jed Martin, qui après moult hésitations, finit par entrer dans l’église de son quartier, est plus de l’ordre de cette régression fœtale dont nous parlions que d’une réelle quête spirituelle. Entité à coup sûr plus noble et plus classieuse que la nature, la divinité joue pourtant dans la phénoménologie du roman le même rôle que celle-ci, et s’impose finalement plus comme une instance à laquelle on voudrait s’élever que comme une « présence réelle ». Du reste, à l’instar de Houellebecq dans son Loiret et Jasselin dans sa Bretagne, Jed finira dans le terrier de sa Creuse filiale, soit la maison de ses grands-parents qu’il rachète et rénove et dans laquelle il était déjà prêt à croire n’importe quoi de bienheureux :
« Il était tenté dans cette maison de croire à des choses telles que l’amour, l’amour réciproque du couple qui irradie les murs d’une certaine chaleur, d’une chaleur douce qui se transmet aux futurs occupants pour leur apporter la paix de l’âme. A ce compte-là il aurait bien pu croire aux fantômes, ou à n’importe quoi ».
 Religion des fantômes ou fantômes des religions – au lecteur d’opérer avec sa propre croyance, même si pour notre part, il nous semble patent que dans le cas de Jed, et malgré ce que disait Bernanos, il ne suffit pas de vouloir croire pour croire.
Religion des fantômes ou fantômes des religions – au lecteur d’opérer avec sa propre croyance, même si pour notre part, il nous semble patent que dans le cas de Jed, et malgré ce que disait Bernanos, il ne suffit pas de vouloir croire pour croire.
Ne reste plus pour ce dernier qu’à terminer son existence par d’ultimes travaux artistiques qui constitueront ce que la critique du XXI ème siècle finissant percevra comme « une méditation nostalgique sur la fin de l’âge industriel en Europe, et plus généralement sur le caractère périssable et transitoire de toute activité humaine. » A la manière d’un Monet ne peignant à la fin de sa vie plus que son jardin et dans son jardin, la nature sera le dernier atelier de Jed puis son matériau d’artiste. En recommençant tout par des vidéogrammes de la matière végétale mais vue du point de vue « végétal », avant de revenir à des représentations d’objets industriels ou de jouets d’enfants, tels les Playmobil, se dissolvant sous acide sulfurique, pour aboutir à des photos de photographies de tous ses proches se décomposant sous la végétation (et qui n’ira pas sans rappeler au lecteur les images du carnage de Petissaud, les phénomènes se reproduisant entre meilleur et pire modes), Jed, entre deux souvenirs sexuels, bouclera sa vie et son œuvre dans la fascination horrifiée de la nature triomphante et déshumanisante. Au fond, que le monde soit le fruit du hasard ou du destin, de l'art ou de la matière, qu'il soit organique ou non, transcendant ou non, transindividuel ou non, n'a plus aucune importance. La végétation l'emporte sur tous les agencements ou les croyances en ceux-ci, la mauvaise herbe sur toutes les fleurs. Entre temps, Frédéric Beigbeder sera mort et comme par hasard lui aussi dans le cocon familial. La France aura survécu aux multiples crises économiques du siècle, « bien pires que celle de 2008 », quoiqu'étant redevenue aux yeux du monde le pays des putes, des parfums et des rillettes. Et la vie continuera dans son pourrissement perpétuel.
(1) Tout cela allant de pair avec le désir réel de Houellebecq de rentrer en contact avec les morts, comme il l’avoue un moment dans l’entretien du Ring. Houellebecq « de culture spirite », sortant tout droit du XIXème siècle à travers les âges, de Philippe Muray – voilà ce qu’il faudra prendre en compte dans l’avenir !
[Cet article a d'abord été publié sur le Ring le 26 octobre 2010 sous le titre "Ecce Houellebecq".]



