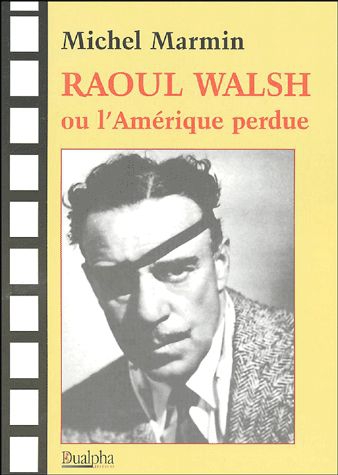
Le cinéma macmahonien, c'était cette conception hautaine, radicale, littéraire, "dandy" si l'on aime, "snob" si l'on n'aime pas, de l'esthétique cinématographique où l'on se donnait le droit de lire les films à travers Nietzsche, Péguy, Valéry, Gobineau, où se faire traiter de "fasciste" était une marque de coquetterie, surtout quand on s'appelait François d'Orcival ou Alain de Benoist que Michel Marmin rencontra à l'époque grâce à son premier livre sur Wash, paru chez Seghers en 1970, et qui devinrent des amis fidèles - et cela même si l'on adulait Losey, cinéaste de gauche s'il en est, autant que Walsh, Preminger et Lang (le fameux "carré d'as"). Contre la critique intello des Cahiers du cinéma n'ayant de goût que pour les grands européens prise de tête, Présence du cinéma ne jurait que par le cinéma américain, celui qui célèbre "les noces tumultueuses entre l'homme et le monde", les valeurs primitives dont dépend la survie éternelle, l'Amérique mythique enfin, et dont Marmin dit qu'elle représentait pour lui, quand il était jeune et innocent, "le bouclier de l'Occident" tandis qu'Israël en était "l'épée" (et notamment grâce à "ce formidable film de désinformation historique" que fut l'Exodus de Preminger). Plus qu'en la politique des auteurs, on croyait au grand style et à la civilisation - et on allait jusqu'à dire, par exemple à propos des films de Henry King, que ceux-là étaient de grands films parce qu'ils étaient d'abord des films américains avant d'être des films de Henry King. Le grand auteur était celui qui s'effaçait derrière son oeuvre même si son oeuvre glorifiait l'individualisme. Si Ford faisait dans l'utopie civique et humaniste, d'ailleurs sublime, bouleversante et toute aussi "américaine", Walsh ferait dans l'épopée surhumaine, où l'individu ne suit qu'une éthique souveraine et franche, la sienne - avec une possibilité de rachat social à la fin (La rivière d'argent) ou de châtiment exemplaire (Barbe-Noire). Pour ces hussards de la cinéphilie, le cinéma était, selon le mot de Michel Mourlet (attribué faussement à André Bazin par Godard dans Le Mépris) : "un regard qui se substitue au nôtre pour nous donner un monde accordé à nos désirs" - nos désirs traditionnels bien entendu, ceux qui ont constitué l'essence de l'humanité et qui ont relié les hommes et les femmes les uns aux autres depuis le début. "Quand j'approchais empiriquement, résigné, quelques lois universelles, seule ma mère importait, va jusqu'à dire Marmin (comme le personnage de Cagney dans L'enfer est à lui, tiens !). Je crois, en effet, que les hommes ne pourront se sauver et vivre ensemble que s'ils cherchent et ressaisissent le fil qui les relie, les uns et les autres, aux sources de leur génie et de leur singularité, rejetant les squelettes proposés par les professeurs et s'arrachant à la glu montante de la société moderne".
Implacables macmahoniens.
(Cliquer sur les images pour voir la bande-annonce ou un extrait du film.)
Barbe-Noire le pirate (Blackbeard the Pirate), Raoul Walsh, 1952 - Hé, hé ! Ho, ho ! Hu, hu ! Au bout de son douzième ricanement, il comment à nous les brouter menu, ce pirate, incarné par Robert Newton. Le truculent Barbe-Noire. Le débordant Barbe-Noire. L'ébouriffant Barbe-Noire. L'exaspérant Barbe-Noire surtout, le super gonflant Barbe-Noire, tellement matamore et grotesque que l'on est content qu'il finisse enterré vivant, sa seule tête dépassant hors du sable et attendant que la marée le submerge. Hors cette scène d'anthologie, force est de constater qu'il commence moins bien que mon cycle Ford, ce cycle Walsh. De ce dernier, je me rappelle de films vus dans mon adolescence (à la Dernière Séance et autre Cinéma de Minuit) et qui m'avaient tous plus ou moins déçus. Mal foutus, incohérents, souvent répétitifs sur le plan dramatique (Les aventures de Capitaine Wiatt, putain ! Pascal Zamor, tu es amateur, je crois ?), ultra-vides sur le plan psycho-métaphysique et par dessus-tout laissant toujours à désirer sur le plan de l'action pure. Vous savez, ce genre de film où ça s'agite beaucoup sans que cela satisfasse vraiment : faux raccords à la con, gens qui font semblant de se battre, coups d'épée ou de poing qui n'en sont pas, regard dans le vide des personnages mais qui se veut très "concerné" (mais bordel, on peut voir un instant ce qu'ils voient de si terrible ??!), découpage arbitraire (et pourquoi le gars qu'est mort il n'est pas mort ?). En même temps, une énergie bouillonne qui ne va pas sans charme. Un cinéma foutraque, féroce et bon enfant.
Dans ce Barbe-Noire réalisé en 1952, on retient le premier plan du film, le vaisseau presque fantôme qui entre au port dans la nuit bleutée, la séquence d'abordage finale pas si mal (mais statique et qui sent sa maquette, Pascaaaal....), la mort du gros con. Mais alors pour ce qui est de la romance entre le beau et la belle. On s'en fout, me direz-vous.
Non, ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, c'est la mémoire imaginaire que ce genre de film produit.... même si on ne les a pas vus. Au fond, je n'ai dû voir dans ma vie que deux films de pirates (celui-ci hier soir, et peut-être un autre dans le temps et que j'ai oublié jusqu'au titre - la seule chose dont je me souviens, c'était d'une flibustière qui fouettait un type qui plus tard devenait son amant, et certainement pour la raison dite) - et pourtant ce Barbe-Noire jamais vu correspondait exactement au film de pirates tel que je me l'imaginais. ll y a donc un bien un impact "culturel" dans l'inconscient fait à partir d'images qu'on n'a pas concrètement vues mais dont on sait qu'elles existent. En gros, il suffit d'avoir vu ou même entendu parler une fois dans sa vie d'une affiche d'un film de pirate pour savoir "en droit", c'est-à-dire "en imagination" (et le droit, c'est le domaine de l'imagination, disait Giraudoux), ce qu'est globalement un film de pirates. Il s'agit de savoir que ce genre existe pour le voir idéellement. Comme un film porno ou une nativité.
La femme en cage (Hitting a New High), Raoul Walsh, 1937 - La Femme en cage (Hitting a New High), réalisé en 1937, par Raoul Walsh, à qui je vais quand même donner une chance, est assez déjanté, très drôle par moment (la scène du lion dans l'appartement qui vaut celle de Chaplin dans Le Cirque), véritablement respectueux du genre opéra (les vocalises, quoique très belles, durent des plombes !! ce qui dans le Hollywood des années 30 n'est pas le plus évident) et donne l'impression que Walsh serait un cinéaste du loufoque et du brindezingue autant que de la grande aventure. Pour devenir soprano à l'opéra, une chanteuse de cabaret (Lily Pons, diva de l'époque et qui chanta la Marseillaise à l'opéra Garnier le jour de la libération de Paris) se fait passer auprès d'un impresario un peu idiot (Edward Everett Norton), et grâce à la complicité du secrétaire de celui-ci (Jack Oakie, le Benito Napoleoni du Dictateur de Chaplin), pour une "femme-oiseau" perdue en Afrique. Les deux compères partent alors en Afrique dans le but de la "capturer" et de la ramener à New York où elle fera sensation. Des quiproquo assez lourdingues se suivent mais l'extravagance du truc finit par l'emporter et on se dit qu'il y a là quelque chose qui nous avait quand même déjà plu dans Barbe-Noire : une certaine folie, ici douce, mais qui ne demande qu'à déborder.
Aventures en Birmanie (Objective, Burma !), Raoul Walsh, 1945 - D'autres que moi l'ont dit mais c'est vrai que ce film contient Apocalypse Now, Il faut sauver le soldat Ryan, La Ligne rouge et même Fear and desire qui en semble une mauvaise paraphrase (la patrouille perdue, le labyrinthe, le type qui devient fou, etc.) Aucun film de guerre qui, au fond, ne s'y retrouve et qui fait qu'on risque de ne pas en voir l'extraordinaire nouveauté (1945) la première fois qu'on le découvre. Peu importe qu'il soit ultra pro-américain et qu'il traite les "japs" comme on traitait encore les indiens à cette époque-là, soient comme des ennemis méchants (mais pas bêtes) à abattre. Après tout, la guerre n'était pas finie et la propagande est un nerf artistique comme un autre (la preuve, Henry V de Shakespeare qui était tout aussi univoquement patriotico-héroïque). Même pour un con d'antimilitariste, impossible de résister à cette incroyable mise en scène à la fois nerveuse et méticuleuse, qui rend les scènes de guerre aussi intenses que lisibles, qui sait passer sans faillir de la nature oppressante (les plans de ciel à la Ford sont rarissimes) aux visages oppressés (et celui d'Errol Flynn en premier lieu, acteur bien plus concerné que je ne pensais et que je redécouvre), qui se fout d'être chiadée du moment qu'elle va de l'avant, montre tout ce qu'elle doit montrer, emporte l'adhésion à chaque plan (ma scène préférée : les soldats qui se préparent à sauter en parachute dans l'avion et qui n'en mènent pas large), bref, fait son boulot. De la pure image mouvement - et mon premier véritable Walsh. Quel dommage que Deleuze ne le cite pas une seule fois dans ses deux ouvrages !
Archi-chef-d'oeuvre à part ça.
Magnifique western cinémascope ("on dirait que le que scope a été inventé pour lui", dira Tavernier), ces Implacables n'ont qu'un seul problème : leur titre mensonger. On s' attendait à des situations super violentes menées par des personnages ultra durs, un peu à la Sam Peckinpah ou à la Sergio Léone, et on se retrouve avec une romance langoureuse, parfois verbeuse, d'une femme (sublime Russel et ses longs bras, ses longues jambes) qui hésite entre deux hommes (le baroudeur Gable qui "voit petit" et résiste à l'appât du gain, et le nanti quoique très classieux et très bon tireur Robert Ryan qui veut s'acheter la moitié du Montana). Peu de scènes d'actions pour ce film sérieux (quoi qu'écrit par Clay Fisher, l'auteur des Tex Avery de la MGM !) qui mise tout sur la complication des sentiments, les conflits d'argent (à la lettre, un western "économique") et les scènes de bétail filmées à la Eisenstein. Le seul élément tragique et violent est introduit par le frère (Cameron Mitchell), jeunot blessé et arrogant et qui, parce qu'il est le personnage de trop entre les deux hommes et la femme, finit torturé et tué par les indiens. Pas de pitié pour ceux qui ne trouvent pas leur place fraternelle ou sociale. Il est vrai que pour Walsh le cynique, la civilisation commence et finit par la pendaison (première réplique du film) et le salut de l'homme consiste à se retirer dans un coin perdu avec femme et bocage. Pas de collectivité transcendante ni de référence biblique et encore moins de réconciliation nationale chez lui comme chez Ford. L'existence est sauvage, solitaire, implacable. On comprend que son auteur préféré, et qu'il connaissait sur le bout des doigts, fut Shakespeare.
Le voleur de Bagdad (The Thief of Bagdad), Raoul Walsh, 1924 - Dans ce décor gigantesque et écrasant, un homme ne cesse de bondir, courir, lever les bras, voler (sur un tapis volant), se battre contre les plus vilains monstres, et toujours avec ce sourire ravageur - car le héros se doit d'être heureux, optimiste, toujours en avant sur la situation. C'est Douglas Fairbanks bien entendu, l'acteur-auteur flamboyant du Voleur de Bagdad de 1924, le plus grand film d'aventures de cette époque et dont Walsh n'assura, aurait-on envie de dire, "que" la mise en scène, tant le projet semble être d'abord celui de l'acteur-athlète. Si l'expressionnisme était un combat entre la ténèbre et la lumière, celui mené dans ce film se déroule entre le décor et le vivant - et c'est là qu'intervient le génie de Walsh : faire bouger la matière, donner du mouvement à tout, au tout. A force de s'agiter dans tous les sens, Fairbanks contamine l'univers et bientôt ce sont les cartons pâtes qui deviennent vivants. Tout ce qui trouble l'inanimé est bon à prendre, à commencer par mes chères surimpressions, mon effet spécial préféré qui double le réel tout en le montrant et tout en faisant qu'on s'en fout qu'il le montre (voir le truc et en être encore plus heureux - magie du cinéma), mais aussi les doubles-expositions, et ce qu'on appelle le matte-painting (en gros, l'écran bleu, l'espace vide destiné à y être rempli). Comme l'écrit Jean Douchet "Peu à peu, comme les murailles de Jéricho, le décor cède. Il s'anime à son tour, vole dans les airs, plonge dans la mer, se métamorphose magiquement. Le vibrion s'en empare et le soumet à nos désirs, à notre plaisir d'enfants." Et c'est l'Orient rêvé autant par les occidentaux que par les orientaux eux-mêmes, Gérôme, Nerval et Flaubert d'un côté, les Mille et une nuits de l'autre. Défilées (et dénominations) de féérie : Vallée du Feu, Deuxième Lune, Caverne des Arbres Enchantés, Cristal Magique (le plus beau moment du film, au ralenti), Demeure du Cheval Ailé, Citadelle de la Lune, Pomme Magique, Cape d'Invisibilité, Tapis Volant. On pense à Harry Potter, au Seigneur des Anneaux, à Matrix et à La Flûte enchantée. Sans oublier l'inévitable femme qui dort sous son voile et qui pour Walsh est encore une occasion de filmer la respiration.
La piste des géants (The big trail), Raoul Walsh, 1930 - Il y a des bons acteurs qui ne sont pas des grands acteurs comme Laurence Olivier et il y a des grands acteurs qui ne sont pas des bons acteurs comme John Wayne. A le voir évoluer dans cette cette Piste des géants, le premier film dont il est la vedette, et premier film parlant de son metteur en scène, on est pris entre la perplexité et le rire nerveux. C'est lui le futur shérif de Rio Bravo ? Ce grand dadais qui a une démarche bizarre, des gestes approximatifs, un débit monocorde, et qui du reste retournera aux séries B ou Z après ce film et devra attendre qu'un certain John Ford lui accorde une seconde chance en 1939 avec La chevauchée fantastique et fasse de lui la plus grande star de Hollywood ? (en fait, la 13 ème selon l'American Film Institute*). Sans doute ne correspondait-il pas au cinéma walshien qui demande des acteurs, c'est curieux de le dire à propos de John Wayne, moins "intellectuels" que lui, plus physiques (Douglas Fairbanks), déterminés (James Cagney), séducteurs (Clark Gable) ou les trois à la fois (Errol Flynn). Wayne, c'est un héros assez lent dans le fond, crépusculaire, contemplatif, un homme tranquille qui ne rechigne jamais à l'action mais qui n'est pas dans le mouvement pur et encore moins la frénésie comme les trois cités. Pas étonnant qu'il s'arrange pour disparaître à deux reprises de ce Convoi des braves version Walsh (à moins que Le Convoi des braves ne soit The Big Trail version Ford) dont la véritable star est moins l'individu que la caravane aux prises avec les éléments déchaînés, la dure nature, et, dans la scène la plus célèbre du film, la falaise abrupte que l'on descend à la verticale en attachant avec des cordes chariots, boeufs et hommes. Aucun recueillement devant la création à la Ford chez Walsh comme aucun humanisme particulier. Une image chargée, jamais élégiaque, où ça bouge dans tous les coins mais qui n'en est pas moins étouffante (comme chez Griffith, tiens), où tout est âpre, violent, spectaculaire - même si La piste des géants semble être un de ses rares films qui croit à la collectivité, à fondation d'un monde, à la naissance d'une nation. Comme le dit le très mac-mahonien Michel Marmin (la cinéphilie de droite a existé et j'en suis tout chose !) : "The Big trail est un grand poème d'énergie nationale, un grand poème de fondation où fleurit cette volonté de construire, d'avancer, de défricher, de vaincre l'obstacle, chronique rigoureuse aussi d'une nation qui naît et grandit dans l'épreuve".
L'entraîneuse fatale (Manpower), Raoul Walsh, 1941 - Le début est éblouissant. Plans d'une centrale électrique, éclair qui déchire le ciel dans la nuit, poteau électrique qui explose, salle d'opération où la lumière vacille pendant qu'un chirurgien opère, autre poteau qui s'effondre dans la mer, informations qui circulent à tout allure entre les hommes, téléphone, interphone, posts, prévenir Hank McHenry (merveilleux Edward G. Robinson) et ses hommes, sortes de pompiers des lignes hautes tensions. A chaque intervention, ils prennent des risques fous. Tout de suite, donc, le combat de la matière avec elle-même, des éléments déchaînés contre la civilisation, du feu et de la pluie contre les hommes de bonne volonté. Car ce sont de bien courageux et héroïques ouvriers, ces gars-là, amicaux, bagarreurs, complices - et filmés dans leur confrérie comme Cassavetes le fera plus tard avec les travailleurs d' Une femme sous influence. A cette histoire de héros anonymes s'invite une histoire de femme et qui est moins sous influence qu'elle met les hommes sous influence - Fay, entraîneuse de cabaret, sort de prison. Elle n'a pas froid aux yeux et ne vit que pour séduire. Evidemment, Hank, moche, maladroit et sans doute impuissant, en tous cas handicapé depuis son dernier accident de travail, tombe amoureux d'elle - et moi aussi (être enfin sensible à Marlène Dietrich, quel bonheur !). Elle le prévient que la réciproque n'est pas vraie. Il lui répond qu'il aura "assez d'amour pour d'eux". Ils se marient, sous l'oeil méfiant de Johnny Marshall (excellent George Raft dans le rôle du pote idéal) et dont Fay tombe évidemment amoureuse depuis qu'elle l'a vu tabassé tout un bar. Tout est ultra sexuel dans ce film archi-sentimental et dont on ne racontera pas la fin tragique et immorale (et donc cathartique pour le spectateur qui aime que les forces vives se retrouvent - mais ça y est, putain, j'ai cafté.) C'est un film sur le travail, le danger, l'amour, l'amitié, la pulsion, la nature sauvage, la sublimation, le sacrifice, la mort, et à chaque plan, on a tout cela à chaque fois (y compris du Tex Avery - ou des scènes que Tex Avery parodiera) et va à une vitesse folle. Non, c'est prodigieux, bouleversant, excitant. Et quand je pense que je snobais ce cinéaste génial...
Admirez-moi donc ce début en cliquant sur l'image.
La Blonde Framboise (The strawberry Blonde), Raoul Walsh, 1941 - Comme le disait la bande-annonce de l'époque, c'est la "Cagney's romance". On pourrait dire tout autant le "Two lovers" de Raoul Walsh sur mode burlesque. A la fin du XIX ème siècle, un petit dentiste bagarreur qui perd toujours dans la vie (James Cagney épatant) est amoureux de la "blonde vénitienne" fatale (Rita Hayworth avant qu'elle ne devienne Rita Hayworth), mais celle-ci épouse l'ami traitre du dentiste (Jack Carson) qui passe sa vie à tourner en bourrique ce dernier et l'envoie même en prison cinq ans pour des escroqueries qu'il a lui même commis. Entre temps, celui-ci aura épousé par dépit une féministe en avance sur son temps (Olivia de Havilland - "Mélanie Wilkes" pour l'éternité) mais qui à force de sagesse et d'amour aura fini par le rendre heureux. A la fin, le dentiste se vengera (gentiment) de son ancien rival et pourra se battre victorieusement contre une bande d'étudiants chahuteurs - l'amour conjugal ayant finalement été plus fort et plus régénérant que l'amour passionnel. Au delà de cet aspect étonnamment "moral" (d'autant plus étonnant qu'il provoque l'enthousiasme du spectateur), cet incunable de l'auteur de L'enfer est à lui, qu'on a dit bien à tort "datée", est un grand film sur le changement d'époque : les nouvelles relations entre hommes et femmes (Murielle, c'est pour toi), l'apparition progressive de l'anesthésie dentaire ("pensez à l'époque où la morphine n'existait pas", avait l'habitude de rappeler George Steiner à ses élèves), de l'automobile (en un plan unique surprenant), et même la découverte des spaghettis bolognaises !!! Comédie ethnologique s'il en est, cette Blonde Framboise donne la part belle aux femmes qui sont là pour civiliser les hommes, eux-mêmes assimilés dès les premiers plans du film à des animaux sans cesse en conflit (la chien contre la chat, puis un peu plus tard le plan du lion en cage), et leur apprendre, plus qu'à aimer, à se faire aimer.
Victime du destin (The lawless breed), 1952, Raoul Walsh - Un peu terne, ce western "d'aventures" qui aurait pu tout autant être un thriller qu'un drame psychologique urbain. Il y a bien des duels au pistolet et des poursuites en cheval (et même une course genre tiercé), des saloons et des jeux de cartes, l'ambiance "western" n'y est pas tant que ça comme si Walsh ne faisait qu'en utiliser le décor pour y raconter son histoire tragique du gentil bandit accablé par le sort (Rock Hudson, que j'avais complètement oublié !), et tout cela à cause d'une robe de mariée qui allait lui assurer le bonheur. Force est de constater qu'il n'atteint pas l'évidence métaphysique d'un Ford dans sa description des rapports entre l'individu, Dieu, le mal, etc. Tout y est un rien simplet, explicatif, redondant - le personnage passant son temps à rappeler qu'il n'a jamais tué que par légitime défense. Il est vrai que c'est un film Universal à la limite de la série B, aux couleurs pas si chatoyantes que ça, sans humour, et qui semble freiner l'enthousiasme du metteur en scène - sauf dans les scènes, d'ailleurs très subtiles, avec la très pulpeuse Mary Castle. Mais c'est finalement cette gravité surprenante qui fait la vertu et la conviction de ce petit film, très efficace dans ce qu'il dit : l'homme qui a tous les talents (chance au jeu, en amour, au combat) mais qui est sans cesse puni de les avoir, sans doute à cause de son père fouettard qui a fait de lui un rebelle, et qui après mille fuites (et seize ans de prison quand même) retrouvera la paix et le bonheur dans sa ferme isolée du monde auprès de sa femme et de son fils, ce dernier qui lui aussi a failli devenir, et à cause de son père, victime du destin.
La rivière d'argent (Silver river), Raoul Walsh, 1848 - C'est le western balzacien de son auteur, et un de ses films les plus étonnants. Parce qu'il a cru faire un acte de bravoure en brûlant un million de dollars qui allait tomber aux mains des sudistes, un capitaine nordiste (Errol Flynn, l'acteur le plus introjectif du monde) se fait renvoyé de l'armée. Dépité, il jure de n'obéir désormais qu'à ses propres lois et devient un capitaliste avisé et sans scrupules, mais avec quel panache mon Dieu, n'hésitant pas à se débarrasser d'un rival encombrant pour lui prendre sa femme (Ann Sheridan, vraiment pas intéressante), et cela malgré les exhortations de son avocat (excellent Thomas Mitchell, "le père de Scarlett"). Ayant finalement tout perdu, il décide, sans doute pour conserver l'amour de sa femme, de ne se consacrer plus qu'aux ouvriers - ce qui de toutes façons ravit le spectateur comme tout ce que fait ce formidable Michael McComb depuis le début. Rarement un film ne sera en effet allé autant dans le sens du poil du spectateur avec sa célébration tout azimut de l'individualisme triomphant et de tous ses affects flatteurs : le héros désavoué par la collectivité et qui se venge d'abord de celle-ci en la ridiculisant (scène de distribution de billets aux hommes dans le dos des officiers - rien de plus jouissif au cinéma que la justice immédiate et illégale, ce que j'appelle "la morale Dumbledore"), l'homme supérieur qui fait fortune grâce à son courage et à son intelligence et dont l'énergie amorale fait dangereusement envie, enfin le cynique quasi criminel qui devient en bout de course chevaleresque et avec une vitesse existentielle que n'aurait pas dénié le Goetz de Le Diable et le bon Dieu, la pièce de Sartre. Vitesse psychologique et dramatique, donc, que l'on ne manquera pas de trouver improbable dans la vraie vie mais qui n'en exprime pas moins la vitesse économique, industrielle, financière du capitalisme en action ou en mouvement, que finalement seul un as de l'image action ou de l'image mouvement pouvait filmer avec une telle dextérité. Et si à cela on ajoute les deux fabuleuses scènes d'action qui enchâssent le film, la poursuite en chariot que McComb met en feu et la bagarre de rueavec gestion admirable des mouvements de foule, on aboutit à un chef-d'oeuvre qui s'appelle La Rivière d'argent.
La Blonde et le shérif (The Sheriff of Fractured Jaw), Raoul Walsh, 1958 - On a tout dit de cette pauvre Jayne Mansfield, sous Marylin Monroe, écervelée totale, ultra-mauvaise actrice, starlette de navets glamour, et qui est morte à la Albert Camus. N'empêche que lorsque l'on a quinze ans, elle se révélait une étourdissante machine à fantasmes, et que plusieurs décennies plus tard, notre propre machine nerveuse, solitaire et post-adolescente, peut toujours se nourrir d'elle, de sa poitrine intensément existentielle, de son bassin schopenhaurien qui suscite le vouloir-vivre et de ses lèvres lucréciennes qui redonnent goût à la nature des choses. D'ailleurs, est-elle si mauvaise que ça ? Dans ce western rigolo de Raoul Walsh, La Blonde et le Shérif (1958), elle assure merveilleusement dans son rôle de tenancière de saloon autoritaire et chaleureuse qui apprend à un britannique (Kenneth Moore), et avec toutes les métaphores adéquates, à se servir d'un révolver, et sait user de l'écho des falaises quand elle chante sa chanson suave. Derrière sa niaiserie apparente, le film séduit par sa bonne humeur clicheteuse (mais qui a influencé bon nombre de Lucky Luke, à commencer par Le Pied Tendre), son humanisme naïf (la réconciliation des indiens et de l'homme blanc, tout de même) et sa savoureuse description du choc des civilisations européenne et américaine. La meilleure scène est bien sûr celle de la cabane des paysans "affreux, sales et méchants" où l'anglais tente de vendre ses armes à un mari taiseux qui mange sa soupe pendant que sa femme parle à sa place ("Luc, il parle pas quand il bouffe", "Luc, il peut écouter quand il bouffe", "Luc, il a fini de bouffer"). A la fin, Jayne vient sauver l'anglais et l'on se dit qu'elle est si belle, si bonne, si tout qu'on aurait envie de lire le livre de Simon Liberati, "Jayne Mansfield, 1967", Prix Fémina 2011. Et si quelqu'un retrouve cette photo d'époque où l'on voyait Jayne signer en cuissarde un autographe à un ado de 15 ans, par pitié, que l'on me l'envoie.
La femme à abattre (The Enforcer), Raoul Walsh, 1951 - Un début ébouriffant : pour ne pas avoir à témoigner contre son chef, Mendoza, à qui il prête des pouvoirs quasi surnaturels façon Keyzer Sösse, un pauvre truand préfère s'évader par la fenêtre façon Tintin en Amérique et se tue. Une fin époustouflante : dans les rues de New York, une femme est filée par deux tueurs qui veulent l'abattre et par le procureur qui veut la sauver. Entre les deux, un milieu (au deux sens du terme) de pure terreur, celle de ce chef de gang qui a monté une organisation de tueurs (et dont un plan séquence les montre leur gueule patibulaire les uns après les autres façon Scorsese). Dans ce chef-d'oeuvre du polar noir, qui rappelle certaines ambiances de James Ellroy, tout est violence, panique, désespoir - mais aussi espoir, courage, force positive, celle de Bogart, évidemment, qui n'a jamais été aussi dur et aussi... rassurant.
"Le découpage de The Enforcer, partiellement construit en flashes-back, est prodigieux, écrit ce grand Mac-Mahonien de Michel Marmin, : rapidité, ellipses, action constante et essentielle, aucun plan inutile, aucun ralentissement. Au coeur de cette action brutale et d'une extrême précision dramatique, l'épopée purement intérieure, est gravée dans les traits mêmes du héros, dans la moindre expression du jeu ramassé de Bogart : tenson sans cesse contenue, économie savante du geste, rapidité et intelligence du regard, sagesse et lucidité incrustées dans le dessin profond des rides, impassibilité du visage où la rage et la colère éclatent rarement, et seulement dans le sourire, le terrible sourire de Bogart".
Sans conteste, au firmament de son auteur.
Les fantastiques années vingt (The roaring twenties), Raoul Walsh, 1939 - Dans les tranchées. Un soldat saute dans un trou et tombe sur un autre soldat en train de rouler sa cigarette. Le second : - Te gène pas, hein ! Le premier : - Pourquoi ? J'ai oublié de frapper ?
Plus tard, ils se retrouveront, s'associeront dans le trafic d'alcool. Mais à la fin de la prohibition, le premier tombera dans la misère alors que le second deviendra un criminel florissant. Afin de protéger la femme qu'il aime mais qui lui aura préféré un autre, le premier liquidera le second mais sera abattu par ses hommes. Il mourra dans les bras de l'autre femme, celle qui l'aime depuis le début. Au policier qui lui demande qui il était, elle répond en larmes : "Il s'appelait Eddy Bartlett et c'était un caïd".
Caïd malgré lui, Eddy aurait voulu, après la guerre, devenir un honnête homme. Mais comme le militaire héroïque de La rivière d'argent incarné par Errol Flynn, le monde normal l'aura trahi, humilié, rejeté. Il sera devenu un gangster selon une logique que n'aurait pas renié Rousseau. L'homme nait bon mais la société le rend méchant - la revanche individuelle en plus : non-reconnu comme tel par la société, le héros devient un salaud, c'est-à-dire un vengeur. Le pire, c'est qu'on trouve toujours plus vengeur ou plus salaud que soi, particulièrement dans le "milieu". Et si Eddy demande toujours à ses hommes de ne pas utiliser leurs armes, George, son associé, ne se gène pas pour tirer sur ses adversaires - comme il avait tiré dans les tranchées sur un "môme" une seconde avant la déclaration de la fin de la guerre. Sa mort à lui sera ignominieuse - la grande spécialité de Bogey à l'époque. Celle de Cagney quasi miséricordieuse. Terrifiant dans L'enfer est à lui, l'acteur est ici bouleversant dans son rôle de malfrat en qui la violence monte progressivement et à laquelle il tente de résister. Les fantastiques années vingt est une pure histoire d'économie, soit une pire histoire de violence. Ce que montre le très balzacien Walsh, c'est que la guerre contre le système devient toujours une guerre des gangs. Les loups finissent toujours par s'entretuer selon une sorte de justice divine. Scorsese, Coppola et Léone sauront s'en souvenir. A part ça, film génial.
Capitaine sans peur (Capitaine Horatio Hornblower), Raoul Walsh, 1951 - Le film typique de La Dernière séance. Un beau truc héroïque qui va outrancièrement dans le sens du spectateur avec son héros antonyme qu'a l'air de jamais souffrir même quand il est plein de sang et plein de souci, son méchant insupportable basané qui menace de torturer tout le monde et qui périt vite fait bien fait sous une poutre, son héroïne anti-gender, l'aristocrate au grand coeur qui joue les infirmières sur les bateaux, ses combats navals (navaux ?) un peu statiques, son finale ultra deus ex machina où ceux qui ne servent à rien sont liquidés en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Le film lui-même est bancal, mais on s'en fout, tant la première partie est quand même très forte, très historique, très réaliste (un galion contre un autre galion) alors que la seconde est un peu plus faible quoiqu'assez délirante. Walsh n'a pas peur de faire dans la série B invraisemblable (un galion contre des tas de galions) mais qui ne sert qu'à faire passer le temps, histoire de réunir l'homme et la femme. Hornblower (Gregory Peck, le genre d'acteur dont on se demande toujours s'il en est un - pas étonnant qu'il fût l'ami de Chirac) est marié. Qu'à cela ne tienne, quand il revient chez lui après une mission de neuf mois, sa femme est morte en accouchant de leur fils. Quant à Lady Barbara (Virginie Mayo, le genre d'actrice etc...), elle est aussi mariée à un sale connard mais dont le scénario se débarrasse en une réplique ("il a été tué au combat", génial.) Bref, un film qui joue sur les acquis, les attentes et les récompenses du spectateur lambda, et même si Marmin le compare au Typhon de Conrad (ce qui fera plaisir à Pascal Zamor), et qui se voit en VF emmitouflé dans sa couverture quand on est grippé et qu'on ne veut pas se prendre la tête avec Pierre Boyer sur Tomboy. Parce que, je veux pas dire, mais sur la théorie du genre, Raoul, Greg et Virginia, ils sont bien d’accord avec moi !!!

O.H.M.S (You are in the army now), Raoul Walsh, 1937 - Petit film hyper nerveux (mais, dit Dominique Rabourdin en bonus, Walsh était à l'aise comme tout dans les petites productions plus que dans les grandes), qui commence comme un film noir digne des plus grands (la nuit, New York, les violences), continue dans la comédie militaire anglaise avec des relents de mélo et s'achève dans le drame héroïque et sacrificiel, "O.H.M.S" (distribué aussi sous le titre "Au service de sa majesté"), pourrait être le manifeste de son auteur. Action serrée et brutale, fluidité narrative (on passe d'un genre et d'un affect à l'autre), vitesse dramatique et psychologique (parfait pour une histoire de fausse identité), un film qui ne fait qu'aller en avant, pur image mouvement qui se fout des réalités, le cinéma n'étant là que pour fournir des images qui s'accordent à nos désirs, "au service de sa majesté le spectateur", et selon la conception macmahonienne. Le seul bémol réel réside dans son acteur, Wallace Ford, sorte de sous James Cagney, un peu fadasse, un peu chochotte. Anna Lee n'est pas non plus très bandante même si elle a une réplique à la Mae West.
Pas trouvé d'extrait ni de BA.
La fille du désert (Colorado Territory), Raoul Walsh, 1949 - De ce sublime western noir, Michel Marmin a admirablement parlé. Et comme on ne peut dire mieux, je lui laisse la parole :
"Quel admirable couple que celui formé par Virginia Mayo et Joel McCrea dans Colorado Territory [La fille du désert, 1949], ce couple soudé par le destin qui les conduit implacablement vers la mort, comme une montée rectiligne et sans faille vers la grâce (...) et qui rappelle impérieusement Les amants de Kandahar de Gobineau :
« Moshèn se jeta sur Djemylèh, la soutint, l'embrassa, leurs lèvres s'unirent. Ils souriaient tous deux et tombèrent tous deux ; car une nouvelle décharge vint frapper le jeune homme et leurs âmes ravies s'envolèrent ensemble. » (...)
Le village espagnol abandonné, fantastique, délabré, véritable cité engloutie dans les sables, la montagne sauvage et sans couleur, les grandioses roches nues et escarpées, les canyons aux immenses falaises lisses : un décor lunaire, minéral, chaotique, qui envahit lentement l'écran et se referme sur les héros, doué d'une sorte de pouvoir magique, maléfique comme certains lieux maudits des légendes celtiques :
« On ne fréquente pas impunément ces lieux où les individus les plus sélectionnés de la race humaine donnaient rendez-vous à la la divinité. » (André Fraigneau). (...)
Colorado Territory, c'est le contraire de l'exécrable Bonnie and Clyde, d'Arthur Penn, cette hypocrite apologie de vermines hystériques dont la fin abjecte ressemble à celle des cancrelats que l'on écrase sous le talon. Un art populaire vrai n'est jamais un art vulgaire, et d'un limon plébéien, Raoul Walsh fait naître des princes. Ce que j'admire le plus dans Colorado Territory, c'est le naturel souverain, la sérénité de Joel McCrea et de Virginia Mayo, la distinction et la puissance de leur amour jamais dominé par la tragédie, leur immense tendresse contenue dans des gestes rares et des sourires dignes de ceux des anges des cathédrales, leur absence voulue de crispation et de colère - leur contentement, peut-être leur bonheur. Il n'y a pas de geste plus émouvant que celui d'un garçon et d'une fille se prenant la main. Un baiser peut-être le symbole d'un achèvement. Le serrement de main de Joel McCrea et de Virginia Mayo à l'instant de leur mort ne peut être qu'un symbole de début, celui de leur transfiguration.
« Soif du Créateur, flèche et désir du Surhumain : dis-moi, mon frère, est-ce là ta volonté du mariage ? Je sanctifie une telle volonté et un tel mariage. » (Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.)"
Bungalow pour femmes (The revolt of Mamie Stower), Raoul Walsh, 1956 - Plus beau que Rita Hayworth qui se retournait vers la caméra avec un large sourire dans son premier plan de Gilda, Jane Russel qui se retourne vers la caméra en faisant la gueule au tout début de Bungalow. D'emblée, le ton est donné : à l'image de son héroïne, le film sera aussi flamboyant que déplaisant, aussi sexy qu'anti-romantique, donnant l'impression qu'il va creuser la passion alors qu'il ne va s'intéresse qu'à la pulsion - et celle de l'argent avant tout, c'est-à-dire de la survie. Couleurs fortes jusqu'à l'âpreté, longs plans étouffants, montage durement elliptique qui tue le temps des sentiments, tout est là pour faire de cette histoire qu'on aurait cru d'amour (point de vue l'homme, le plutôt fade Richard Egan) une histoire de volonté sociale et vénale (point de vue de la femme, Jane Russel, donc, femme forte, blessée, obligée de sacrifier ses sentiments pour survivre, ce qui fait d'ailleurs qu'on lui pardonne), et selon une logique naturaliste qu'on croirait tirée de Maupassant, l'un des auteurs préférés de Walsh et dont ce film était, paraît-il, le préféré... de Fassbinder. Ce cinéaste qu'on considère si souvent des grands espaces et des luttes entre l'homme et les éléments connaissait aussi la part basse, c'est-à-dire économique, de l'homme - c'est là d'ailleurs sa vraie différence avec Ford chez qui même dans la misère la plus noire (Raisins de la colère, Qu'elle était verte ma vallée), la vénalité ou l'avidité (La rivière d'argent) ne sont jamais la solution, ni même la tentation. Pour autant, la femme vénale et avide n'est pas suivie par le réalisateur (et donc par le spectateur) comme une salope. Film féministe s'il en est, Mamie Stower montre en fait l'énergie d'une femme révoltée qui cherche avant tout son indépendance, quitte à renoncer à un homme qui l'aimait mais qui, il est filmé ainsi (Richard Egan n'étant pas Clark Gable qui avait été pressenti au début), n'était pas à la hauteur.
(Addendum : C'est un film peu flatteur (malgré Jane) qui met sur des fausses pistes : les couleurs annoncent du glamour lyrique et on a une histoire naturaliste assez dure - et peut-être pas assez au vu de nos expériences "modernes" de spectateur. Mais le film contient des surprises : le personnage qui bat les femmes, ou le type qui revient en running gag acheter des tickets et se précipiter dans la chambre d'une des prostituées pour jouer et perdre aux cartes avec elle. En fait, c'est un film dont Lars von Trier devrait faire un remake !)
Le monde lui appartient (The world in his arms), Raoul Walsh, 1952 - Ca, c'est du grand Walsh. Melvillien et nietzschéen, rocambolesque et réaliste, glamour et lyrique, avec Gregory Peck, qui sourit quand il se bagarre et n'a jamais mal quand on le fouette au knout, Anne Blyth qui a mal à sa place et qui fait tout ce que l'on attend d'une héroïne de film d'aventure de ce genre, c'est-à-dire rien, au fond l'anti Jane Russel (Bungalow pour femmes), l'anti Virginia Mayo (Colorado territory) et même l'anti Jayne Mansfield (La blonde et le shériff), mais on s'en fout parce que le vrai amour de Peck, dans ce film de corsaires fous, ce n'est pas elle, mais bien "le Portugais" incarné avec prodige par Anthony Quinn qui dira un jour à Bertrand Tavernier que Walsh lui avait donné, lors du tournage, le meilleur conseil, en guise de direction d'acteur, de sa carrière : "il me manque l'ail, donne-moi l'ail". Et Quinn jouera "l'ail", jouera le personnage qui a bouffé de l'ail, qui en sue, mais qui déborde d'énergie ravageuse, de joie conquérante, d'innocence roublarde (même quand il perd au bras de fer, il éclate de rire et n'en tient pas compte) et dont l'amitié consiste à se battre avec son ami (un peu comme dans les films de Ford) et à faire la plus fabuleuse course de navires sur l'océan avec et contre lui, quitte à s'embrocher les voiliers. Parce que dans le monde de Walsh, c'est dans l'héroïsme que se fait la fraternité, le coup de poing l'amitié, la rivalité la virilité. Le rapport de force doit être chaleureux ou n'être pas (ou sinon, il devient un rapport de mort, ce qui arrive aussi puisque le monde est tragique). Et Noël Simsolo a bien raison de dire dans le bonus du DVD que "ce genre d'amitié brutale où l'on se bat avant de se réconcilier parle aux gosses [bien plus que Tous à poils, Tomboy et toutes ces conneries post-modernes]". Et s'il y a "un mystère Walsh", comme le remarque encore ce grand maître de Simsolo, celui-ci réside dans le souci de l'équilibre des forces et son esthétique de l'effleurement où l'on avance, on recule, on revient, on tourne autour - et comme l'illustre cette déjà citée course de navires. Tel le boxeur qu'il a été, Walsh (et Simsolo aussi) sait que l'art de la force est un art du contact et de l'esquive - et qui n'a rien à voir avec la bagarre de rue, où l'on frappe pour tuer. Il s'agit moins de se battre que de danser et de voler - et même quand le spectateur enfant est heureux comme tout de voir le méchant, plein de de morgue et d'injustice s'en prendre une par Gregory et s'effondrer comme une merde. Voilà le monde qu'on voudrait.
The man I love - Raoul Walsh, 1947, par Murielle Joudet. Très bientôt.
PISTES A SUIVRE :
http://www.lexpress.fr/informations/la-legende-du-mac-mahon_630872.html


















