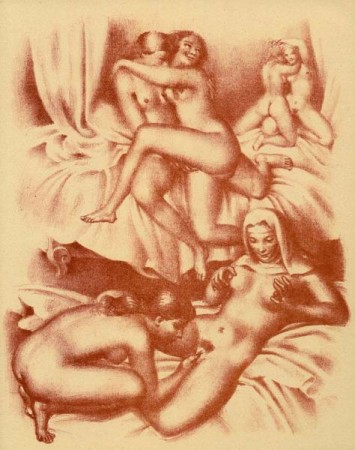« L’argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur non plus ne fait pas le bonheur » disait malicieusement Sacha Guitry. En vérité, rien en soi ne fait le bonheur, pas même l’amour, la paix, le savoir ou la santé. On peut être très amoureux, très cultivé, péter la forme, ne se disputer avec personne et être sans cesse au bord du suicide. L’adorée ne vous aime pas, les livres vous désespèrent, votre partenaire de tennis vous met six-zéro toutes les semaines, tout le monde vous évite car votre air sinistre non merci et vous vous retrouvez seul tous les soirs devant Arte. Dans ce cas-là mieux vaut avoir de l’argent qui facilite les amours, favorise les amitiés (et vous fera gagner au tennis), permet toutes les frasques culturelles (tiens, Robert Alagna chante au Met de New York ce soir, si j’y allais ?), et autorise à s’inscrire aux établissements thermaux les plus huppés. Donc, l’argent fait le bonheur. Question suivante ?
 Non, ce que l’on voulait dire, c’est que le bonheur n’est pas gai, le bonheur est une chose sérieuse, le bonheur demande beaucoup d’efforts et d’énergie, le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt, le bonheur est une construction sociale. La preuve ? Si je dis que mon bonheur consiste à aller lire Matzneff au Luxembourg, voir un film du cycle Romy Schneider au Champo, m’envoyer la côte de bœuf à la sauce béarnaise et au sel de Guérande du Saint André, descendre une bouteille de Saint Emilion avec un ami et dire du mal de tous nos amis communs, déguster un Cohiba robustos avec un verre de Bowmore, et finir la soirée chez une masseuse professionnelle (150 euros avec fellation), vous ne manquerez pas de me rétorquer avec un peu de tristesse, car je vous connais, que ces plaisirs-là ne sont que des fuites cultureuses ou vénales qui n’ont rien à voir avec le bonheur, que d’ailleurs le plaisir n’est pas le bonheur, et que se saouler, même avec le meilleur vin du monde, est un signe de détresse affective comme aller voir une pute en est un de misère sexuelle. Bref, vous verrez en moi un être immature et dépressif qui à trente-sept ans vit comme un étudiant sur le retour, incapable de faire quelque chose de sa vie et bon seulement à polluer la belle notion de bonheur dans l’article qu’il lui consacre. Car l’homme vraiment heureux ne lit pas l’infâme Matzneff et ne va pas casser du sucre sur ses amis avec un complice aussi malheureux que lui. L’homme vraiment heureux est avant tout un être moral qui rentre le soir chez lui fier du travail accompli, qui retrouve sa femme, ses enfants, qui décide d’envoyer son aîné en pension car celui-ci n’en fout pas une à l’école malgré les corrections régulières qu’il lui inflige (mais qui aime bien fait bien mal), qui appelle la police pour qu’on vienne chercher le SDF qui dort dans sa rue (car faire respecter la loi c’est faire le bien de tous donc de chacun), qui envoie son obole chaque mois à une association de protection de l’enfance dont il fait partie, mais qui ne déteste pas se regarder le porno de Canal pendant qu’il prouve à sa femme qu’il est un homme et qui se dit que si elle pleure c’est qu’elle aime ça. Le bonheur, c’est travail, famille, patrie. Bouge pas, salope.
Non, ce que l’on voulait dire, c’est que le bonheur n’est pas gai, le bonheur est une chose sérieuse, le bonheur demande beaucoup d’efforts et d’énergie, le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt, le bonheur est une construction sociale. La preuve ? Si je dis que mon bonheur consiste à aller lire Matzneff au Luxembourg, voir un film du cycle Romy Schneider au Champo, m’envoyer la côte de bœuf à la sauce béarnaise et au sel de Guérande du Saint André, descendre une bouteille de Saint Emilion avec un ami et dire du mal de tous nos amis communs, déguster un Cohiba robustos avec un verre de Bowmore, et finir la soirée chez une masseuse professionnelle (150 euros avec fellation), vous ne manquerez pas de me rétorquer avec un peu de tristesse, car je vous connais, que ces plaisirs-là ne sont que des fuites cultureuses ou vénales qui n’ont rien à voir avec le bonheur, que d’ailleurs le plaisir n’est pas le bonheur, et que se saouler, même avec le meilleur vin du monde, est un signe de détresse affective comme aller voir une pute en est un de misère sexuelle. Bref, vous verrez en moi un être immature et dépressif qui à trente-sept ans vit comme un étudiant sur le retour, incapable de faire quelque chose de sa vie et bon seulement à polluer la belle notion de bonheur dans l’article qu’il lui consacre. Car l’homme vraiment heureux ne lit pas l’infâme Matzneff et ne va pas casser du sucre sur ses amis avec un complice aussi malheureux que lui. L’homme vraiment heureux est avant tout un être moral qui rentre le soir chez lui fier du travail accompli, qui retrouve sa femme, ses enfants, qui décide d’envoyer son aîné en pension car celui-ci n’en fout pas une à l’école malgré les corrections régulières qu’il lui inflige (mais qui aime bien fait bien mal), qui appelle la police pour qu’on vienne chercher le SDF qui dort dans sa rue (car faire respecter la loi c’est faire le bien de tous donc de chacun), qui envoie son obole chaque mois à une association de protection de l’enfance dont il fait partie, mais qui ne déteste pas se regarder le porno de Canal pendant qu’il prouve à sa femme qu’il est un homme et qui se dit que si elle pleure c’est qu’elle aime ça. Le bonheur, c’est travail, famille, patrie. Bouge pas, salope.
 Diable ! Encore un paragraphe qui part en vrille. J’ai décidément bien du mal avec cette notion. Qu’en disent les philosophes au fait ? Pour Platon, le bonheur, c’est la justice, pour Aristote, c’est l’acte propre de chaque être, pour Epicure, c’est l’ataraxie (l’absence de trouble), pour les Stoïciens, c’est l’apathie (l’absence d’affects), pour les chrétiens, c’est le sacrifice et l’amour (beaucoup d’affects et pas mal de troubles), pour Spinoza, c’est la joie difficile (mais tout ce qui est beau est difficile), pour Kant, c’est le devoir, pour Rousseau, c’est l’innocence (et la fessée), pour Schopenhauer, c’est le renoncement (et la bouffe à laquelle il est impossible de renoncer), pour Nietzsche, c’est le surhomme (qui conduit à la folie), pour Marx, c’est le goulag, pour Heidegger, c’est le chemin de campagne, pour Michel Onfray, c’est dire du mal de Dieu. Lui-même a beau prôner la gastronomie, la libération des sens, le dionysisme à tout crin, il se révèle un type sévère, rigoureux, donneur de leçon à ses heures et d’une tempestivité qui ferait rougir Luc Ferry et André Compte-Sponville eux-mêmes. On a tort de les opposer. Même si André et Luc ne jouent pas dans le même préau que Michel, tous les trois ont su faire de la philosophie pour tous et vendre beaucoup de livres qui sont autant de manuels de bien-vivre que les cent façons d’être heureux. André est le plus direct : Le bonheur désespérément, La plus belle histoire du bonheur ; Luc s’intéresse d’abord à la vie : Qu’est-ce qu’une vie réussie ?, Apprendre à vivre, puis à la vie de famille : Famille, je vous aime, et ne déteste pas Vaincre les peurs ; Michel a l’air de s’éclater plus : Journal hédoniste, Théorie du corps amoureux, Féeries anatomiques et même Le christianisme hédoniste. Sans préjuger systématiquement de la qualité de ces ouvrages, sans même tomber dans le procès d’intention des « philosophes médiatiques », et encore moins dans celui du public qui les lit, force est de reconnaître que l’amalgame qu’ils ont fait entre philosophie et bonheur risque de dérouter nombre de lecteurs quand ces derniers ouvriront un vrai livre de philosophie. C’est que la philosophie donne moins de bonheur qu’elle ne crée de l’inquiétude ou qu’elle n’effraie. Comme le dit plaisamment Clément Rosset dans son livre sur Schopenhauer, « il ne faut pas compter sur le philosophe pour trouver des raisons de vivre ». Et contrairement à ce qu’ont l’air de démontrer le succès des livres de ses confrères et leurs multiples apparitions télévisuelles, le philosophe n’est traditionnellement jamais le bienvenu dans la cité. Le philosophe désespère, scandalise, blasphème, agresse, terrorise, décourage. Il détruit les idoles, suspend les jugements, torpille les opinions. Il se masturbe en public, détourne les esprits les plus jeunes et provoque la haine des parents d’élèves. Le philosophe, c’est le danger public par excellence que les autorités décident un jour de neutraliser. Et pour commencer, le premier d’entre eux, Socrate, accusé de corrompre la jeunesse et condamné à boire la ciguë par les juges d’Athènes. Plus tard, ce seront Giordano Bruno jugé et brûlé comme hérétique, Spinoza banni par les siens, obligé de s’exiler et échappant même à une tentative d’assassinat, son nom devenant synonyme d’infamie ! Kierkegaard, traîné dans la boue par la presse de Copenhague et pourchassé à coup de pierres par la populace. C’est que la populace, dont on dit qu’elle ne comprend rien à la philosophie, la comprend en fait bien mieux que l’universitaire, car elle y pressent à l’état pur son amoralisme fondamental, son ironie antisociale, ses capacité de destruction contre ce qu’elle a de plus cher – la croyance en la morale, la certitude de ses espérances, toute une série d’illusions vitales dont on ne peut sans dommage lui révéler qu’elles le sont. Vous ne me croyez pas ? Vous pensez que j’exagère ? Lisez donc sérieusement (c’est-à-dire non universitairement) la Généalogie de la morale de Nietzsche ou le Traité du désespoir de Kierkegaard et vous comprendrez pourquoi l’honnête père de famille ne peut qu’haïr la philosophie… et pourquoi la haine de la philosophie n’est au fond que la meilleure garante de celle-ci.
Diable ! Encore un paragraphe qui part en vrille. J’ai décidément bien du mal avec cette notion. Qu’en disent les philosophes au fait ? Pour Platon, le bonheur, c’est la justice, pour Aristote, c’est l’acte propre de chaque être, pour Epicure, c’est l’ataraxie (l’absence de trouble), pour les Stoïciens, c’est l’apathie (l’absence d’affects), pour les chrétiens, c’est le sacrifice et l’amour (beaucoup d’affects et pas mal de troubles), pour Spinoza, c’est la joie difficile (mais tout ce qui est beau est difficile), pour Kant, c’est le devoir, pour Rousseau, c’est l’innocence (et la fessée), pour Schopenhauer, c’est le renoncement (et la bouffe à laquelle il est impossible de renoncer), pour Nietzsche, c’est le surhomme (qui conduit à la folie), pour Marx, c’est le goulag, pour Heidegger, c’est le chemin de campagne, pour Michel Onfray, c’est dire du mal de Dieu. Lui-même a beau prôner la gastronomie, la libération des sens, le dionysisme à tout crin, il se révèle un type sévère, rigoureux, donneur de leçon à ses heures et d’une tempestivité qui ferait rougir Luc Ferry et André Compte-Sponville eux-mêmes. On a tort de les opposer. Même si André et Luc ne jouent pas dans le même préau que Michel, tous les trois ont su faire de la philosophie pour tous et vendre beaucoup de livres qui sont autant de manuels de bien-vivre que les cent façons d’être heureux. André est le plus direct : Le bonheur désespérément, La plus belle histoire du bonheur ; Luc s’intéresse d’abord à la vie : Qu’est-ce qu’une vie réussie ?, Apprendre à vivre, puis à la vie de famille : Famille, je vous aime, et ne déteste pas Vaincre les peurs ; Michel a l’air de s’éclater plus : Journal hédoniste, Théorie du corps amoureux, Féeries anatomiques et même Le christianisme hédoniste. Sans préjuger systématiquement de la qualité de ces ouvrages, sans même tomber dans le procès d’intention des « philosophes médiatiques », et encore moins dans celui du public qui les lit, force est de reconnaître que l’amalgame qu’ils ont fait entre philosophie et bonheur risque de dérouter nombre de lecteurs quand ces derniers ouvriront un vrai livre de philosophie. C’est que la philosophie donne moins de bonheur qu’elle ne crée de l’inquiétude ou qu’elle n’effraie. Comme le dit plaisamment Clément Rosset dans son livre sur Schopenhauer, « il ne faut pas compter sur le philosophe pour trouver des raisons de vivre ». Et contrairement à ce qu’ont l’air de démontrer le succès des livres de ses confrères et leurs multiples apparitions télévisuelles, le philosophe n’est traditionnellement jamais le bienvenu dans la cité. Le philosophe désespère, scandalise, blasphème, agresse, terrorise, décourage. Il détruit les idoles, suspend les jugements, torpille les opinions. Il se masturbe en public, détourne les esprits les plus jeunes et provoque la haine des parents d’élèves. Le philosophe, c’est le danger public par excellence que les autorités décident un jour de neutraliser. Et pour commencer, le premier d’entre eux, Socrate, accusé de corrompre la jeunesse et condamné à boire la ciguë par les juges d’Athènes. Plus tard, ce seront Giordano Bruno jugé et brûlé comme hérétique, Spinoza banni par les siens, obligé de s’exiler et échappant même à une tentative d’assassinat, son nom devenant synonyme d’infamie ! Kierkegaard, traîné dans la boue par la presse de Copenhague et pourchassé à coup de pierres par la populace. C’est que la populace, dont on dit qu’elle ne comprend rien à la philosophie, la comprend en fait bien mieux que l’universitaire, car elle y pressent à l’état pur son amoralisme fondamental, son ironie antisociale, ses capacité de destruction contre ce qu’elle a de plus cher – la croyance en la morale, la certitude de ses espérances, toute une série d’illusions vitales dont on ne peut sans dommage lui révéler qu’elles le sont. Vous ne me croyez pas ? Vous pensez que j’exagère ? Lisez donc sérieusement (c’est-à-dire non universitairement) la Généalogie de la morale de Nietzsche ou le Traité du désespoir de Kierkegaard et vous comprendrez pourquoi l’honnête père de famille ne peut qu’haïr la philosophie… et pourquoi la haine de la philosophie n’est au fond que la meilleure garante de celle-ci.

Tout cela nous éloigne encore un peu plus du bonheur. Et pourtant, ce n’est pas faute de l’avoir cherché. Comme le disait Pascal, « tous les hommes recherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre. » Voilà au moins une vérité incontestable. Que l’on soit le plus grand dépressif ou le pire masochiste, le bonheur est notre obsession à tous. Sauf que nous ne savons pas toujours nous y prendre. Quand nous ne sommes pas heureux, nous préférons nous rendre malheureux, histoire de passer le temps. Nous préférons la souffrance à l’ennui. Qu’il nous arrive quelque chose de pénible plutôt que rien. Au moins pourrons-nous nous plaindre et nous rendre intéressants à nos propres yeux, sinon à ceux des autres. Il y a un tel bonheur à être malheureux. Tant de gens qui dramatisent leur existence qui s’ils savaient si prendre serait une thébaïde. L’on connaît tous ces êtres plein de ressentiment qui disent souffrir alors qu’ils ne font que voir souffrir les autres, et qui vous rapportent avec un tremolo dans la voix tout ce qui leur fait de la peine et qui en réalité les fait secrètement jubiler. Geindre, pour le dépressif, c’est jouir. Et celui qui veut geindre jusqu’au bout, c’est le damné. Dans son cours sur Leibniz , Deleuze excellait à imiter celui-ci. Ah le feu ! Ah la punition ! Ah non je n’ai pas mérité ça ! Ah ça n’arrive qu’à moi ! Ah c’est trop injuste ! Mais ses plaintes sont de fausses plaintes. Au fond, le damné rigole. Car dans ses souffrances, il jouit de la plus grande et la plus innommable jouissance– la jouissance de la haine de Dieu. C’est cette haine qui le damne et qui d’une certaine manière l’emplit d’une joie mauvaise et éternelle. Le damnation n’est donc pas un malheur que Dieu inflige au damné (car si c’était le cas, Dieu serait un bourreau), elle est une sorte de bonheur dans lequel le damné fait ou croit faire le malheur de Dieu en refusant de se laisser à Lui. Autrement dit, et comme l’écrit Leibniz, « Le damné n’est pas éternellement damné mais il est toujours damnable et se damne à chaque instant » Le damné tient trop à sa damnation pour y renoncer et sa haine de Dieu vaut bien qu’il supporte les petits inconvénients du feu. Je brûle de ma haine contre toi, ma haine qui a été plus grande que ton amour, ma haine qui a vaincu ton amour et qui prouve à toutes les âmes que l’on peut être plus fort que toi. Si je gémis en enfer, tu pleures au paradis, et c’est pourquoi je préfère y rester car ma douleur est désormais garante de la tienne. En enfer, je te tiens.
Finalement, il est très difficile de parler du bonheur sans parler d’autre chose – dépression, suicide, damnation. Peut-être parce que, comme le disait Jean-Louis Bory à propos d’un film de Lelouch, le bonheur est quelque chose de vulgaire. Voyez Hairspray, le film de Adam Shankman avec John Travolta en femme, la comédie musicale la plus grotesque de l’année et qui est pourtant un moment de bonheur immense – que j’ai goûté personnellement deux fois. Mon article peut-il encore être pris au sérieux après cet aveu ? Le bonheur ne peut-il être traité qu’entre son impossibilité douloureuse et sa superficialité répugnante ? Pourtant, même dans des rangs plus nobles, on ne pardonne pas aux artistes et aux écrivains de ne se contenter de donner que du bonheur. Rembrandt sera toujours préféré à Rubens. Beethoven paraîtra toujours plus profond que Mozart – et Offenbach sera toujours snobé par les mélomanes (malgré les efforts de Clément Rosset pour le réhabiliter dans La force majeure). Enfin, que dire d’un Sacha Guitry dont on fête le cinquantenaire cette année et qui passe encore pour un affreux snobinard, superficiel et misogyne, alors qu’il fut l’un des plus grands artistes du bonheur ? Relisez ses étonnantes « lettres à mon fils » et dites-vous de toute chose qui vous arrive :« faut-il que cela soit bon pour que cela me soit arrivé ! » Aimer sa vie et non la vie, voilà le secret du bonheur.
(Cet article est paru dans le premier numéro des Carnets de la philosophie d’octobre 2007 et mis en ligne une première fois sur ce blog le 14 janvier 2008.)