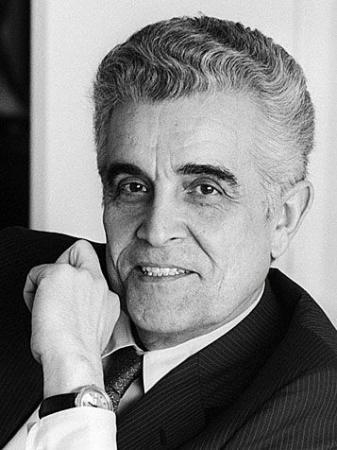Aimez-vous Julien Sorel ou Le rouge et le noir ? Stavroguine ou Les démons ? Préférez-vous Don Juan ou Dom Juan ? Don Quichotte ou Don Quichotte ? Etes vous roman ou personnage ? Si vous dites roman, vous serez heureux de lire cet article, si vous dites personnage, ce qui va suivre risque de vous déplaire. C’est que les personnages sont les pièges que tend l’auteur au lecteur, il faut le savoir. Non ? Vous ne me croyez pas ? Vous persistez à « être » Don Quichotte ? Vous vous reconnaissez encore dans Stavroguine ? Julien Sorel, c’est tout à fait vous ? Et si ce n’est pas vous, c’est celui que vous auriez aimé être ? On peut comprendre votre erreur. Il est flatteur d’être antisocial comme Julien, ou séducteur comme Don Juan, ou classieux comme Stavroguine, ou idéaliste comme Don Quichotte. Et comme vous ne cessez de le dire, « il en manque des Don Quichotte aujourd’hui ». Eh oui ! Il en manque aujourd'hui des idéalistes, des rebelles, des révolutionnaires, des hommes purs et durs qui chambarderaient un peu ce « monde matérialiste pourri par le fric » - un autre de vos jingles. Etre romantique, voilà la vérité. Diable ! Nous ne savons plus si nous devons encore vous parler de ce livre qui, dès son titre, exprime exactement le contraire de votre credo. Pourtant, Mensonge romantique et vérité romanesque de René Girard, paru en 1961, est non seulement l’essai de critique littéraire le plus pénétrant jamais écrit, il est aussi un traité anthropologique, une somme théologique, un digest psychologique, une théorie psychanalytique, un manuel de savoir-vivre, une série d’exercices spirituels, une grande méditation politique enfin. Bref, un texte indispensable, essentiel et qui pourtant ne dit que trois chose – trois choses qui risquent de vous irriter.
Un, le désir est social.
Deux, l’identité est une imitation d’autrui.
Trois, la littérature est un combat du romanesque contre le romantique, c’est-à-dire de la vérité contre le mensonge.
 Rien d’extraordinaire, rétorquez-vous ? Et pourtant vous disiez à l’instant que vous adoriez Don Quichotte et que vous vous navriez que l’on n’en trouve pas plus dans le monde – opinion fort discutable au demeurant puisque nous considérons, nous, qu’il y en a trop, de Don Quichotte. En vérité, ils courent les rues, vos rebelles. Idéalistes de tout bord, radicaux transparents et transpirants, baba cools sur le retour, punk en retard, altermondialistes en pointe, humanitaires rafleurs d’enfants, marxo-lepénistes du net et d’ailleurs, va-t-en-guerre impénitents, terroristes de papier, maudits toujours ravis, candides de toutes les causes, , hommes du sous-sol et le criant bien fort, infréquentables facebookés, ils sont tous là, partout. Dans notre monde individualiste, il n’y a plus que cela, des « seuls contre tous » (qui d'entre nous ne l'a pas été ?), des légions d’uniques, des meutes de solitaires. Dont Marylin Manson, Che Guevara, Ben Laden, sont les idoles. Alors non, ce n’est pas tant de Don Quichotte dont nous avons besoin que de Cervantès. Car l’idéal de Don Quichotte n’est qu’ une illusion romantique, et c’est Cervantès qui la dénonce dans cette vérité romanesque qui s’appelle L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Vous commencez à comprendre ? Et cela commence à vous déplaire ? Alors en route !
Rien d’extraordinaire, rétorquez-vous ? Et pourtant vous disiez à l’instant que vous adoriez Don Quichotte et que vous vous navriez que l’on n’en trouve pas plus dans le monde – opinion fort discutable au demeurant puisque nous considérons, nous, qu’il y en a trop, de Don Quichotte. En vérité, ils courent les rues, vos rebelles. Idéalistes de tout bord, radicaux transparents et transpirants, baba cools sur le retour, punk en retard, altermondialistes en pointe, humanitaires rafleurs d’enfants, marxo-lepénistes du net et d’ailleurs, va-t-en-guerre impénitents, terroristes de papier, maudits toujours ravis, candides de toutes les causes, , hommes du sous-sol et le criant bien fort, infréquentables facebookés, ils sont tous là, partout. Dans notre monde individualiste, il n’y a plus que cela, des « seuls contre tous » (qui d'entre nous ne l'a pas été ?), des légions d’uniques, des meutes de solitaires. Dont Marylin Manson, Che Guevara, Ben Laden, sont les idoles. Alors non, ce n’est pas tant de Don Quichotte dont nous avons besoin que de Cervantès. Car l’idéal de Don Quichotte n’est qu’ une illusion romantique, et c’est Cervantès qui la dénonce dans cette vérité romanesque qui s’appelle L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Vous commencez à comprendre ? Et cela commence à vous déplaire ? Alors en route !
Don Quichotte se voyait en Amadis de Gaule, Julien Sorel puisait ses forces en Napoléon Ier, madame Bovary tentait de vivre en héroïne romantique inspirée de romans de seconde zone – la pauvre ne disposant même pas de références classiques ; et nous-mêmes nous sommes nous successivement pris pour le comte de Monte-Cristo, Parsifal, Casanova, Severus Rogue, Dale Cooper (de Twin Peaks) et même Spiderman – avant de se rendre compte que l’on avait plus de points communs avec un personnage de Molière ou de Houellebecq qu'avec un super héros. Tant pis ! Même les Ridicules et les Dépressifs ont une valeur littéraire, donc supérieure. Et souffrir comme Michel nous permettra d’être écouté, compris, sinon reconnu. Vivre par procuration donne une certaine lisibilité sociale. Que celui qui n’a jamais imité personne ose faire ce mensonge.
Le désir mimétique, tel que le conçoit René Girard, ne consiste pas à désirer l’autre, mais à être l’autre. Imiter le saint, le héros, le dandy. Imiter le fou quand il est sublime ou le salaud quand il est lumineux et qu’il plaît aux femmes. Imiter par-dessus tout le séducteur. Lorsque dans Les démons, Piotr Verkhovenski dit à Stavroguine qu’il est « beau », ce n’est pas tant par homosexualité latente que par admiration introjective du disciple envers le maître. Car c’est le maître qui dit quoi désirer, quoi penser, quoi faire. Le maître ou le médiateur – soit celui qui possède le Verbe et qui le dispense à son gré, sans toujours se rendre compte que ses paroles seront plus effectives dans l’esprit d’autrui que dans le sien. Ainsi Stavroguine a-t-il engendré le slavophisme orthodoxe de Chatov, le nihilisme révolutionnaire de Piotr Verkhovenski et la religion de l’homme-dieu de Kirilov sans que lui, au grand désespoir de ces derniers, ne soit particulièrement slavophile, révolutionnaire ou ne se prenne pour le dieu qu’eux voient en lui et vénèrent de tout leur cœur. Lui ne se contente que d’observer le progrès des idées en eux et de voir les monstres idéologiques qu’ils deviennent.
Plus que tout autre, l’écrivain est le médiateur suprême, celui qui désigne le désir. Dans A la recherche du temps perdu, le Narrateur avoue plusieurs fois qu’il ne s’intéresse à quelque chose qu’en fonction de ce qu’en dit son écrivain préféré, Bergotte, dans ses livres. « J’étais incapable de voir ce dont le désir n’avait pas été éveillé en moi par quelque lecture ». A la question proverbiale qui a fait le bonheur des magazines littéraires, « pourquoi lit-on ? », on peut répondre définitivement : pour désirer. Si la littérature est la vraie vie, c’est moins parce qu’elle remplace la vie que parce qu’elle rend cette vie plus vivante. Ce qu’il y a dans les livres nous rend compte de ce qu’il y a dans la vie. Contrairement à ce que pensent les barbares, on lit pour vivre et on vit pour s’évader…ou pour se flinguer. Kirilov, Werther ou le feu follet de Drieu La Rochelle pourront bien se suicider - pas nous qui lisons leurs aventures et qui avons fini par comprendre que le suicide, comme disait Napoléon (notre côté Julien Sorel) est « une erreur de jugement. » En vérité, lire est le meilleur antidote contre le suicide et ne pas lire le meilleur moyen d’avoir envie d’en finir au plus vite. Depuis que nous avons lu le Traité du désespoir de Kierkegaard, nous savons rire de notre propre désespoir alors que nous en observons tellement qui sont prisonniers du leur et qui ne veulent surtout pas entendre parler de Kierkegaard, les pauvres imbéciles…
Evidemment, l’écrivain n’est pas le seul médiateur. La médiation peut prendre autant de formes individuelles (héros fictifs ou réels, parents modèles ou rêvés) que de formes abstraites (âge d’or révolu, légende familiale ou régionale, idéal politique ou religieux). Tout est bon pourvu que ç’en impose. Ce que nous sommes, c’est ce que nous avons pris d’intéressant et de joli chez les autres, illustrant parfaitement ce qu’a dit Montaigne - « notre fait n’est que pièces rapportées ». Etre, c’est paraître, c’est « être par », et ceci est vrai autant pour le snob qui hante les salons que pour l’homme « authentique » qui se moque des snobs (et qui la plupart du temps est plus ennuyeux que ces derniers). L’authenticité, quelle barbe et quel mensonge ! Tant de gens qui sont persuadés d’être naturellement naturels ! Certes, il est vexant de constater que notre belle identité n’est que juxtaposition et collage d’humeurs, peaux empruntés, masques volés ou manteaux d’Arlequin. Et notre petit moi méritant et vindicatif là-dedans ?
Il faut casser le miroir. Se connaître, ce n’est pas se regarder dans une glace en se disant qu’on est le plus beau ou le plus laid, autrement dit en se jugeant par rapport aux autres, c’est se demander qui nous imitons et qui nous imite. Parmi ceux qui m’ont fait, quel est celui à qui je rends grâce et quel est celui que je maudis ? Un tel est-il mon modèle ou mon rival ? Si je n’aime pas celui-ci, est-ce parce que je n’arrive pas à lui ressembler ? Et celui-là, dois-je encore l’aimer ou est-il temps de le tuer ? A moins que cela ne soit lui qui veuille me tuer ? Suis-je Jesse James ou Robert Ford ?[1]
Clément Rosset l’a dit mieux que quiconque dans Loin de moi, l’amitié se fonde moins sur des « affinités » ou des « ressemblances » que « sur le fait que l’un des deux compères est subjugué par l’autre ». L’amitié est une affaire d’admiration, de fascination, d’introjection et qui se termine au pire dans la haine, au mieux dans l’ennui. Il faut alors se trouver d’autres admirateurs ou d’autres personnes à admirer - ou les deux puisque chacun de nous peut être modèle et copie, idole et fan, premier et second. La littérature est pleine de ces duos d’amis qui se nourrissent l’un l’autre. Stavroguine et tous les « démons » dont nous avons déjà parlé, mais aussi Bouvard et Pécuchet, le Narrateur et Saint Loup, François Seurel et Augustin Meaulne, et même d’Artagnan et les trois mousquetaires :
« Tant que ses amis l’avaient entouré, d’Artagnan était resté dans sa jeunesse et sa poésie ; c’était une de ces natures fines et ingénieuses qui s’assimilent facilement les qualités des autres. Athos lui donnait de sa grandeur, Porthos de sa verve, Aramis de son élégance. Si d’Artagnan eût continué de vivre avec ces trois hommes, il fût devenu un homme supérieur. »[2]
Cet exemple « positif » corrige quelque peu les exemples « négatifs » qui semblent seuls trouver grâce aux yeux de Girard. En insistant sur l’envie, la jalousie et finalement la haine auxquelles semble immanquablement conduire le désir mimétique, l’auteur de Mensonge romantique en oublie la dimension d’éveil que celui-ci peut contenir. Un professeur de khâgne, un écrivain scandaleux, un oncle d’Amérique, René Girard[3] lui-même sont susceptibles de marquer à vie un esprit sensible sans que pour autant celui-ci ne s’aliène à ces derniers. Par ailleurs, être chrétien, n’est-ce pas imiter le Christ ? En fait, et Girard finit par le reconnaître un peu plus loin, c’est lorsque l’on sait que l’on a des médiateurs que l’on est le plus apte à les comprendre puis à s’en affranchir. C’est bien parce que je sais que je ne me suis pas fait tout seul que je me comprends et que je me retrouve. C’est bien parce que je n’ai pas commencé à penser de moi-même que je pense aujourd’hui par moi-même. Quant au Christ, Il est en moi mais Il n’est pas moi.
 Schpountz et don juans. [POUR TOI, AURORE, note du 10 mai 2011]
Schpountz et don juans. [POUR TOI, AURORE, note du 10 mai 2011]
Or, le propre du romantique est de croire qu’il pense de lui-même par lui-même – mieux, qu’il est son seul créateur, « sans dieu ni maîtres ». Evidemment, c’est toujours celui qui se croit « sans dieu ni maîtres » qui est celui en qui investissent tous les démons. « Le vaniteux romantique ne se veut plus le disciple de personne écrit Girard. Il se persuade qu’il est infiniment original. »[4]. Original comme tout un chacun, pourrait-on rajouter pour le contrarier – et il n’y a rien de plus facile et de plus délicieux que de contrarier un romantique. C’est que ce dernier se croit « spontané », « authentique », supérieurement libre. Convaincu d’une « parthénogénèse » de l’imagination, il s’imagine que tout vient de lui et que tout ce qui vient de lui est formidable. Par là même, il se persuade qu’il n’est pas de ce monde. L’instinct grégaire, c’est bon pour les autres. Rien ne le dégoûte plus que la société forcément bourgeoise et médiocre et rien ne l’excite plus que le goût du sublime, « l’appel » du désert, le « dialogue » avec Dieu ou Satan – en fait avec lui-même, car au bout du compte, c’est son moi qui est divin ou diabolique, dans les deux cas, avantageux.
Comme il se doit, il va beaucoup souffrir. Car en niant toute présence d’un tiers entre lui et son « absolu », le romantique est beaucoup plus susceptible d’entrer en conflit avec autrui quand il le rencontre, sinon d’être berné par lui. Celui qui se croit seul au monde risque fort d’être le dindon de la farce du monde. Son unicité sublime ne résistera pas longtemps à la duplicité perverse des autres. C’est Don Quichotte qui essuie coups et humiliations permanentes de la part de ceux qu’il rencontre sur son chemin, c’est Emma Bovary que ses amants ruinent et que ses usuriers font chanter. Mais c’est aussi le Corbeau de la fable qui se fait piquer son fromage parce qu’il se trouvait trop beau, ou Othello qui, tellement entiché de sa propre noblesse d’âme, croit tout ce qu’on lui raconte sur la pourriture présumée de celle des autres et tombe dans tous les pièges de Iago. En vérité, le romantique est un schpountz.
 Dès lors, le ressentiment est proche. Tourné en bourrique par un monde que jusque là il ignorait superbement, le romantique se met à haïr celui-ci et à envier secrètement ceux qui y paraissent heureux et qui, pense-t-il, le sont « parce qu’ils sont méchants ». Hors du monde, le romantique était un dieu sublime ; pris dans le monde, il est un martyr sublime. Et Girard de faire malicieusement remarquer que ce sont toujours les mêmes qui sont jaloux, cocus, proies permanentes de mille rivaux et qui « perdent » à chaque fois. C’est que l’envie ou la jalousie sont moins le résultat de conjectures particulières qu’un état d’esprit persistant. Nous avons tous eu dans nos familles un oncle castré ou une grand-mère douloureuse qui passaient leur vie à répéter que « les gens étaient méchants » sans se rendre compte que c’était peut-être eux qu’ils l’étaient. Mais être la victime des autres, quelle jouissance ! Aussi grande que celle de pouvoir accuser !
Dès lors, le ressentiment est proche. Tourné en bourrique par un monde que jusque là il ignorait superbement, le romantique se met à haïr celui-ci et à envier secrètement ceux qui y paraissent heureux et qui, pense-t-il, le sont « parce qu’ils sont méchants ». Hors du monde, le romantique était un dieu sublime ; pris dans le monde, il est un martyr sublime. Et Girard de faire malicieusement remarquer que ce sont toujours les mêmes qui sont jaloux, cocus, proies permanentes de mille rivaux et qui « perdent » à chaque fois. C’est que l’envie ou la jalousie sont moins le résultat de conjectures particulières qu’un état d’esprit persistant. Nous avons tous eu dans nos familles un oncle castré ou une grand-mère douloureuse qui passaient leur vie à répéter que « les gens étaient méchants » sans se rendre compte que c’était peut-être eux qu’ils l’étaient. Mais être la victime des autres, quelle jouissance ! Aussi grande que celle de pouvoir accuser !
S’acharnant à trouver la béatitude seulement en lui-même et ne la trouvant finalement jamais (car le moi est haïssable), le romantique finit par s’en prendre à tous ceux qui l’ont trouvé dans l’altérité. En premier lieu Don Juan - dont on dit trop qu’il provoque les envies alors que c’est lui qui ontologiquement est envieux. Le secret de Don Juan est qu’il ne peut supporter le bonheur des autres. Son plaisir consiste moins à séduire les belles qu’à les arracher à leurs amants qui sont pour lui comme autant de rivaux potentiels. Au fond, Don Juan est moins « l’épouseur du genre humain » que son éternel jaloux - comme lui-même l’avoue sans s’en rendre compte dès le début de la pièce de Molière :
« Le hasard me fit voir ce couple d’amants trois ou quatre jours avant leur voyage. Jamais je n’ai vu deux personnes être si contentes l’une de l’autre et faire éclater plus d’amour. La tendresse invisible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l’émotion ; j’en fus frappé au cœur et mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne pus souffrir de les voir si bien ensemble ; le dépit alarma mes désirs, et je me figurai un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et rompre cet engagement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. » (I,2)
La violence de cet aveu fondamental qui révèle le caractère profondément jaloux et destructeur de Don Juan ne devrait pas cacher sa dimension extraordinairement comique. « Je ne pus souffrir de les voir si bien ensemble » est une réplique qui commence par inquiéter et qui, quand on y repense, finit par déclencher le rire. Rien de plus grotesque en effet que l’intention sadique qui s’avoue comme telle. Rien de plus ridicule que la méchanceté candide et spontanée – nous allions dire « authentique » ! Le grand seigneur méchant homme est au fond un petit merdeux plein d’aigreur qui en veut à la terre entière – et qui en ce sens a tout à fait sa place parmi les grands aberrants de Molière, Don Garcie de Navarre et Arnolphe en tête. Tout le contraire de Casanova, soit dit en passant !
La grande œuvre romanesque est donc la révélation (souvent comique) de l’illusion romantique. En langage proustien, elle est celle qui nous fait passer du temps perdu au temps retrouvé. Si celui-ci est, comme nous l’assure Proust, une révolution spirituelle et morale, c’est parce qu’il est le moment où le médiateur a été reconnu, admis, intégré et finalement distancé. Le temps retrouvé, c’est le temps où le médiateur est redevenu un étranger et où la conscience a retrouvé son intimité, c’est-à-dire son humilité. « Retrouver le temps c’est accueillir une vérité que la plupart des hommes passent leur existence à fuir, c’est reconnaître que l’on a toujours copié les Autres afin de paraître original à leurs yeux comme à ses propres yeux. Retrouver le temps, c’est abolir un peu de son orgueil », dit encore Girard[5]. Et dans l’œuvre de Proust, c’est là la grande différence entre Jean Santeuil, ouvrage romantique sans génie où l’auteur s’émerveille de son intelligence et de sa sensibilité, et la Recherche, œuvre romanesque géniale dans laquelle il ne cesse de révéler la vanité du désir mimétique et qui constitue en fin de compte une gigantesque quête déceptive des êtres et des choses. Pour révéler le snobisme, il faut avoir été snob – comme pour expliquer le vice, il faut avoir été vicieux. Etre « proustien », ce n’est donc pas goûter la saveur des salons, c’est en révéler l’amertume, la vanité, et parfois la laideur – à moins qu’il n’y ait une saveur de l’amertume ou une amertume de la saveur qui font que le lecteur, comme le Narrateur, restent malgré tout attachés à ceux-ci.
 La vérité est que la complaisance proustienne à l’égard du monde ne s’est jamais réellement tarie. Œuvre souveraine et éternelle, A la recherche du temps perdu n’en fonctionne pas moins encore avec des « comme » et des « autant que » qui constituent autant de métaphores symptomatiques que de désirs mimétiques non résolus. Car c’est quand la métaphore disparaît que le médiateur est révélé dans sa radicalité (à moins que la métaphore ne se transforme en métamorphose comme chez Kafka). Or, dans la Recherche, la duchesse de Guermantes reste la duchesse de Guermantes. Même si à la fin le Narrateur nous a tout dit de sa sécheresse de cœur et de son intelligence limitée, le souvenir qu’on en garde est celle de cette grande dame qui un soir à l’opéra sourit à celui-ci. La lucidité n’a pas tué le charme de la duchesse, ou du moins le souvenir enfantin de ce charme. En restant fidèle à la langue traditionnelle, Proust nous présente un monde polymorphe, cruel et décadent autant qu’il nous apprend à en décrypter les signes – et cette initiation pour le moins amorale à la sémiologie mondaine reste son affaire bien plus que la condamnation morale que d’aucuns ont voulu voir chez lui. Du monde, Proust devait penser la même chose qu’Oscar Wilde, à savoir qu’ « en faire partie est une corvée mais qu’en être exclu est une tragédie ».
La vérité est que la complaisance proustienne à l’égard du monde ne s’est jamais réellement tarie. Œuvre souveraine et éternelle, A la recherche du temps perdu n’en fonctionne pas moins encore avec des « comme » et des « autant que » qui constituent autant de métaphores symptomatiques que de désirs mimétiques non résolus. Car c’est quand la métaphore disparaît que le médiateur est révélé dans sa radicalité (à moins que la métaphore ne se transforme en métamorphose comme chez Kafka). Or, dans la Recherche, la duchesse de Guermantes reste la duchesse de Guermantes. Même si à la fin le Narrateur nous a tout dit de sa sécheresse de cœur et de son intelligence limitée, le souvenir qu’on en garde est celle de cette grande dame qui un soir à l’opéra sourit à celui-ci. La lucidité n’a pas tué le charme de la duchesse, ou du moins le souvenir enfantin de ce charme. En restant fidèle à la langue traditionnelle, Proust nous présente un monde polymorphe, cruel et décadent autant qu’il nous apprend à en décrypter les signes – et cette initiation pour le moins amorale à la sémiologie mondaine reste son affaire bien plus que la condamnation morale que d’aucuns ont voulu voir chez lui. Du monde, Proust devait penser la même chose qu’Oscar Wilde, à savoir qu’ « en faire partie est une corvée mais qu’en être exclu est une tragédie ».
Donc, tout est signe dans les mondes proustiens. Combray, le salon Verdurin ou le faubourg Saint-Germain obéissent à des rituels aussi précis que sophistiqués et qui ne souffrent aucun écart. Ainsi à Combray le déjeuner qui tous les samedi est avancé d’une heure et que tous les membres de la famille se plaisent à rappeler comme si c’était là un événement civique ou le début d’un cycle légendaire. Mieux, on aime le répéter devant les étrangers qui ignorent cette habitude et sont venus visiter la famille. Un peu ridicules, ils n’ont pas été initié à la vérité de Combray[6]. Dans les salons parisiens, gare à ceux qui n’ont pas connaissance de la hiérarchie compliquée qui règne entre les clans (et même à l’intérieur d’eux) ou qui ignorent les généalogies mythiques de tel ou de tel prince. Même sur la plage de Balbec, on peut se faire remonter les bretelles par un baron fou parce que l’on a eu un geste malheureux ou que l’on vient de « parler à tort et à travers comme un sourd et [d'] ajouter par là un second ridicule à celui d’avoir des ancres brodées sur son costume de bain ». Nul ressentiment du Narrateur ne suivra pourtant cette saillie de Charlus. C’est que Charlus est celui qui envoie le plus de signes mondains, sociaux, sexuels, mythiques. Comme le remarque Girard , il est le seul personnage que le narrateur laisse discourir sans l’interrompre. Sa parole est en effet d’une polysémie infinie. Surtout, sa maîtrise des mondes paraît total. Charlus est celui qui traverse la société de haut en bas et qui pénètre toutes les médiations – d’où son plaisir « pervers » à subvertir celles-ci, en allant trouver son plaisir dans l’avilissement le plus outrancier ou même en saluant une roturière comme si elle était une reine. Mais subvertir le monde auquel on appartient ne signifie pas rompre avec lui. Proust a beau révéler la cruauté et l’hypocrisie du faubourg Saint-Germain, il ne songe jamais à le fuir (comme par exemple Alceste le fait à la toute fin du Misanthrope). Et pour les antiproustiens (cela existe encore), le fait que Proust fasse de cette société de snobs le matériau de son livre établit, quelles que soient l’ironie qu’il y met ou la satire qu’il en tire, qu’il n’a pas renoncé au désir métaphysique d’en faire partie… au moins par l’écriture - la preuve étant qu’il n’a rien trouvé d’autre à écrire. En effet, c’est quand la particule, le nom, le mot ne sont plus utilisés comme des références que l’on se débarrasse pour de bon du mimétisme social et psychologique. C’est à Dostoïevski que sera réservée cette étape même si ce dernier n’arrive pas comme tel dans la chronologie.
« Pourquoi les hommes ne peuvent-ils plus alléger leurs souffrances en les partageant ? »[7] se demande douloureusement René Girard – et l’on sent déjà le penseur catholique qui commence à pointer en lui. Parce que l’homme est devenu son propre Dieu mais un Dieu qui paradoxalement se retrouve en enfer. Car être Dieu, c’est être seul, c’est perdre toute possibilité de consolation supérieure, c’est être obligé de ne compter que sur soi et seulement sur soi… et c’est être tenté par le néant (en langage humain par le suicide) dès que cela ne va pas. Dieu était ce qui nous aimait encore quand nous ne aimions plus. Comment pourrions-nous nous aimer si nous sommes Lui ? Nous voilà abandonnés à nous-mêmes, aliénés à notre haine de soi, incapables de nous pardonner ce que Lui nous aurait pardonné. Lentement, notre moi glisse de l’unicité à l’isolement et notre être se confond avec notre péché. Comme le dit encore Girard, « le péché originel n’est plus la vérité de tous les hommes comme dans l’univers religieux mais le secret de chaque individu, l’unique possession de cette subjectivité qui proclame bien haut sa toute-puissance et sa maîtrise radieuse »[8]… et qui en même temps souffre tous les diables. C’est que le moi romantique met de l’orgueil dans sa damnation ! Qu’il soit bon parce que les autres sont méchants ou méchant parce que les autre sont bons (mais dans ce cas, leur bonté manque d’amplitude comme celle par exemple de Don Ottavio face à la méchanceté supérieure de Don Giovanni), il s’agit toujours d’être seul contre tous. Et entre le mouton du troupeau et le loup solitaire, le romantique a vite choisi qui il sera. Sa descente en enfer n’est qu’une garantie de son élection. Ils iront tous s’ennuyer au paradis sauf lui qui précisément n’est pas comme eux et a besoin d’un enfer passionnant, ha !
C’est la raison pour laquelle la plupart d’entre nous ont un petit faible pour les personnages maléfiques car ils flattent nos besoins métaphysiques, sinon « méphistophéliques ». Certes, Dieu pourrait tout autant nous combler mais Dieu est exigeant. Dieu n’est pas marrant. Surtout Dieu est vertical et d’une verticalité du haut à laquelle il est difficile de se hisser tant nous sommes lourds. Alors que le diable est tout aussi vertical mais d’une verticalité du bas et à laquelle il est très facile de se laisser glisser. Le diable, qui n’est pas matérialiste pour un sou, sait que nous préférons encore une transcendance déviée à l’absence de transcendance. Le diable connaît nos instincts de pouvoir et de domination qui ne sont rien d’autre, quoique sur un mode autoritaire, que le bon vieux désir d’éternité, et il a l’art de caresser notre essence dans le sens de celle-ci. Sa malignité est de nous faire croire qu’il nous traite en unique, voire en privilégié (le pacte) alors qu’il nous traite en meute - et qu’en enfer nous allons précisément nous retrouver les uns sur les autres. Tout le contraire de Dieu devant lequel nous avons parfois l’impression de faire partie d’une foule indifférenciée (l’Eglise, les fidèles, le troupeau de brebis) alors que c’est avec Lui que nous pouvons entretenir une relation individuelle. Avec le diable, nous ne sommes que des particuliers lotis à la même enseigne alors que devant Dieu, nous sommes rendus à notre singularité propre. Et c’est pourtant le diable qui continue à nous charmer, et c’est toujours Don Ottavio qui nous paraît aussi niais. Le salaud plutôt que le faible. Le salaud, surtout, plutôt que le snob.
Ah le snobisme ! La seule chose au monde que nous ne pardonnons pas ! « Nos puissances d’iindignation sont infinies lorsqu’il s’agit de snobisme, remarque Girard. Ce crime est le seul, peut-être, que notre littérature d’avant-garde, pourtant si éprise de justice, ne songe jamais à "réhabiliter" »[9]. C’est que le snob, contrairement au criminel, appartient à notre univers. Il est donc plus facilement méprisable car il représente tout ce que nous sommes ou tout ce que nous croyons que nous sommes… en pire. Le snob singe nos goûts, nos valeurs, notre être précieux. Surtout, il remet en place des frontières sociales que nous avions cru abolies depuis longtemps. Est snob en effet celui qui s’asservit à une hiérarchie sociale imaginaire. « Dans une société où les individus sont "libres et égaux en droit" il ne devrait pas y avoir de snobs, explique Girard. Mais il ne peut y avoir de snobs que dans cette société. Le snobisme, en effet, exige l’égalité concrète. Lorsque les individus sont réellement inférieurs ou supérieurs les uns aux autres il peut y avoir servilité et tyrannie, flatterie et arrogance mais jamais snobisme au sens propre du terme »[10]. Le snob ne peut donc exister qu’en démocratie – soit dans un monde où les castes sociales n’existent plus mais qu’il peut recréer artificiellement.
C’est la raison pour laquelle les vaniteux du Rouge et le Noir ne sont pas proprement dit des snobs comme ceux de la Recherche. Dans le monde stendhalien, l’ancienne hiérarchie du pouvoir perdure alors que ce n’est plus le cas dans le monde proustien. Julien Sorel reste encore et malgré tout l’inférieur de monsieur de Rénal alors que le Narrateur ne l’est plus du tout du baron de Charlus. Le prestige d’être reçu chez les Guermantes est un privilège métaphysique qui ne renvoie qu’à lui-même (être reçu chez les Guermantes) alors qu’être reçu chez les La Mole peut assurer la future carrière de l’ambitieux. De Stendhal à Proust, la bataille sociale est devenue un jeu mondain où défaite et victoire ne sont qu’une même affaire de croyance.
Cependant, ne nous leurrons pas. Sauf si l'on est Jésus-Christ ou Socrate, il est impossible à quiconque de se départir de tout snobisme - comme il est impossible de se départir de toute apparence sociale. L’apparence est une réalité de la vie – et sans doute la plus pérenne. Au fond, le snobisme n’est qu’un code social comme un autre et qui a, comme tout code social, ses maîtres et ses esclaves. Certes, nous ferons semblant de dépasser cette réalité mais nous serons toujours plus attirés par le baron de Charlus ou la duchesse de Guermantes que par Legrandin ou madame Verdurin. C’est que Charlus et la duchesse incarnent un snobisme souverain, créateur, celui autour duquel vont se modéliser tous les autres, celui qui va susciter le désir mimétique. Au contraire, Legrandin est une figure du snobisme vaincu et Verdurin celui du snobisme arrogant. Eux n’arrivent pas à suivre ou suivent mal. Bref, si tous les snobs sont navrants, les snobs qui ont échoué dans leur snobisme sont pitoyables. Or, combien de gens méprisent-ils le « grand » monde pour la secrète raison qu’ils s’y sont cassés les dents ? Combien d’entre nous font mine de snober les « people » après avoir tout essayé pour en être ? Combien de frustrés de la jet-set ? On sera moins blessé par le salaud qui vous a fait un coup bas que par le snob accompli qui s’est moqué de votre tentative de snobisme. Quelle humiliation que d’avoir été confondu dans son apparence par des gens qui ont réussi à garder la leur ! Quelle blessure que d’avoir été dégommé dans son snobisme par des snobs plus forts que vous ! C’est lorsqu’on attente à la vanité d’autrui qu’on est sûr de lui faire le plus mal – et parfois de le pousser au suicide comme dans Ridicule, le film de Patrice Leconte, qui illustrait à merveille cette lutte à mort des apparences entre elles. Gardons-nous donc bien de maugréer contre le snobisme de peur que les souffrances du nôtre apparaissent. Comme le dit très justement Girard, « l’indignation qu’excite en nous le snob est toujours la mesure de notre propre snobisme »[11].
Le snobisme, c’est la vie métaphysique par excellence. Et puisque nous ne pouvons y échapper, autant apprendre à en décrypter les signes. Car tous les milieux ont leurs signes et donc leurs snobs. Prolétaire, bourgeois, aristocrate, aucun monde n’échappe au mode de fonctionnement des copies et des modèles car aucun monde n’est « authentique ». Le plus intelligent, nous allions dire le plus noble, c’est celui qui s’adapte à tous les snobismes.
Est-ce à dire que tout le monde est snob et que personne n’est noble ? René Girard n’y songe même pas. La noblesse individuelle peut se révéler en tout un chacun à condition qu’on l’envisage ailleurs que sur un plan social et autrement que d’après le mode romantique. « Est noble, aux yeux de Stendhal, l’être qui tient ses désirs de lui-même et s’efforce de les satisfaire avec la dernière énergie »,[12]écrit Girard. Contrairement à Julien Sorel qui calcule sa valeur selon des modèles soi-disant supérieurs, Fabrice del Dongo ne vit que selon son cœur, sa foi et son courage. Rien de « mimétique » dans ses désirs ni d’affecté dans ses actions. Etre de passion pur, il ne se soucie que de l’objet de son désir. Qu’importe qu’il soit dans un salon ou en prison pourvu qu’il puisse contempler Clélia ! Il est vrai que Fabrice fut un enfant aimé, élevé dans l’excellence, et qu’il bénéficie, même adulte, de la protection quasi magique de sa tante sublime, la Sanseverina, alors que le malheureux Julien dut d’abord s’extirper de sa famille de butors. Facile de se laisser aller aux passions joyeuses quand les fées s’occupent de votre intendance (fortune, métier, place sociale). Facile d’aimer quand tout va bien socialement et sexuellement (et l’on connaît la place douloureuse de l’impuissance dans la vie amoureuse de Stendhal). Il n’empêche que même s’il a ses raisons, le ressentiment ne saurait être une solution. Si nous avons un seul devoir d’être humain, c’est d’en sortir - et c’est à quoi nous aide la vérité romanesque. Il faut donc lire les aventures de Julien Sorel non pas tant pour se reconnaître en Julien Sorel que pour apprendre au contraire à ne plus être comme lui.
Le drame de Julien est en effet d’aimer sincèrement madame de Rénal mais de lui préférer socialement Mathilde de la Mole, soit d’être déchiré entre le désir amoureux et le désir mimétique, entre la réussite de sa vie et la réussite dans la vie – entre le rouge et le noir. Julien commencera par se tromper lui-même, jouant sa vanité contre sa passion, son snobisme contre sa noblesse, son égoïsme contre son égotisme. C’est que l’égotisme, catégorie stendhalienne s’il en est, est une voluptueuse occupation de soi contrairement à l’égoïsme qui n’est qu’une vaniteuse préoccupation du moi. L’égotiste s’occupe de ses plaisirs, l’égoïste de ses intérêts. L’égotiste se distingue des autres du fait qu’il ne cherche pas à les imiter. L’égoïste finit par ressembler à tout le monde du fait qu’il veut comme tout le monde se distinguer des autres. Le Rouge et le Noir est donc moins le roman de l’ambition sociale que celui de la vanité, sinon de la vulgarité, de l’ambition sociale.
Qui est vulgaire ? Moins celui qui a des mauvaises manières que celui qui se croit supérieur avec ses bonnes manières. Moins celui qui met les coudes sur la table que celui qui fait publiquement remarquer qu’il ne faut pas mettre les coudes sur la table (à moins que celui qui ne mette les coudes sur la table ne le fasse exprès pour indisposer ceux avec qui ils dînent et dont il veut heurter la délicatesse, sachant bien qu’ils n’oseront rien lui dire). Qu’elle soit celle du puissant contre l’humble ou du parvenu contre l’homme bien élevé, la vulgarité est toujours et avant tout la volonté de faire honte à autrui.
Autrui aurait pourtant tort de rougir. Car les distinctions mondaines qu’opère dans le monde le vulgaire pour le rabaisser ne sont rien moins que grotesques. Rien de plus comique en effet que de découper le monde à son avantage car ce faisant c’est soi-même que l’on coupe du monde réel. Or, l’être réellement noble ne pense et n’agit pas en fonction des quartiers de noblesse ou de non-noblesse des autres. Il trinque ou ferraille avec tout le monde. Il accepte tous les défis. Et « dans l’ordre de la pensée, c’est l’évidence rationnelle qui tient lieu de défi. »[13] C’est pourquoi le rationalisme marque la mort du privilège essentiellement irrationnel. L’être noble, nous assure Girard, « va droit aux vérités les plus générales et il les applique à tous les hommes. Il refuse les exceptions, surtout celles dont il profiterait ». En ce sens, « l’esprit aristocratique ne se distingue pas de l’esprit libéral ».
 Un libéralisme aristocratique qui désormais risque d’être la cible non plus de l’inégalitarisme d’antan mais bien de l’égalitarisme forcené d’aujourd’hui. C’est que la passion de l’égalité, comme l’a bien vu Tocqueville, est devenue le vice ontologique de nos sociétés démocratiques. Après avoir liquidé la noblesse de classe, on ne cesse de vouloir éradiquer la noblesse d’âme. La sainteté est un idéal que l’on ne veut plus comprendre. L’excellence d’une pensée est presque une insulte. Le grand art est à peine envisageable. En fait, l’asservissement officiel est devenu officieux. La dictature des noms a laissé place à la dictature des anonymes. Chacun veut être connu, reconnu, célébré, honoré, glorifié. Tout se vaut à condition qu’on y soit. L’ "happy few" est l’ennemi public numéro un. D’où chez certains la nostalgie de l’Ancien Régime qui au moins obéissait à une mystique sociale dans son organisation hiérarchique et fera dire à Lucien Leuwen qu’à choisir il préfère encore faire la cour au roi plutôt qu’à son bottier et qu’importe que la société soit corrompue pourvu qu’elle soit brillante :
Un libéralisme aristocratique qui désormais risque d’être la cible non plus de l’inégalitarisme d’antan mais bien de l’égalitarisme forcené d’aujourd’hui. C’est que la passion de l’égalité, comme l’a bien vu Tocqueville, est devenue le vice ontologique de nos sociétés démocratiques. Après avoir liquidé la noblesse de classe, on ne cesse de vouloir éradiquer la noblesse d’âme. La sainteté est un idéal que l’on ne veut plus comprendre. L’excellence d’une pensée est presque une insulte. Le grand art est à peine envisageable. En fait, l’asservissement officiel est devenu officieux. La dictature des noms a laissé place à la dictature des anonymes. Chacun veut être connu, reconnu, célébré, honoré, glorifié. Tout se vaut à condition qu’on y soit. L’ "happy few" est l’ennemi public numéro un. D’où chez certains la nostalgie de l’Ancien Régime qui au moins obéissait à une mystique sociale dans son organisation hiérarchique et fera dire à Lucien Leuwen qu’à choisir il préfère encore faire la cour au roi plutôt qu’à son bottier et qu’importe que la société soit corrompue pourvu qu’elle soit brillante :
« Je n’ai pas assez de vertus farouches pour penser comme Vindex. Je m’ennuierais en Amérique, au milieu d’hommes parfaitement justes et raisonnables, si l’on veut, mais grossiers, mais ne songeant qu’au dollar. Ils me parleraient de leurs dix vaches, qui doivent leur donner au printemps dix veaux, et moi j’aime à parler de l’éloquence de M. de Lamennais, ou du talent de madame Malibran comparé à celui de madame Pasta ; je ne puis vivre avec des hommes incapables d’idées fines, si vertueux qu’ils soient ; je préférerais cent fois les mœurs élégantes d’une cour corrompue. Washington m’eût ennuyé à mort, et j’aime mieux me trouver dans le même salon que M. de Talleyrand. Donc la sensation de l’estime n’est pas tout pour moi ; j’ai besoin des plaisirs donnés par une ancienne civilisation. »
Et un peu plus loin,
« La démocratie est trop âpre pour ma façon de sentir. »[14]
Pour les "happy few", l’hypocrisie devient alors une question de survie.
A SUIVRE..... Masochistes, déclassés, hommes du sous-sol.
[1] Allusion au film d’Andrew Dominic, L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford sorti cette année et qui illustre comme un paradigme la pensée girardienne du désir mimétique. Chef-d’œuvre cinématographique soit dit en passant.
[3] D’où la contradiction insoluble qui consiste à prendre comme médiateur Girard lui-même ! Car celui qui dévoile le désir mimétique devient suprêmement objet de ce même désir mimétique. Girard, modèle romantique de l’anti-romantisme, l’aporie parfaite !